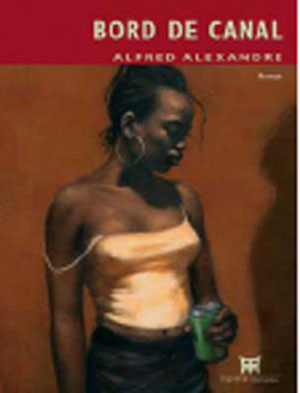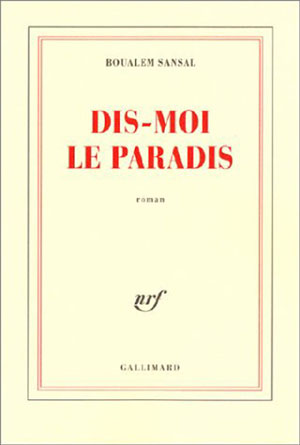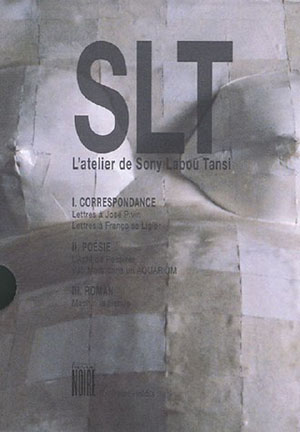Quatre romans francophones explorent la parole des fins de parcours.
Plus de veillées sous les étoiles du désert ni de grand-mère conteuse dans ces quatre romans francophones qui donnent la parole et quelle parole ! à des hommes échoués au fond de bars. Sony Labou Tansi, dans la version originale de L’état honteux (1981) publiée sous le titre initial de Machin la Hernie (2005) laisse délirer son narrateur, » Luigi Nolavinto, rue Fantar, café ‘les Râte-Bonheurs’ « . Celui de Boualem Sansal, dans Dis-moi le paradis (2003) commence de la même façon, tout de go : » Je le rencontrais entre deux voyages, au Bar des Amis » et ajoute quelques lignes plus loin : » Le bar eut un passé et un nom : la citadelle de Bab-el-Oued « . Le personnage de Bord du canal, d’Alfred Alexandre (2004) est dans un » bar-hôtel branlant « . Quant au texte d’Alain Mabanckou, il semble avoir commencé avant l’incipit : » Disons que le patron du bar Le crédit a voyagé m’a remis un cahier que je dois remplir « .
Ces lieux clos ne sont situés que dans leur environnement immédiat, le quartier, car ils n’appartiennent pas au réseau social de la ville, encore moins du pays. Les qualificatifs employés pour les désigner ressemblent à une suite de quasi-synonymes : » ruine malheureuse « , » bar allotropique « , » esquif branlant » ou encore » bout du monde « .
Qu’y fait-on ? On y boit certes, » au-delà de la soif « , » comme les tonneaux d’Adélaïde que les Libanais vendent au grand marché « , mais surtout, on meuble le désespoir : » Tous dans la petite communauté du bar-hôtel, on le savait dans notre chair : du jour où tu arrivais sur le Bord du Canal, on disait entre nous, c’est comme si tu venais de t’allonger sur une planche inclinée vers le bas » (Alexandre).
Alors, à défaut d’action, de révolte, d’entreprise, on parle. Le flot s’écoule, alimenté par une clientèle que le lecteur voit défiler avec un mélange de curiosité, d’amusement et de compassion. Les traîne-misère de Guadeloupe, drogués, prostituées, clandestins arrivés de toute la Caraïbe ressemblent étrangement aux protagonistes congolais esseulés et aux Algériens sortant de prison ou fuyant la » campagne de moralisation « . Tous attendent car ils appartiennent à » cette espèce désespérée » (Mabanckou) : » au fond, nous sommes bien, ni heureux ni malheureux ; entre parenthèses » (Sansal), » tu n’essaies plus quoi que ce soit [
] tu sais que ça débouchera sur une voie sans issue » (Alexandre).
Alors, littérature déprimante ? Sansal prévient, son histoire » on aura du mal à la lire sinon ça voudrait dire quoi, que tout va bien dans le meilleur des mondes pour nous, or ce n’est pas le cas « . Effectivement, les itinéraires racontés par les uns et les autres dans des séries d’emboîtements et de croisements ininterrompus se soldent tous par des échecs, des séparations, des humiliations. La violence des mots, de la haine, des ruptures et des fantasmes semble ne pas connaître de limites. Et surgissent les histoires anciennes de vengeance entre clans, s’accumulent les signes des abus de pouvoir, défilent les représentants politiques, religieux, les acteurs sociaux, tous véreux, despotiques, décevants.
Le lecteur occidental pourrait croire en une métamorphose des veillées traditionnelles désormais vécues sous les néons du zinc. Effectivement, un des protagonistes d’Alger lance à son ami : » Souviens-toi, la poésie ne coûte rien, elle dit pourtant ce que nous ne savons pas concevoir « . Le scribe du Crédit a voyagé prévient pourtant que » l’époque des histoires que racontait la grand-mère était finie « . Le narrateur de Sony commence une » vraie histoire telle que se la racontent les gens de chez moi, avec leur salive et leur goût du mythe « . Surgissement du merveilleux par la remontée des origines ? Non, ces bars minables d’un monde désenchanté sont les derniers lieux de fraternité précaire où la parole est libérée mais sans vigueur ni visée autre que le soulagement dans l’instant du locuteur. Elle n’a plus de direction ni de sens : les auditeurs sont vieux ou épuisés, le contenu de leurs histoires ne porte plus le sens du monde, ils ne peuvent aller au-delà de leurs itinéraires personnels et ratés. Le discours s’enfle mais tourne à vide jusqu’à l’extinction de chacun.
Pour le lecteur, au contraire, ils sont les lieux de représentation des coulisses de ces sociétés. Loin d’un réalisme qui décrirait abruptement les réalités sociales difficiles, ces discours rapportés débités sous le sceau de la marginalité, de l’alcool, du confinement des individus, font entrer une foule de personnages et de situations dans le périmètre étriqué et protégé de ces bars. La peur qui paralyse les Algériens, la misère qui jette ces Guadeloupéens dans une marginalisation mortifère, ces sociétés africaines bloquées par des systèmes politiques et sociaux écrasant les individus, ces dictateurs délirants, tous défilent dans une sarabande sordide mais éminemment tonique dans la forme littéraire. Les phrases et les chapitres se déploient dans tous les romans sauf dans Bord de canal où, à l’image des personnages, elles semblent bloquées.
À l’inflation des mots, à l’ampleur des récits qui se déroulent comme un torrent, répond le vide de ces vies : » On flottait dans la vie, paisibles comme un tas d’ordures à la dérive, l’esprit tellement engourdi que rien, pas même une cascade d’eau en rut, n’aurait pu nous mettre la panique aux tripes « . Les parenthèses ouvertes par les récits des uns et des autres se referment.
Ces bars semblent des métaphores de ces sociétés qui enferment leurs citoyens, les broient physiquement et psychiquement, leur laissant seulement la parole, mais une parole qui ne peut plus créer, qui ne subjugue plus : les conteurs sont là, (sur)vivants. Les auteurs infiltrent savamment le texte d’un intertexte fait d’histoire ou de littérature qui, par sa complexité, est en complète opposition avec la médiocrité des narrateurs. La liberté, l’inventivité, l’impertinence des auteurs est nichée là, au creux des récits rapportés.
À l’issue des échappées dans le monde des narrateurs-fabulateurs et de leurs collègues de boisson, reste » cette chose atrocement bête qu’on lance comme ça entre copains de galère : Raconte. « . Le lecteur aura compris, tout ne va pas dans le meilleur des mondes, ni au Congo, ni en Algérie, ni en Guadeloupe. Mais, et l’on s’en réjouira, la puissance du verbe fait toujours surgir les foules de personnages et de situations, les pistes entremêlées aiguisent l’acuité du lecteur qui se fait enquêteur, la » remontée des origines » permet de franchir les silences imposés par les conventions de toutes sortes. Comme les assoiffés du bar, on boit avec avidité jusqu’au bout de la nuit du texte, au risque d’imiter Verre cassé, qui se noie dans le fleuve au petit matin.
Sony Labou Tansi, Machin la Hernie, volume contenu dans le coffret de 3, uvres inédites publiées à l’occasion des 10 ans de la mort de l’auteur, Paris, La revue Noire, 2005.
Alain Mabanckou, Verre cassé, Paris, Seuil, 2005.
Boualem Sansal, Dis-moi le Paradis, Paris, Gallimard, 2003.///Article N° : 4158