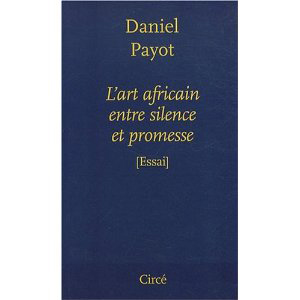Professeur d’esthétique et des théories des arts à l’Université de Strasbourg, Daniel Payot a vécu au Burkina Faso entre 2003 et 2007. De cette expérience est né un essai intitulé L’art africain entre silence et promesse. A partir du court métrage, Les statues meurent aussi (réalisé par Alain Resnais et écrit par Chris Marker en 1953), qui défend la thèse d’une liquidation de l’art africain par le colonialisme, Daniel Payot revisite le travail de Resnais et de Chris Marker en convoquant Walter Benjamin (L’uvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1935). Le Parallèle paraît osé, mais fécond. Il aide à penser de manière relationnelle. Texte à cheval entre l’esthétique, la philosophie, le cinéma et la littérature, L’art africain entre silence et promesse qui ouvre des chantiers fertiles aux études africaines, nous parvient en temps opportun : au moment où notre continent célèbre les cinquante ans de son indépendance. Rencontre avec son auteur.
A en croire Alain Resnais et Chris Marker, le film Les statues meurent aussi est né d’une interrogation : pourquoi l’art africain n’est-il pas au Louvre ? Avec l’ouverture du Musée du Quai Branly en juin 2006, la France a-t-elle répondu en partie à la question que se posaient Resnais et Chris Maker dans les années 50 ?
Je pense qu’il y avait chez Resnais la volonté de réhabiliter l’art africain, de lui faire reconnaître sa pleine valeur et en même temps, il s’est rendu compte que c’était un peu paradoxal, parce que plus on mettait ces statues sur un piédestal, plus on risquait de perdre leur spécificité. Le Quai Branly est un musée dédié aux arts premiers, un concept que Resnais ne pouvait pas connaître parce qu’il est relativement récent. On parlait encore d’art nègre à l’époque, puis, lorsque le mot nègre est devenu un peu péjoratif, on a parlé d’art africain, puis d’art primitif, mais on s’est rendu compte que » primitif » n’était pas judicieux
pour finalement arriver à la notion d’art premier. Mais Resnais ne pouvait pas s’en douter, parce qu’il était sur une bivalence : ou bien les civilisations ont été reconnues et donc elles pouvaient être au Louvre, ou alors elles étaient méprisées
Son combat a été un combat pour la reconnaissance. C’était aussi celui de la revue Présence africaine, qui avait passé commande du film et il me semble qu’au départ la motivation devait être celle-ci : puisqu’au Louvre on trouve l’Égypte, la Grèce, pourquoi on ne trouverait-on pas aussi l’Afrique ? C’est le point de départ du film, même s’il bifurque par la suite.
Les statues meurent aussi est en réalité un film sur la trahison
Exactement. D’ailleurs, je trouve très beau la façon dont le film se retourne contre lui-même. J’ai évidemment vu le film à de nombreuses reprises, mais je ne suis pas sûr d’avoir perçu cela dès la première fois. Je pense qu’avec Chris Marker, ils sont peut-être parmi les premiers à avoir compris cette ambiguïté-là. Quand on s’engage pour défendre les productions symboliques, on risque en même temps de les faire rentrer dans un discours de valorisation, qui n’est pas le discours des uvres elles-mêmes.
C’est alors me semble-t-il qu’intervient Benjamin dans votre analyse de ce film. Son texte intitulé L’uvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique est très connu, tout comme le film de Resnais. Comment se fait-il que personne, avant vous, n’ait jamais fait le lien entre ces deux productions ?
Je ne sais pas. On a toujours l’habitude de mettre les choses dans les tiroirs. Ce qui est intéressant dans le travail de recherche, c’est justement de faire communiquer les tiroirs. Là, pour Benjamin dont on a beaucoup parlé ces dernières décennies en France avec un peu de retard par rapport à l’Allemagne (mais une fois qu’on s’y est mis on s’y est vraiment mis), c’est devenu un auteur qu’il faut citer
Mais on a tendance à l’enfermer dans une certaine histoire : soit l’histoire d’un certain marxisme européen ; soit en rapport avec le judaïsme. J’avais des intuitions sur ce qui pourrait non pas rapprocher – cela n’aurait pas de sens – mais simplement faire communiquer, mettre en écho une certaine conception de l’histoire, qui n’est pas l’histoire progressiste, et qui a quelque chose à voir avec le messianisme juif dans cette idée d’interruption et ce discours balbutiant que les Européens tiennent sur l’Afrique ou sur d’autres régions du monde. Mais ce discours est parfois un discours d’intégration (il faut que l’on fasse entrer l’Afrique dans notre histoire) ou, au contraire un discours de distance ( » ça n’a rien à voir » et du coup on sacralise aussi ce qui se passe en Afrique). Mon essai, c’est surtout un livre de désarroi en quelque sorte : c’est plutôt moi, en tant qu’Européen j’allais dire » africanophile » (mais il se trouve que ce n’est pas un titre glorieux) qui suis désarmé devant des uvres d’art africain, parce que je sens très bien que le sens auquel elles appartiennent, le sens qu’elles véhiculent, m’échappe et m’échappera toujours. Et ce qui m’intéressait, c’était précisément cela : me servir en quelque sorte de ce désarroi premier pour essayer de comprendre ce qu’on pouvait faire de ces uvres tellement étrangères. Quel discours peut-on tenir sur ce que l’on ne maîtrise pas ?
Ce désarroi est fécond car il ouvre des pistes. Ce qui m’a frappé par exemple, c’est ce parallèle que vous établissez entre l’art africain et le cinéma des années 50-60 où il y a une présence un peu obsédante de la statue à l’écran
Au lieu de développer ce qu’on sait, on se confronte dans mon essai à une question. Je la pose durant mon séjour au Burkina Faso avec mes étudiants africains et, au fond, je sens qu’ils sont aussi désarmés que moi. Et puis, du coup, on est confronté à une distance, un écart et on tente de voir comment on peut non pas remplir cet écart car il ne sera jamais rempli mais ce qu’on peut y mettre. Alors, évidemment, on va chercher des matériaux extrêmement hétérogènes : l’histoire du cinéma, Benjamin, un peu de Deleuze
C’est un travail de tâtonnement.
Il y a aussi une dimension autobiographique dans votre essai qui commence comme un roman. D’emblée, il y a une personne qui prend la parole mais en même temps refuse de parler à la première personne. Pourquoi cette réserve ?
C’est complexe. Je suis philosophe de formation. J’ai enseigné la philosophie à des étudiants de philosophie pendant très longtemps et maintenant j’enseigne surtout dans des filières artistiques. Mais c’est compliqué, quand on est dans la philosophie, de jouer avec la fiction.
C’est pourtant ce que vous faites dans ce livre
Sans doute, mais ce n’est jamais évident. D’une part, il m’est difficile de m’installer dans la fiction, d’autre part cela m’intéresse parce que je suis un fou de littérature, au moins autant que de philosophie. Mais en même temps, je sens que je ne suis pas un auteur de fiction et donc je me contrains à trouver un biais, ce qui m’intéresse dans la fiction c’est une certaine façon vivante de se rapporter aux choses. Il y a quelque chose dans le concept qui me plaît énormément bien sûr, mais j’apprécie davantage le concept lorsqu’il est un peu charrié par la vie. Avant ce texte sur Les statues meurent aussi, j’avais écrit un essai intitulé Déroutements publié aux éditions L’Harmattan, que j’ai composé à partir de petits fragments de journal dans lesquels je me suis donné comme règle du jeu (cest le cas de le dire : ou plutôt de » non-je « ) de ne jamais parler en mon nom personnel : donc c’est toujours » il » et cela me permet de mélanger des choses extrêmement autobiographiques, parce que ce » il » est un » je » déguisé mais qui me permet aussi de temps en temps, dans d’autres fragments, d’inventer un » il » et de jouer sur cette indécision. Finalement, qu’est-ce que c’est qu’un » je « , ce n’est pas non plus une identité absolue. On est ceux que l’on rencontre, aussi.
On sent que le cheminement qui vous a mené à cet essai-recit marque une étape décisive dans votre parcours
C’est en effet pour moi un livre important, parce que j’ai passé quatre ans en Afrique : j’y étais déjà allé auparavant, mais pour des missions plus courtes. Là, quatre ans, je m’y suis vraiment installé et quand j’ai su que cela ne durerait pas, parce que mon contrat était sur le point d’expirer, je me suis dit que je ne pouvais pas repartir en Europe sans marquer d’une certaine façon cet épisode qui a été très important dans ma vie. Et comment pouvais-je le marquer ? En essayant de faire quelque chose que je savais un peu mieux faire que d’autres, c’est-à-dire de mettre un peu mes capacités de chercheur au service de quelque chose qui serait justement entre le concept et l’Afrique. D’où cette idée de récit et l’allusion aux étudiants.
Une autre question, très importante abordée dans votre livre est celle de » l’art d’aéroport « , qui montre bien l’extraversion économique de l’Afrique
Resnais pose ce problème et c’est même assez impressionnant de voir qu’il est déjà attentif à cela, car on pourrait se dire que la commercialisation n’était pas à l’époque aussi développée, mais je trouve que ce que dit le film sur ce sujet est tout de même très intéressant : Chris Marker le dit, ce sont des uvres qui sont faites pour des Blancs afin qu’ils puissent reconnaître l’image de l’Afrique qu’ils ont eux-mêmes.
Revenons-en à la littérature : je n’ai pas bien saisi le rapport entre l’art africain et le poète Francis Ponge
Ce qui m’intéressait chez Ponge, c’était l’idée du silence. Ponge était très désireux en quelque sorte que la poésie soit une façon de donner la parole aux choses elles-mêmes, et je trouvais cela intéressant
Évidemment, après, je me suis un peu laissé aller sur Ponge
Au départ, l’idée c’était celle-là : j’étais en face de ces statues africaines, que l’on fait parler dans des discours qui ne sont pas africains, mais qui en elles-mêmes restaient muettes. J’étais un peu dans la même situation que Francis Ponge quand il dit par exemple à ses auditeurs au cours d’une conférence : » vous voyez, il y a plein d’objets autour de nous, des chaises, des tables, et c’est nous qui parlons. Et qu’est-ce qui se passerait si l’on pouvait leur donner la parole ? « . C’était un peu cela les stratégies que nous tentions dans le cours avec les étudiants pour arriver à prendre langue avec les statues. C’était l’un des parcours possibles : est-ce que Ponge peut, dans ce qu’il appelle l’atelier, nous apprendre à nous mettre dans cette disponibilité au lieu de plaquer des discours sur les statues, pour que les statues elles-mêmes parlent ?
Et Deleuze, qui surgit vers la fin
Deleuze arrive sur le motif du cinéma. Il a consacré des pages très laudatives à Resnais dans son grand essai sur le cinéma et en même temps, il fait juste une petite allusion aux Statues
, et cela montre qu’il y a quelque chose qui ne s’embraie pas. Cela m’intéressait de le relever et, en même temps, Deleuze me permettait de suggérer une certaine conception du temps. Un peu comme Benjamin refusait la version linéaire de l’histoire, de même il y aurait chez Resnais, vu par Deleuze, une attention portée à la superposition de temps différents. Toute la question du cinéma étant justement de faire coexister, cohabiter des temporalités différentes. Or c’est un peu, toutes proportions gardées, la situation dans laquelle on se trouve par rapport à ces statues africaines qui appartiennent à des temporalités différentes – à la fois des temporalités africaines qui m’échappent doublement si je puis dire, et même des temporalités européennes, puisqu’elles n’ont pas toujours été considérées de la même façon, elles sont maintenant reconnues mais est-ce qu’on leur a pour autant donné la parole
Deleuze parle de » strates » et je trouve assez intéressante cette idée d’une uvre cinématographique qui parte vraiment du projet de mettre en scène ces différences de strates (c’est-à-dire leurs différences, mais aussi parfois leurs superpositions, leurs conjonctions
). Je trouve qu’il y a quelque chose de très littéraire dans ce que Deleuze raconte sur le cinéma de Resnais. D’ailleurs ce n’est pas très étonnant : Resnais étant un cinéaste très passionné par la littérature.
Le scénario du film écrit par Chris Marker est lui aussi remarquable
Il est très intéressant. J’espère que l’on aura la possibilité de le lire. Le texte a été publié par Chris Marker lui-même mais le livre est épuisé (1). J’avais proposé à l’éditeur de mettre le texte en annexe, mais il a trouvé qu’il méritait mieux que cela : l’idée était plutôt de voir avec Chris Marker et avec les éditions du Seuil si on ne pouvait pas suggérer une réédition du texte.
Par rapport à votre propre écriture, quel a été l’apport de Benjamin dans la rédaction de cet essai qui est aussi un texte littéraire ? D’autre part, dans quelle mesure le fait d’être professeur à l’Université de Strasbourg où Benjamin est enseigné depuis longtemps a-t-il contribué à cette inspiration du texte ?
Je commence par la deuxième question. À Strasbourg, on a eu à une certaine époque un département de philosophie très vivant, grâce à Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy et d’autres, qui ont su à faire converger des interrogations et des personnes qui venaient nous parler. Et, très étrangement, tout cela a commencé par une aventure très heideggérienne. Philippe Lacoue-Labarthe est resté très heideggérien dans ses écrits, même s’il s’agissait sans arrêt pour lui de prendre des distances avec Heidegger. En même temps, il y a eu toute une tentative non pas d’aller voir ailleurs mais de comprendre comment on pouvait déplacer. Mon choix à un certain moment a été d’aller plutôt vers l’École de Francfort. Et Benjamin est l’ange tutélaire qui peut permettre de passer de références philosophiques contemporaines, comme par exemple la phénoménologie, à l’École de Francfort. Benjamin est un passeur entre des spéculations philosophiques qui sont parfois très denses et des préoccupations politiques entre la philosophie et la littérature. Alors, oui, il est très présent, mais pas parce que je pourrais le résumer en quelques thèses ; ce n’est pas une adhésion idéologique, c’est plus un geste de pensée, un geste d’écriture. Je crois que c’est cela qui fait la grande force de Benjamin. Sur le plan thématique, l’une des choses qui continue à me travailler, c’est ce rapport à l’histoire et ce rapport au temps ; c’est parfois une allusion à cet Autre, cette altérité de l’Europe qu’est le judaïsme. Cela m’intéresse énormément : le judaïsme n’est pas ailleurs que dans l’histoire occidentale, il y est en plein cur, et en même temps c’est un centre qui est ailleurs et qui contribue très fortement à la production de la culture européenne. Sur cette question de l’histoire se greffe la question du messianisme qui m’intéresse beaucoup et qui, justement, est un messianisme de l’attente et pas de la réalisation, encore moins de l’incarnation. C’est un messianisme d’un messie qui n’est pas encore là. D’où cette thématique de la promesse que j’ai trouvée chez Chris Marker, qui pour moi avait tout de suite une coloration peut-être plus messianique et juive que ce qu’en faisait Chris Marker.
Avez-vous pensé en écrivant ce livre à l’essai de Daniel Bensaïd sur le messianisme dans la pensée de Benjamin ?
Il y a eu un moment dans la réception de l’uvre de Benjamin en France où cette question du judaïsme a été posée de façon très explicite. La première réception de Benjamin est plus politique (on mesure davantage l’éloignement de Benjamin vis-à-vis de thèses marxistes orthodoxes), ensuite, cela évolue parce que du coup cette distance qu’il prend par rapport au marxisme orthodoxe s’appuie sur une conception de l’histoire qui est différente. C’est quand même très étonnant de voir à quel point la conception de l’histoire qu’il développe dans les Thèses sur l’histoire de 1940 est justement éloignée de toute cette autre inspiration qui existe aussi dans le marxisme : le progrès, le progressisme où ce sont les contradictions elles-mêmes qui génèrent leur possibilité de dépassement. Et là on est dans une histoire qui est heurtée.
Pourquoi avoir convoqué Kakfa dans votre essai ?
Ah ! Kafka. Kafka est pour moi une référence constante depuis mon jeune âge. Il y a quelque chose qui continue à me passionner chez Kafka mais, là aussi, ce n’est pas une passion appropriatrice. J’ai l’impression qu’il dénoue toutes les certitudes ou toutes les illusions qu’on peut à un certain moment se forger. Pour moi Kafka, c’est l’écriture, pour dire les choses un peu bêtement, un peu radicalement. À chaque fois qu’on essaie de l’enfermer dans une position, une opinion, on retourne au texte et on voit comment au fond Kafka le dédouble. Et ce que dit Benjamin sur Kafka m’intéresse beaucoup – et là, il le judaïse vraiment : il dit le contenu a disparu mais il reste la transmission. Et la transmission, ce n’est pas simplement le moyen technique pour faire passer le message. la transmission, c’est le message en soi.
Il y a un auteur que l’on aurait pu penser rencontrer dans votre livre, un auteur à cheval entre la littérature, l’ethnologie et l’art : Michel Leiris.
Michel Leiris, je m’en suis beaucoup nourri à un certain moment. Là, il n’apparaît que par une allusion très éphémère. En même temps, c’est une autre époque, Leiris et L’Afrique fantôme. Je pense que ce que je dis à un moment, c’est que le titre est vraiment bien
[Rires].
On sent, en regardant le film de Resnais, qu’il y a cette idée de fantôme et de dédoublement du sujet par rapport à cet objet qu’est l’Afrique
Et Leiris était sans doute très impressionné parce qu’aujourd’hui on appellerait l’altérité. Cette mission à Djibouti était très partagée par des motivations diverses ; il arrivait quand même à piquer des uvres pour les mettre au Musée de l’Homme, dans une intention évidemment scientifique
mais c’était quand même une sorte de mainmise. Il y a des choses que raconte Leiris qui ne sont pas particulièrement glorieuses, par exemple la manière dont il arrive à tromper des chefs
Et en même temps, il y a chez lui un grand étonnement : on sent qu’il est habité par ce qui lui échappe. Parce qu’il s’intéresse aussi à la langue (quand il fait des transcriptions par exemple). Il est donc en relation avec les gens qui lui parlent une langue qu’il ne maîtrise pas, mais il mélange aussi de l’affectif, surtout quand il se retrouve en Éthiopie
Votre livre fonctionne comme une maïeutique. Qu’est ce qui est l’origine d’une telle structure ? Est-ce la peur de l’altérité ?
Ce n’est pas une peur. C’est une façon de mettre la distance. Deux autres références qui pour moi comptent beaucoup, Levinas et Blanchot, parlent de la relation pédagogique en insistant sur la distance, en disant que ce qui se passe quand on est en train d’enseigner, ce n’est pas un rapprochement, comme on le dit souvent, mais au contraire cette distance, qui est évidemment féconde. Je l’ai beaucoup ressenti dans mon métier d’enseignant et particulièrement lorsque je me suis retrouvé devant une classe d’étudiants en deuxième année de philosophie au Burkina Faso. Arrivant à Ouagadougou, je me retrouve devant cette classe à laquelle je suis censé parler d’esthétique mais je ne sais pas quelles références ils ont. Je me suis dit que d’un point de vue herméneutique, il y aurait forcément des différences : le parti pris étant que ces différences soient des richesses et pas du brouillage. Cela a été mon expérience, et j’ai adoré cela. Dans un contexte où il y a une façon quand même très autoritaire de faire cours : on prend un auteur, on dit quelle est la doctrine, j’arrivais avec des textes, je les photocopiais, les donnais aux étudiants et leur disais : bon, voilà, que fait-on de ce texte-là ? Je me rappelle, les premiers temps, je leur donne un texte de Platon par exemple et l’étudiant commence par me faire dix minutes sur Platon, sa vie, son uvre. Alors je lui dis : très bien, mais le texte, là, qu’est-ce qu’il dit ? Et j’ai senti que je pouvais apporter quelque chose dans ce rapport-là au texte. Pas pour arriver à saisir ce qui serait la vérité intrinsèque du texte, mais au contraire, pour montrer qu’un texte bouge, que l’on peut y entrer de diverses façons, que l’on peut le confronter avec d’autres, etc. Je me suis rendu compte que pendant assez longtemps, je n’avais pas trouvé le moyen de faire entrer cette dimension dans la façon d’écrire mes textes, qui était trop conceptuelle, théorique. Et là, je me suis autorisé en quelque sorte
D’où ce côté que vous appelez maïeutique : on est ensemble, confronté à une question qui nous échappe, qu’est-ce qu’on fait ? On n’a pas d’obligation de réussite, on peut suivre une voie et finalement ne pas trouver la réponse qu’on voulait
Resnais a fait des films sur l’art, Guernica (1949) par exemple
Qu’est-ce qui distingue Les statues meurent aussi de ses autres films ?
Ce qui le distingue, c’est que Resnais s’est fait embarquer par l’Afrique
Resnais a fait des films sur des artistes qui ne sont pas des films conventionnels. On sent déjà une écriture cinématographique qui se cherche encore (cf. les courts-métrages du début de son uvre), mais on sent qu’on est plutôt du côté de l’écriture, du plan, du rapport entre le clair et l’obscur. Ces films sont très intéressants de ce point de vue. Mais sur leur contenu, cela reste des films consacrés à tel ou tel artiste. Guernica, c’est autre chose, parce qu’on ne peut pas simplement considérer l’uvre de Picasso comme une uvre parmi d’autres : il y a toute l’histoire qui est là, on commence à entrer dans ce rapport entre l’art et l’histoire, où ce qui est intéressant c’est que l’art ne récupère pas ses billes, l’art se laisse aussi convoquer et inquiéter par l’histoire. Ce qui me gêne un peu dans Guernica (le film), c’est son ton emphatique. On sent que c’est un ton qui montre le désastre du massacre de Guernica, qui a vieilli. Je suppose qu’on ferait maintenant un film plus heurté, plus fragmentaire
Le ton emphatique du commentaire restitue une linéarité. Ce qui me plaît particulièrement dans Les statues meurent aussi, c’est que justement cette machine à produire de la linéarité se bloque tout de suite. Et se bloque dans un des tous premiers plans où on voit cette jeune personne dans un musée avec la vitre
on a l’impression qu’elle cherche un mode de reconnaissance, un peu comme si elle cherchait à se voir dans un miroir. Et le miroir à la fois lui renvoie quelque chose tout en restant une vitre derrière laquelle il y a une uvre qui n’est pas non plus un portrait ou un autoportrait. Et là, un coin est enfoncé et le film ne récupère plus, sinon in extremis en parlant de promesse et d’unité des Blancs et des Noirs. Ce qui est très beau politiquement et » messianiquement « , mais, en même temps, ce n’est pas dogmatique, ni structurant dans la mesure où cela ne lui donne pas d’homogénéité mais au contraire l’ouvre
Mais ce film a peut-être échappé à Alioune Diop, son commanditaire. C’est ce qui est beau. Par ailleurs, il y a un autre aspect de votre livre qui me frappe : vous n’insistez pas sur l’aspect cultuel de l’art africain
Ce que je peux dire du lieu d’où je parle, c’est qu’évidemment cette dimension cultuelle est essentielle puisqu’elle donne leur identité aux objets, mais qu’en même temps, c’est un aspect que je ne maîtrise pas. Le fait d’avoir vécu en Afrique et de m’y être intéressé, m’a montré encore plus que je ne pouvais pas m’aventurer sur ce terrain. Parce que j’en ai quand même beaucoup discuté avec des Africains et pas seulement dans le milieu universitaire. On sent bien que même de la part d’Africains qui sont intéressés par cela, qui savent ce qu’ils ont à faire quand ils sont dans des funérailles par exemple, même là, il y a plusieurs niveaux de discours : il y a un niveau où ils sont eux et ils savent que les initiations peuvent aller plus loin ; et ils savent aussi qu’ils n’ont pas à parler de cela à quelqu’un qui arrive de l’extérieur. Il y a donc quelque chose de très important dans cette dimension cultuelle, qui est aussi ce que l’on ne dit pas. De la part d’un Européen, s’aventurer sur ce terrain-là, requiert d’être dans une situation exceptionnelle ou avoir des compétences particulières : ce qui n’est pas mon cas. Je préfère que cet aspect-là en rajoute dans l’opacité du silence que ces statues m’adressent en quelque sorte. Ce qu’elles m’adressent, ce n’est pas une parole que je puisse entendre clairement, ce n’est pas un silence de l’indifférence, mais c’est une épaisseur : elles ont énormément de choses en elles et en même temps, cela est inaccessible. Leur apparence physique en quelque sorte est aussi empreinte de tout cela. Évidemment, c’est là qu’on voit l’incompatibilité avec l’art d’aéroport. Même sur place, chez des Européens qui s’intéressent à l’Afrique, il y a des masques achetés à l’aéroport ou ailleurs et quelquefois, je me dis : quelle est la différence entre ces masques et ceux que j’ai pu entrapercevoir parfois ? La différence est là : c’est que le masque d’aéroport, au fond, il sait quelle langue il parle, alors que l’autre, c’est quand même beaucoup plus compliqué.
Le titre L’art africain entre silence et promesse résume finalement un peu votre itinéraire. Qu’est-ce que ce séjour en Afrique vous a apporté ?
Je ne suis pas sûr d’en avoir encore fait le bilan Je suis parti l’été 2007. Au départ, j’étais parti non pas pour enseigner, mais sur un programme de coopération du ministère français des Affaires étrangères pour le développement des universités au Burkina Faso. Mais arrivé à Ouagadougou, j’ai retrouvé des gens de l’Université que je connaissais, qui ont pour certains été étudiants à Strasbourg où je vis, et qui m’ont dit : » maintenant que tu es là, viens nous donner un coup de main à l’Université « . J’ai du mal à parler de l’Afrique en général, car le Burkina c’est aussi un pays qui a des particularités et qui, je crois, sait d’une certaine façon convertir ses faiblesses énormes (l’un des pays les pauvres du monde, pas de richesses naturelles conséquentes
) en relations humaines : c’est une chose qui m’a totalement saisi. On a eu beaucoup de discussions avec les intellectuels africains là-bas. On est tous ainsi, on insiste beaucoup sur nos défauts : ils évoquaient ce qui n’allait pas, une certaine irrationalité des choses, et moi je leur disais de ne pas oublier le côté humain. On parlait de ce livre qui m’avait beaucoup intéressé il y a quelques années d’Axelle Kabou Et si l’Afrique refusait le développement ? Nous étions était un petit groupe de Français qui voulions discuter avec des collègues africains de ce genre de choses. Et cette question-là de savoir si en tant que coopérant, on n’était pas entrain de faire comme s’il y avait un modèle de développement presque inévitable, est-ce qu’on n’est pas entrain de dire aux gens : » voilà, vous faites cela ou bien, comme dit l’autre, vous n’êtes pas encore entrés dans l’histoire
» Et je crois que l’on peut aussi envisager un avenir basé sur les points forts, qui ne sont pas des points forts économiques, commerciaux, etc. mais qui sont aussi des points forts humains. Je ne suis pas inquiet, ni » afro pessimiste « , mais je trouve que c’est un vrai problème. Je ne suis pas le mieux placé pour le poser, c’est évidemment aux Africains eux-mêmes de le traiter. Mais je suis assez sensible à cette question. N’a t-on finalement que des intérêts à aller dans le sens des rationalités économiques qui sont les nôtres en Europe quand on voit aussi tout ce que ça produit ? Surtout si c’est au prix de déstructurations de communautés ou d’une certaine conception de la famille. Je ne me sens pas autorisé à tenir un discours là-dessus même si cela passe aussi dans mon rapport à l’Afrique et en même temps ça m’intéresse. Je n’ai pas une position très affirmée, très claire là-dessus.
L’art africain entre silence et promesse, Paris, Ed. Circé, 2009
1. Chris Marker, Commentaires. Paris : Seuil, 1961