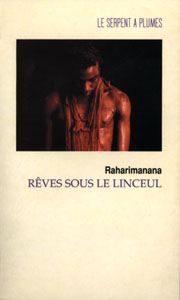L’Afrique séduit : les éditeurs parisiens s’arrachent ses auteurs les plus prometteurs, malgré l’indifférence de la critique littéraire. Mais soutiennent-ils vraiment leurs auteurs ? Pour répondre, une revue de détails menée par Soeuf Elbadawi et les réponses de Denis Pryen aux attaques dont il fait l’objet.
Le signal serait venu du public, devenu tout d’un coup boulimique d’histoires africaines. Un conte de fées qui aurait commencé en 1998, avec le succès inattendu du vieux Kourouma au Seuil. En attendant le vote des bêtes sauvages, son troisième roman en trente années d’écriture, aurait donné le la, prélude à une valse de prix inattendus : du Renaudot pour son tout dernier, Allah n’est pas obligé, au tout récent Fémina à Marie Ndiaye.
On parle désormais d’un « meilleur accueil ». Finie l’époque où les quelques critiques parisiens interpellés sacrifiaient le littéraire pour ne voir que l’aspect ethnologisant des uvres. Rencontres, débats et colloques se multiplient au chevet de cette littérature dont on découvre qu’elle renouvelle l’imaginaire du monde. L’offre est abondante sur le marché « officiel », même si quantité ne rime pas toujours avec qualité. L’abondance en tout cas n’a jamais nui. Sans compter que ce nouvel intérêt semble occasionner bien des remous et des redéploiements dans des maisons au renom indiscutable. Gallimard ou Le Serpent à Plumes bataillent autour de certains auteurs : le premier aurait ainsi ravi il y a plus de deux ans son meilleur poulain au second, à savoir Waberi(1).
Reste que ce tableau est un peu tracé à la va-vite. La réalité est autrement plus complexe. Lorsqu’on parle de public, on omet de parler des chiffres. Un bon auteur est pourtant un auteur qui tourne bien en librairie. A l’époque de la world music, world cuisine, world fiction, etc., l’indifférence exprimée naguère face aux expressions littéraires ou artistiques des terres anciennement colonisées n’est plus de bon ton. Certes. La grande vague des « exotismes cultivés à outrance » a aussi laissé place en Europe à une consommation culturelle plus sereine, moins marquée par « les démons de l’histoire ». Le public demande à rencontrer les cultures de l’Autre dans un esprit d’échange et non de domination. L’Afrique n’est plus tout à fait le pays de la « sauvagerie ou du mystère ». Son potentiel culturel, à l’heure de l’américanisation des esprits, ouvre de possibles exceptions culturelles. Elle détiendrait, affirme-t-on sans ciller, les secrets de la vraie vie sur une planète en ébullition où s’effacent des tas de valeurs essentielles.
Vraies ou fausses, ces croyances constituent un credo séduisant pour les opérateurs culturels du Nord, éditeurs comme producteurs. D’autant plus que cette Afrique n’a pas les moyens d’exploiter cette manne depuis ses terres. D’ailleurs, être publié à Paris permettra souvent à l’écrivain de mieux partir à l’assaut de son « public originel », étendu au Continent grâce notamment aux CCF.
En musique par exemple, Paris fut au début des années 80 la capitale de la sono mondiale, boostant par la même occasion la carrière de nombre d’artistes africains. Un certain cinéma du Continent n’a pu voir le jour que grâce à ce mouvement Nord-Sud. Raison de plus pour que la littérature ne déroge pas à cette règle. Rien de nouveau sur ce plan. Ce marché se souvient encore des pionniers : Fasquelle publiait Birago Diop dans les années 40 (« Les contes d’Ahmadou Koumba »), Flammarion signait Cheik Hamidou Kane au début des années 60 (« L’Aventure ambiguë ») et Présence Africaine, surnommée « l’ancêtre », uvre depuis la fin de la seconde guerre mondiale (2). Mais l’aventure s’est toujours révélée peu rentable, mises à part quelques uvres devenues des classiques et qui se sont vendues dans le long terme plutôt qu’au moment de leur sortie. Les autres ouvrages ont fini la plupart du temps au pilon.
Le schéma est plus que connu de nos jours. Un lectorat africain démuni ne peut acheter les livres. Quant au public français, il se montre peu interpellé par une « sous-littérature faite par d’anciens colonisés ». Question de priorité matérielle pour les uns et d’inconscient formaté pour les autres. Paris surprend néanmoins les habitués du genre dans les années 70 avec l’arrivée de l’Harmattan dans les librairies. Une nouvelle ère commence alors pour les nouveaux talents littéraires à promouvoir. Une nouvelle génération d’auteurs voit en l’Harmattan, d’où partiront dans les années 80 les fondateurs de Karthala et de Sépia, un « tremplin nécessaire ».
Les choses ne changent pas pour autant. Editer un auteur d’Afrique reste toujours un métier à risque. Cependant, à la faveur du succès des musiques du Continent, de la multiplication des échanges culturels et de la transformation apparente des mentalités du seul public solvable [occidental], se distingue depuis le début des années 90 une génération d’auteurs dont les thèmes embrassent plus le global que le local. Ils intègrent -affirme-t-on- leur environnement géographique immédiat (certains vivent en Europe depuis 10 ou 15 ans) à leur imaginaire romanesque et expriment leur double appartenance culturelle (écriture des deux rives), participant de fait à la dynamique de métissage de plus en plus prisée de par le monde. Ils ne renient pas leurs cultures d’origine mais refusent de se plier au jeu des identités fixes. Leur littérature amène la fiction française à se montrer plus ouverte, moins cérébrale et moins formaliste. Ce qui aurait changé la donne.
En vérité, le public s’est renouvelé et se montre de plus en plus demandeur d’écrits venant d’ailleurs. Affaire de génération peut-être, nouvelle ère en tous cas. Conséquence : les ventes décollent légèrement dès le début de ces années 90. Et les maisons d’édition parisiennes réagissent naturellement, comme par opportunisme. Gallimard, Le Serpent à Plumes, Actes Sud, mais aussi Dapper et autres Moreux viennent concurrencer Présence Africaine et L’Harmattan sur leur terrain. Avec des collections aux dénominations bien connotées comme « Afriques », « Continents Noirs », « Archipels littéraires », etc.
C’est dans ce nouveau contexte parisien des lettres d’Afrique que s’établiront les succès de l’Ivoirien Kourouma. Un phénomène à classer pourtant dans le temps qui passe, bien que le talent qui l’accompagne soit réel. L’engouement du public pour la littérature d’Afrique évoque celui dont ont bénéficié les littératures caribéennes ou latino-américaines quelques années auparavant. Jeux de mode. Mais pour qu’un auteur comme Kourouma demeure à l’affiche en France, il faut que sa maison d’édition s’en donne les moyens : campagne de promotion offensive, service de presse rôdé à ce type d’écriture, séduction des principales signatures de la critique parisienne, copinage sérieux avec le monde des médias
Il ne s’agit pas de talent ici, mais de marketing. Pour imposer un auteur, il faut matraquer l’opinion. Dans un espace littéraire où tout est à faire vu les le retard accumulé par les aînés depuis des années, les maisons parisiennes hésitent et cela peut se comprendre.
Ainsi de Kourouma. Après le succès de son troisième roman, le Seuil s’est particulièrement démenée pour le suivant. Allah n’est pas obligé. Mais l’éditeur a-t-il vraiment essayé de promouvoir La Polka ou La Fabrique de cérémonie de Kossi Efoui avec autant d’acharnement ? On nous répond que « le succès tient à très peu de choses » et qu’on ne peut pas trop « expliquer pourquoi c’est ce livre et pas l’autre qui séduit les gens ». Il s’agirait, au-delà du thème évocateur contenu dans l’uvre (les enfants-soldats pour ce dernier Kourouma) d’un mystère impénétrable. Par ailleurs, « comment voulez-vous miser en promo pour un auteur qui ne vendra pas plus de 500 exemplaires? » nous a-t-on interrogé en retour dans une maison concurrente. « Cela ne correspond même pas à un succès d’estime dans le microcosme parisien. Il faut que les auteurs arrêtent de jouer les victimes pour reconnaître qu’ils n’ont pas de lectorat, pour reconnaître surtout que c’est nous qui prenons tous les risques ». Les espoirs africains qui atteignent 1500 ou 3000 exemplaires à leur sortie sont des prodiges, voire des miraculés sur la place de Paris. Autant dire qu’ils sont rares.
Les auteurs, eux, plaident non-coupables et pensent jouer les victimes à raison. Ainsi, ce jeune enseignant, dont le succès d’estime dépasse largement le milieu littéraire africain, mais qui désespère de toucher un jour un plus large public : »Nos livres, nous les voyons partir dans les différentes rencontres auxquelles nous participons. A force, on finit par se dire que les éditeurs nous mentent. Les lecteurs, que nous rencontrons dans les débats et qui achètent nos livres, ne représenteraient pas grand chose à une échelle importante. Mais comme ceux qui nous écoutent donnent l’impression de n’attendre que ça, pourquoi ne pas nous exposer un peu plus vers le grand public? Il y a un truc qui ne colle pas dans le discours des éditeurs. Ils veulent bien vendre mais ne veulent pas se risquer »
On pourrait aussi citer cet auteure gagnée par une certaine lassitude : « Ce n’est pas très motivant. Au-delà du petit prestige que nous accorde le petit milieu littéraire afro-parisien, nous ne gagnons rien ou pas grand-chose. Je vous mets au défi de me trouver un auteur qui vous parlera en bien de ses rapports financiers avec sa maison d’édition. On ne touche quasiment pas ou très peu d’argent sur la vente de nos livres. Les chanceux parmi nous se comptent sur les doigts d’une main. Et on se surprend à penser que si les éditeurs nous considéraient au même titre que les autres auteurs européens, c’est-à-dire comme des vaches à lait possibles, cela irait nettement mieux. Car ils prendraient alors de vrais risques commerciaux. Mais ce n’est pas le cas. Souvent, ils ne nous utilisent que pour mettre un peu de vernis dans leurs collections. Un peu comme de l’édition humanitaire. En fait, ils ne nous considèrent pas comme de vrais écrivains. Nous ne sommes que des Africains pour eux. Et les Africains ne pourront jamais écrire comme les auteurs du cru ».
Relativisons donc l’engouement parisien pour les auteurs du Continent. Il s’agirait juste d’une spéculation ponctuelle sur des talents en provenance d’Afrique. Une spéculation qui aura sans doute renforcé la présence africaine (meilleure visibilité, y compris de la partie anglophone et lusophone) dans les librairies françaises. Ce ne sont plus les maisons spécialisées qui l’emportent cependant, mais les collections spécialisées : prière de saisir la nuance. « Mais il vaut mieux ça qu’autre chose, conclut notre interlocuteur. L’Afrique ne nous propose rien à la place. Et ici au moins, on est sûr d’être lu par quelques uns et de ne pas écrire en vain. D’autant plus que les Français ne veulent plus être en retard par rapport à d’autres capitales européennes. Si on prend l’exemple de Londres, vous verrez que les Anglais ont plus de respect pour quelqu’un comme Nuruddin Farah ou Tutuola. Là-bas, un auteur d’origine africaine peut faire la Une d’un quotidien national. Ici, les critiques n’ouvrent même pas le livre, tellement ils sont persuadés qu’on ne le mérite pas. Il y a encore du chemin à faire. Mais nous avons toute la patience du monde ».
Au menu donc des récriminations portées contre le microcosme de l’édition française : l’ethnocentrisme des uns et le mépris des autres qui contribuent au développement d’un fort « tropisme » parisien (3). Mis à part une petite poignée d’éditeurs faisant figure parfois de prosélytes, les autres acteurs du milieu continueraient ainsi à considérer cette littérature comme négligeable, périphérique, secondaire. Résultat des courses : les auteurs en sont encore à courir après une ultime reconnaissance, même s’il est vrai qu’ils en vendent un peu plus aujourd’hui qu’hier. Le temps n’est pas si loin, où la négritude protestait contre la marginalisation manifeste des intellectuels et des créateurs africains sur la place de Paris. En d’autres termes, Kourouma ne serait qu’un phénomène éditorial. A moins que l’histoire nous prouve le contraire
1. Cf. Bernard Loupias, « Il souffle sur l’édition française un vent d’Afrique », Le Nouvel Observateur
», 15-21 juin 2000.
2. Cf. Notre Librairie : « Editions des littératures africaines en France : mutations et perspectives », notamment l’article d’Alain Mabanckou.
3. Article sur l’édition francophone de Caroline Koch, MFI N° 347 du 25/05/01.///Article N° : 2085