Festival d’Ile de France 2003
Le Festival se déroule dans les lieux du patrimoine francilien, lieux de mémoire, églises, abbayes, châteaux, théâtres, cirque, sur le thème du Paradis et ses jardins… L’édition 2003 invite l’Algérie. Attention : soirée du 4/9 annulée !
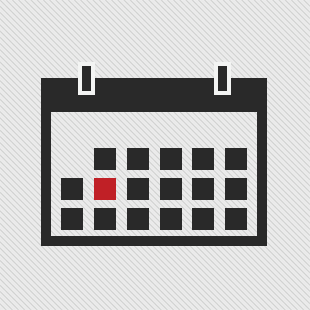
Festival
du 03 Septembre au 12 Octobre 2003
Horaires : 00:00
Horaires : 00:00
Musique
Renseignements-Réservations : 01 58 71 01 01
Français
Musiques traditionnelles et populaires d’Algérie
Mer. 3 au sam. 6 sept. 20h30
Cabaret Sauvage, Parc de La Villette (75)
Mercredi 3 septembre : soirée chaâbi
Tradition d’Alger
Brahim Bey, chant et mandoline (chaâbi d’Annaba)
Ammar El Achab (chaâbi algerois)
Hasnaoui Amechtouh (chaâbi kabyle)
Orchestre arabo-andalou de Hamaï Mebrouk
Jeudi 4 septembre : soirée malouf > Soirée annulée !
Tradition de Constantine
M’barek Dekhla, violon et chant (malouf d’Annaba)
Dib el Ayachi et Cherif Zaârour (malouf constantinois)
Hamdi Benani, chant, violon
Vendredi 5 septembre : soirée hawzi
Tradition des faubourgs d’Alger
Hamidou
Naïma el Djazairia
Orchestre arabo-andalou de Hamaï Mebrouk
Samedi 6 septembre : soirée raï
Tradition d’Oran
Femmes Medahatte et Rokia (Sidi Bel-Abbes)
Cheb Abdou
Parc de Villarceaux, Chaussy (95)
Dim. 7 sept., parc et restauration (méchoui) à partir de 12h30 – concerts à partir de 14h
Fêtes des villages et du désert saharien
souk, tentes, restauration orientale, ateliers pour les enfants…
Idhebalen de Tizi Ouzou, percussions et danses de mariages en Kabylie
La fête kabyle
Iddebalen de Tizi Ouzou
En kabyle, fête se dit tameghra ou, lorsqu’on évoque une atmosphère de liesse, « fichta ». Dans cette région montagneuse, arboricole (figuiers et oliviers essentiellement) et farouchement attachée à son identité amazigh (berbère), située dans le nord-est de l’Algérie l’expression corporelle et les chants, sont souvent bâtis autour de textes à la poésie très subtile et métaphorique sont autant d’images en parfaite harmonie avec les paysages kabyles marqués par ce gris lumineux du ciel aux abords de la mer lorsque s’y fondent les reflets des neiges du Djurdjura. C’est aussi cette fuda (pièce de tissu) à rayures rouge et jaune, nouée autour des reins des femmes en surimpression sur le taqendurt (robe locale), que l’on remarque le plus lors des instants festifs.
Pendant l’ourar » (littéralement : jeu, autre variante de « fête »), ce sont les « iddebalen », groupes de musiciens constitué de deux « ghida » (sorte de cornemuse) et de un ou deux « tbel » (tambour), qui font l’ouverture sous les youyous stridents des femmes. En général, un orchestre « moderne » prend le relais et les réjouissances peuvent durer jusqu’à l’aube.
En Kabylie, la danse se pratique surtout à l’occasion des saisons de mariages et de circoncisions, du muwsem (fête religieuse) ou de la fin de la cueillette des olives. Mais en fait, tout est prétexte à un déhanchement frénétique. D’après un ouvrage de Djamila Henni-Chebra et Christian Poché, « la danse kabyle est considérée comme l’une des plus difficiles à exécuter ». Elle est également originale et se traduit par un mouvement continuel et très vif des hanches, du ventre et des fesses, sur fond de rythme en 6/8 ou sur le mode berwali chez les citadins. Lorsque la danseuse n’arrive pas à obtenir ce tremblement fiévreux des hanches, elle ceint celles-ci d’un foulard puis, « afin d’accentuer les secousses, elle ponctue d’un à-coup chaque fin de strophe en fléchissant le genou ». Cet ensemble de Tizi-Ouzou, capitale de la Grande-Kabylie, en est la plus parfaite des illustrations, sans » folklorisme » aucun.
Ensemble de zornas flûtes de Ghardaïa
Le mot ahallil désigne à la fois un genre musical et le groupe qui le pratique. Ces chants foisonnent de prières, de suppliques et de refrains où Dieu est glorifié dans son unicité. L’ahallil demeure avant tout une musique et un ballet propres au Gourara, une région du sud-ouest algérien, qui compte une centaine d’oasis habitées par les Zénètes (Berbères du Sahara).
Cette sorte d’opéra sacré saharien, représenté ici par Mabrouka Billal et la formation Ahallil, originaires de la ville rouge-ocre de Timimoun, s’exécute de préférence de nuit. Un groupe d’hommes se réunit en plein air et forme un cercle, au milieu duquel se tiennent un abchniw (poète et chanteur soliste), un flûtiste, un joueur de gumbri (instrument à cordes) ainsi que des percussionnistes utilisant tambour, pierres et mains. Ils répètent en chœur d’une voix grave, les complaintes aiguës du soliste, faites de suppliques ainsi que de quêtes de pardon et de grâce.
Dans un enchevêtrement subtil, l’ahallil fait cohabiter sacré et profane. La musique s’adresse à l’ensemble du corps devenu toute ouïe, et les chants évoquent un passé glorieux, ou disent les espérances et les inquiétudes. En intercalant le rappel de préceptes religieux avec le récit de batailles mémorables, l’ahallil contribue ainsi à maintenir la mémoire collective du groupe.
Z’hour et Les Fqirets d’Annaba, chant et târ et bendir percussions
En arabe, le terme « fqir » désigne le pauvre autant au sens originel du terme que dans une perspective religieuse. A Annaba, la coquette ville côtière de l’est algérien, le fond de l’air musical est au malouf, cet excellent dérivé de l’art arabo-andalou. Mais, dans la cité chère au berbère Saint-Augustin (il en fut l’évêque à l’époque où elle s’appelait Hippone), le chant sacré occupe également une place de choix. Il est souvent le fait de femmes et on peut l’entendre lors des « ziara » (visites aux saints patrons locaux) ou à l’occasion d’autres festivités louant Allah et son prophète). Les chants, accompagnés uniquement au « târ » (tambourin muni de cymbalettes) et au « bendir » (tambour sur cadre) débordent parfois le cadre religieux pour s’intéresser à la vie sociale. Z’hour et son ensemble jouissent d’une excellente réputation dans leur région.
Groupe Rouisset de Ouargla, danses de combat
Le mot « baroud » est entré depuis belle lurette dans la langue française, mais avant toute connotation guerrière, il désigne d’abord une cérémonie qu’on retrouve autant à l’ouest qu’à l’est de l’Algérie. Elle prend une dimension particulière à Ouargla (800 km au sud d’Alger), ici avec le groupe Rouisset. Au commencement, il y a le cercle protecteur, ensuite on retrouve des hommes, épaule contre épaule et fusil chargé, qui vont tourner autour d’un groupe composé de percussionnistes avant de lui faire face en chantant d’une seule voix. Puis, les percussionnistes se mettent à tourner, en sens inverse, élargissant le cercle de la danse, tout en maintenant le tempo jusqu’à la transe finale.
A un moment donné, les tambourinaires sortent du cercle où seul en piste, le maître de cérémonie va, suivant une technique bien rodée, donner le top au coup de feu. Ce rituel bien ordonné exige, pour être réussi, une minutie dans le moindre geste. Comme dans un hold up parfait, il faut être synchro.
Marzoug de Biskra, chant, chekwa cornemuse, qarqabou crotales, tablas
Il s’appellent Marzoug, en référence à une de ces nombreuses branches de la grande confrérie de Sidna Bilal, du nom du premier muezzin noir de l’islam, nommé par le prophète Mohamed. Au Maroc, ces populations venue de l’ancien Soudan occidental, avant d’essaimer dans tout le Maghreb, sont désignées sous le terme « gnawa » mais, dans le sud algérien, ils sont connus sous la dénomination « abid », « bousaâdia » ou « Ouled Baba Merzoug ».
A Biskra, grande palmeraie du sud-est algérien qui avait inspiré le peintre Etienne Dinet et fasciné Oscar Wilde, et en d’autres lieux, on dit que l’adoption d’un tel nom était une façon de se placer sous une bonne augure car « marzoug » signifie chanceux ; d’autres affirment qu’il s’agit d’un esprit, ainsi dénommé, parce qu’il procure la fortune à ceux qui se mettent sous sa protection. Mais ce que l’on retient le plus, c’est le « diwân », veillées nocturnes, des adeptes, perpétués par la troupe Marzoug. Il consiste en des louanges (ou salutations) appuyées au prophète et à l’ancêtre mais il ne dédaigne pas le profane sous forme de « ghazal » (soupirs d’amour). Les chants vibrent au son des percussions, des « qraqeb » (crotales en métal) et surtout des « chakwa », un instrument de la famille des cornemuses propre à la région de Biskra.
Ouled Aïssa El Djarmouni d’Oum El Bouagui, musique chaoui des Aurès, danse de la jument
La troupe Ouled Aïssa El Djarmouni d’Oum El Bouaghi s’inscrit dans la plus pure tradition musicale chaouïa, marquée par cette figure emblématique que fut Aïssa El Djermouni, premier Maghrébin à fouler les planches de l’Olympia, en 1917. De ce père spirituel, elle a hérité de l’amour pour la mélodie et le sens du rythme propres au genre rehaba, né sur les pentes abruptes du massif berbérophone des Aurès, à l’est de l’Algérie.
Il s’agit d’un chant en groupe, ouvrant sur diverses danses rythmées, dont la plus fameuse dite « de la jument », par le bendir et les pieds qui frappent le sol. Rehaba, signifiant ensemble, comprend le ferdi ou vocalises en solo accompagnées par une gasba (flûte de roseau) et un bendir (percussion). Le tout est agrémenté par divers modes et thèmes musicaux comme le s’raoui, le b’hairi, le djebaili, le rekrouki ou le s’laoui.
Aïn Sidi Mebarek de Kenadsa, danse du marié (gnawa, Sahara Saoura)
Kenadsa, cité proche de la métropole Béchar, a été la première ville houillère, à ciel ouvert, du sud-ouest algérien, mais aussi la place-forte d’une confrérie mystique. On y vient donc, parfois de loin, pour chercher un emploi dans les mines ou pour visiter la zaouïa, fondée par Sidi El Hadj Ben Ahmed. La musique, pratiquée dans cette cité cosmopolite, s’est enrichie de divers apports, issus du Maroc voisin (le célèbre chanteur Hocine Slaoui y avait travaillé comme mineur), de Tlemcen, berceau du hawzi (chant des faubourgs populaires), d’Alger qui y a déposé son chaâbi (populaire citadin de la casbah) et des soufis locaux.
La musique locale est connue sous le nom de Ferda et, traditionnellement, seuls des instruments de percussion, comme le târ (tambourin pourvu de cymbalettes), la taâridja (petite derbouka) ou le mahraz (pilon) ponctuaient le chant. Avec d’autres variantes, l’ensemble Aïn Sidi Mebarek excelle particulièrement dans la danse et notamment la toujours attractive gestuelle du marié, censée encourager l’heureux élu et le débarrasser de sa timidité et de son inhibition, peu avant sa nuit de noces.
Danse de nakh (chameau) de Oued Souf, danse du chameau (Sahara soufi)
El Oued, tout au fond du Sahara, est surnommée, à juste titre, la ville aux mille coupoles. Peuplée par des tribus d’origine arabe, elle tient à son caractère pieux et au terme « souf » (laine, celle que portaient les mystiques). Mais n’allez surtout pas croire que la région est morne et compassée car elle connaît la fièvre du jeudi soir (jour de repos en terre musulmane) comme ses autres voisines de palmier. Que ce soit lors des saisons de mariages, de fêtes privées et publiques ou au cours, osons, du repos « hebdromadaire », tout est prétexte à des ondulations du bassin et à des chants qui s’adressent autant aux hanches qu’à l’ouïe, sur des rythmes qui épousent souvent le pas du chameau.
R’Guibet de Tindouf, danse des femmes au mains peintes (Sahara)
Le nom des R’Guibet (transcrit également par Regueibat ou R’Gibat) renvoie à une tribu maure, d’origine berbère. Une légende du XIIe siècle affirme, qu’avant de s’installer du côté de l’oued Draâ, puis, en partie à Tindouf (Sahara algérien), leur berceau aurait été la région de Marrakech. Selon la chercheuse Désiré-Vuillemein, « Leur expansion, leurs qualités guerrières (bien qu’ils soient marabouts) ont pesé lourd sur l’histoire de la Mauritanie contemporaine ». A Tindouf, leur musique, proche, en effet, de celle du voisin mauritanien, est surtout une affaire de femmes, à travers un genre particulier dénommé houl, et elles ont l’exclusivité sur deux instruments. D’abord une percussion, appelée dendoun, que l’on retrouve également dans d’autres régions du Sud algérien comme le Touat, le Gourara, le Tidikelt, la Saoura et la Vallée du M’Zab, et une sorte de kora, connue sous le nom d’ardine. La première a été répandue par des petits éleveurs et par des tribus arabes de cultivateurs, souvent poussés à la transhumance et à de fréquents déplacements par les moullak (propriétaires). Le second comprend une partie basse formée d’un tambour surmonté d’un manche tendu d’une quinzaine de cordes. Les hommes, admis au sein des ensembles féminins, se contentent de jouer du tidinit, taillé à la façon d’une guitare et doté de quatre cordes.
Cinq modes, ou paliers distincts, définis comme des couleurs, dominent dans le houl (kar, fakou, lebyadh, lekhal et lebtit), tandis que la danse s’étale sur trois mouvements différents (jagouar, bleida et charaa). La plus populaire est celle qui est exécutée par des femmes aux mains peintes au henné ou avec des produits cosmétiques locaux. Elle révèle toute la splendeur chorégraphique, comprenant des exercices très stylés, de la région.
Alaoui de Sebdou (Tlemcen), danse rituelle
C’est sans doute la danse la plus fascinante d’Algérie, avec son rythme qui fait songer au mouvement d’un chameau possédé par quelque démon intérieur. Les tenants du raï, à l’image d’une Cheikha Rimitti ou d’un Cheb Mami, ne s’y sont pas trompés en l’utilisant souvent comme base de leurs chansons. Sous le titre alaoui, en référence à cette chorégraphie intemporelle d’essence bédouine, l’Orchestre National de Barbès avait signé son morceau de gloire, allant jusqu’à sa reprise par… Les Rolling Stones. L’ensemble de Sebdou, une des villes riantes de la Wilaya de Tlemcen (Ouest algérien), a conservé la gestuelle aâlaoui, nommée ici nehari, en respectant les règles des anciens.
Elle s’effectue en groupe homogène, en ligne ou en cercle, avec des remuements frénétiques d’épaules et des coups répétés du pied, que rythment la voix du meneur. La musique est exécutée par un quatuor formé par deux flûtes de roseau et deux bendirs (tambourins), le port du bâton, lors du déroulement de la danse, demeurant essentiel car il symbolise l’âme guerrière de la tribu des Ouled N’har.
De nos jours, cette danse, virile et pleine de vivacité, fait la fierté des habitants de la région d’Oran et elle constitue, encore et toujours, une attraction de choix, surtout quand plusieurs formations se mesurent en compétition.
Touaregs Sebida de Dajnet (Tassilis)
L’une des premières manifestations « officielles » à avoir révélé la beauté et la profondeur de la mélodie touarègue a été le premier festival panafricain d’Alger en 1969. Le concert de l’ensemble touareg, immortalisé sur pellicule par le cinéaste américain William Klein, avait ébloui les spectateurs d’autant qu’un géant du jazz, Archie Shepp, s’était mis de la partie. Porteuse d’accents africains, ce qui est normal quand on sait que leurs ancêtres ont donné un nom à ce continent (Afrique dérivé de aferchane ou aferkane, noir en tamazight), soutenue par des instruments inspirés par leurs lieux de vie et des chants parfois haut perchés, la musique touarègue est restée confinée dans ses limites régionales. A l’image de son environnement, elle épouse les contours de ces tentes conçues pour être démontées facilement, de ces nattes de roseaux adroitement tressées par les femmes tout en surveillant le troupeau et de ces plateaux muets sur leurs secrets.
Les Touaregs aiment la fête et ne ratent aucune occasion de « rapprocher leurs cœurs » (et leurs chœurs) même s’ils » éloignent leurs tentes ». C’est notamment lors des veillées d’ahals, fête locale, qu’ils expriment le mieux leurs sentiments, heureux ou malheureux. Lors de ces moments, où la cour se fait discrètement, hommes au visage dissimulé par un chèche et femmes embellies par l’ocre rivalisent de compétition artistique et se répartissent les tâches instrumentales et vocales. Au son pathétique de l’imzad, vièle monocorde, au rythme saccadé du tindé, percussion à peau tendue sur un mortier qui retrouve dès le lendemain son usage domestique, détrôné actuellement par le jerrican, les Touaregs entament leurs mélopées récitatives en s’accompagnant de savants claquements de mains. De nos jours, cette musique perd du terrain face aux matraquages de la télévision et de la radio qui imposent un autre modèle. Les plus récentes formations qui se sont constituées s’orientent davantage vers la variété orientale ou inspirée d’autres aires du Maghreb. Heureusement que certains papys, et surtout des mamies mais aussi quelques rares jeunes, font de la résistance, à l’image de ce groupe Sebida, issu de Djanet, la ville fière d’abriter le plus grand musée à ciel ouvert du monde, riche de fresques remarquables.
Tarifs :
Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit : 5 euros
Navette aller-retour de paris : 5 euros
Mer. 3 au sam. 6 sept. 20h30
Cabaret Sauvage, Parc de La Villette (75)
Mercredi 3 septembre : soirée chaâbi
Tradition d’Alger
Brahim Bey, chant et mandoline (chaâbi d’Annaba)
Ammar El Achab (chaâbi algerois)
Hasnaoui Amechtouh (chaâbi kabyle)
Orchestre arabo-andalou de Hamaï Mebrouk
Jeudi 4 septembre : soirée malouf > Soirée annulée !
Tradition de Constantine
M’barek Dekhla, violon et chant (malouf d’Annaba)
Dib el Ayachi et Cherif Zaârour (malouf constantinois)
Hamdi Benani, chant, violon
Vendredi 5 septembre : soirée hawzi
Tradition des faubourgs d’Alger
Hamidou
Naïma el Djazairia
Orchestre arabo-andalou de Hamaï Mebrouk
Samedi 6 septembre : soirée raï
Tradition d’Oran
Femmes Medahatte et Rokia (Sidi Bel-Abbes)
Cheb Abdou
Parc de Villarceaux, Chaussy (95)
Dim. 7 sept., parc et restauration (méchoui) à partir de 12h30 – concerts à partir de 14h
Fêtes des villages et du désert saharien
souk, tentes, restauration orientale, ateliers pour les enfants…
Idhebalen de Tizi Ouzou, percussions et danses de mariages en Kabylie
La fête kabyle
Iddebalen de Tizi Ouzou
En kabyle, fête se dit tameghra ou, lorsqu’on évoque une atmosphère de liesse, « fichta ». Dans cette région montagneuse, arboricole (figuiers et oliviers essentiellement) et farouchement attachée à son identité amazigh (berbère), située dans le nord-est de l’Algérie l’expression corporelle et les chants, sont souvent bâtis autour de textes à la poésie très subtile et métaphorique sont autant d’images en parfaite harmonie avec les paysages kabyles marqués par ce gris lumineux du ciel aux abords de la mer lorsque s’y fondent les reflets des neiges du Djurdjura. C’est aussi cette fuda (pièce de tissu) à rayures rouge et jaune, nouée autour des reins des femmes en surimpression sur le taqendurt (robe locale), que l’on remarque le plus lors des instants festifs.
Pendant l’ourar » (littéralement : jeu, autre variante de « fête »), ce sont les « iddebalen », groupes de musiciens constitué de deux « ghida » (sorte de cornemuse) et de un ou deux « tbel » (tambour), qui font l’ouverture sous les youyous stridents des femmes. En général, un orchestre « moderne » prend le relais et les réjouissances peuvent durer jusqu’à l’aube.
En Kabylie, la danse se pratique surtout à l’occasion des saisons de mariages et de circoncisions, du muwsem (fête religieuse) ou de la fin de la cueillette des olives. Mais en fait, tout est prétexte à un déhanchement frénétique. D’après un ouvrage de Djamila Henni-Chebra et Christian Poché, « la danse kabyle est considérée comme l’une des plus difficiles à exécuter ». Elle est également originale et se traduit par un mouvement continuel et très vif des hanches, du ventre et des fesses, sur fond de rythme en 6/8 ou sur le mode berwali chez les citadins. Lorsque la danseuse n’arrive pas à obtenir ce tremblement fiévreux des hanches, elle ceint celles-ci d’un foulard puis, « afin d’accentuer les secousses, elle ponctue d’un à-coup chaque fin de strophe en fléchissant le genou ». Cet ensemble de Tizi-Ouzou, capitale de la Grande-Kabylie, en est la plus parfaite des illustrations, sans » folklorisme » aucun.
Ensemble de zornas flûtes de Ghardaïa
Le mot ahallil désigne à la fois un genre musical et le groupe qui le pratique. Ces chants foisonnent de prières, de suppliques et de refrains où Dieu est glorifié dans son unicité. L’ahallil demeure avant tout une musique et un ballet propres au Gourara, une région du sud-ouest algérien, qui compte une centaine d’oasis habitées par les Zénètes (Berbères du Sahara).
Cette sorte d’opéra sacré saharien, représenté ici par Mabrouka Billal et la formation Ahallil, originaires de la ville rouge-ocre de Timimoun, s’exécute de préférence de nuit. Un groupe d’hommes se réunit en plein air et forme un cercle, au milieu duquel se tiennent un abchniw (poète et chanteur soliste), un flûtiste, un joueur de gumbri (instrument à cordes) ainsi que des percussionnistes utilisant tambour, pierres et mains. Ils répètent en chœur d’une voix grave, les complaintes aiguës du soliste, faites de suppliques ainsi que de quêtes de pardon et de grâce.
Dans un enchevêtrement subtil, l’ahallil fait cohabiter sacré et profane. La musique s’adresse à l’ensemble du corps devenu toute ouïe, et les chants évoquent un passé glorieux, ou disent les espérances et les inquiétudes. En intercalant le rappel de préceptes religieux avec le récit de batailles mémorables, l’ahallil contribue ainsi à maintenir la mémoire collective du groupe.
Z’hour et Les Fqirets d’Annaba, chant et târ et bendir percussions
En arabe, le terme « fqir » désigne le pauvre autant au sens originel du terme que dans une perspective religieuse. A Annaba, la coquette ville côtière de l’est algérien, le fond de l’air musical est au malouf, cet excellent dérivé de l’art arabo-andalou. Mais, dans la cité chère au berbère Saint-Augustin (il en fut l’évêque à l’époque où elle s’appelait Hippone), le chant sacré occupe également une place de choix. Il est souvent le fait de femmes et on peut l’entendre lors des « ziara » (visites aux saints patrons locaux) ou à l’occasion d’autres festivités louant Allah et son prophète). Les chants, accompagnés uniquement au « târ » (tambourin muni de cymbalettes) et au « bendir » (tambour sur cadre) débordent parfois le cadre religieux pour s’intéresser à la vie sociale. Z’hour et son ensemble jouissent d’une excellente réputation dans leur région.
Groupe Rouisset de Ouargla, danses de combat
Le mot « baroud » est entré depuis belle lurette dans la langue française, mais avant toute connotation guerrière, il désigne d’abord une cérémonie qu’on retrouve autant à l’ouest qu’à l’est de l’Algérie. Elle prend une dimension particulière à Ouargla (800 km au sud d’Alger), ici avec le groupe Rouisset. Au commencement, il y a le cercle protecteur, ensuite on retrouve des hommes, épaule contre épaule et fusil chargé, qui vont tourner autour d’un groupe composé de percussionnistes avant de lui faire face en chantant d’une seule voix. Puis, les percussionnistes se mettent à tourner, en sens inverse, élargissant le cercle de la danse, tout en maintenant le tempo jusqu’à la transe finale.
A un moment donné, les tambourinaires sortent du cercle où seul en piste, le maître de cérémonie va, suivant une technique bien rodée, donner le top au coup de feu. Ce rituel bien ordonné exige, pour être réussi, une minutie dans le moindre geste. Comme dans un hold up parfait, il faut être synchro.
Marzoug de Biskra, chant, chekwa cornemuse, qarqabou crotales, tablas
Il s’appellent Marzoug, en référence à une de ces nombreuses branches de la grande confrérie de Sidna Bilal, du nom du premier muezzin noir de l’islam, nommé par le prophète Mohamed. Au Maroc, ces populations venue de l’ancien Soudan occidental, avant d’essaimer dans tout le Maghreb, sont désignées sous le terme « gnawa » mais, dans le sud algérien, ils sont connus sous la dénomination « abid », « bousaâdia » ou « Ouled Baba Merzoug ».
A Biskra, grande palmeraie du sud-est algérien qui avait inspiré le peintre Etienne Dinet et fasciné Oscar Wilde, et en d’autres lieux, on dit que l’adoption d’un tel nom était une façon de se placer sous une bonne augure car « marzoug » signifie chanceux ; d’autres affirment qu’il s’agit d’un esprit, ainsi dénommé, parce qu’il procure la fortune à ceux qui se mettent sous sa protection. Mais ce que l’on retient le plus, c’est le « diwân », veillées nocturnes, des adeptes, perpétués par la troupe Marzoug. Il consiste en des louanges (ou salutations) appuyées au prophète et à l’ancêtre mais il ne dédaigne pas le profane sous forme de « ghazal » (soupirs d’amour). Les chants vibrent au son des percussions, des « qraqeb » (crotales en métal) et surtout des « chakwa », un instrument de la famille des cornemuses propre à la région de Biskra.
Ouled Aïssa El Djarmouni d’Oum El Bouagui, musique chaoui des Aurès, danse de la jument
La troupe Ouled Aïssa El Djarmouni d’Oum El Bouaghi s’inscrit dans la plus pure tradition musicale chaouïa, marquée par cette figure emblématique que fut Aïssa El Djermouni, premier Maghrébin à fouler les planches de l’Olympia, en 1917. De ce père spirituel, elle a hérité de l’amour pour la mélodie et le sens du rythme propres au genre rehaba, né sur les pentes abruptes du massif berbérophone des Aurès, à l’est de l’Algérie.
Il s’agit d’un chant en groupe, ouvrant sur diverses danses rythmées, dont la plus fameuse dite « de la jument », par le bendir et les pieds qui frappent le sol. Rehaba, signifiant ensemble, comprend le ferdi ou vocalises en solo accompagnées par une gasba (flûte de roseau) et un bendir (percussion). Le tout est agrémenté par divers modes et thèmes musicaux comme le s’raoui, le b’hairi, le djebaili, le rekrouki ou le s’laoui.
Aïn Sidi Mebarek de Kenadsa, danse du marié (gnawa, Sahara Saoura)
Kenadsa, cité proche de la métropole Béchar, a été la première ville houillère, à ciel ouvert, du sud-ouest algérien, mais aussi la place-forte d’une confrérie mystique. On y vient donc, parfois de loin, pour chercher un emploi dans les mines ou pour visiter la zaouïa, fondée par Sidi El Hadj Ben Ahmed. La musique, pratiquée dans cette cité cosmopolite, s’est enrichie de divers apports, issus du Maroc voisin (le célèbre chanteur Hocine Slaoui y avait travaillé comme mineur), de Tlemcen, berceau du hawzi (chant des faubourgs populaires), d’Alger qui y a déposé son chaâbi (populaire citadin de la casbah) et des soufis locaux.
La musique locale est connue sous le nom de Ferda et, traditionnellement, seuls des instruments de percussion, comme le târ (tambourin pourvu de cymbalettes), la taâridja (petite derbouka) ou le mahraz (pilon) ponctuaient le chant. Avec d’autres variantes, l’ensemble Aïn Sidi Mebarek excelle particulièrement dans la danse et notamment la toujours attractive gestuelle du marié, censée encourager l’heureux élu et le débarrasser de sa timidité et de son inhibition, peu avant sa nuit de noces.
Danse de nakh (chameau) de Oued Souf, danse du chameau (Sahara soufi)
El Oued, tout au fond du Sahara, est surnommée, à juste titre, la ville aux mille coupoles. Peuplée par des tribus d’origine arabe, elle tient à son caractère pieux et au terme « souf » (laine, celle que portaient les mystiques). Mais n’allez surtout pas croire que la région est morne et compassée car elle connaît la fièvre du jeudi soir (jour de repos en terre musulmane) comme ses autres voisines de palmier. Que ce soit lors des saisons de mariages, de fêtes privées et publiques ou au cours, osons, du repos « hebdromadaire », tout est prétexte à des ondulations du bassin et à des chants qui s’adressent autant aux hanches qu’à l’ouïe, sur des rythmes qui épousent souvent le pas du chameau.
R’Guibet de Tindouf, danse des femmes au mains peintes (Sahara)
Le nom des R’Guibet (transcrit également par Regueibat ou R’Gibat) renvoie à une tribu maure, d’origine berbère. Une légende du XIIe siècle affirme, qu’avant de s’installer du côté de l’oued Draâ, puis, en partie à Tindouf (Sahara algérien), leur berceau aurait été la région de Marrakech. Selon la chercheuse Désiré-Vuillemein, « Leur expansion, leurs qualités guerrières (bien qu’ils soient marabouts) ont pesé lourd sur l’histoire de la Mauritanie contemporaine ». A Tindouf, leur musique, proche, en effet, de celle du voisin mauritanien, est surtout une affaire de femmes, à travers un genre particulier dénommé houl, et elles ont l’exclusivité sur deux instruments. D’abord une percussion, appelée dendoun, que l’on retrouve également dans d’autres régions du Sud algérien comme le Touat, le Gourara, le Tidikelt, la Saoura et la Vallée du M’Zab, et une sorte de kora, connue sous le nom d’ardine. La première a été répandue par des petits éleveurs et par des tribus arabes de cultivateurs, souvent poussés à la transhumance et à de fréquents déplacements par les moullak (propriétaires). Le second comprend une partie basse formée d’un tambour surmonté d’un manche tendu d’une quinzaine de cordes. Les hommes, admis au sein des ensembles féminins, se contentent de jouer du tidinit, taillé à la façon d’une guitare et doté de quatre cordes.
Cinq modes, ou paliers distincts, définis comme des couleurs, dominent dans le houl (kar, fakou, lebyadh, lekhal et lebtit), tandis que la danse s’étale sur trois mouvements différents (jagouar, bleida et charaa). La plus populaire est celle qui est exécutée par des femmes aux mains peintes au henné ou avec des produits cosmétiques locaux. Elle révèle toute la splendeur chorégraphique, comprenant des exercices très stylés, de la région.
Alaoui de Sebdou (Tlemcen), danse rituelle
C’est sans doute la danse la plus fascinante d’Algérie, avec son rythme qui fait songer au mouvement d’un chameau possédé par quelque démon intérieur. Les tenants du raï, à l’image d’une Cheikha Rimitti ou d’un Cheb Mami, ne s’y sont pas trompés en l’utilisant souvent comme base de leurs chansons. Sous le titre alaoui, en référence à cette chorégraphie intemporelle d’essence bédouine, l’Orchestre National de Barbès avait signé son morceau de gloire, allant jusqu’à sa reprise par… Les Rolling Stones. L’ensemble de Sebdou, une des villes riantes de la Wilaya de Tlemcen (Ouest algérien), a conservé la gestuelle aâlaoui, nommée ici nehari, en respectant les règles des anciens.
Elle s’effectue en groupe homogène, en ligne ou en cercle, avec des remuements frénétiques d’épaules et des coups répétés du pied, que rythment la voix du meneur. La musique est exécutée par un quatuor formé par deux flûtes de roseau et deux bendirs (tambourins), le port du bâton, lors du déroulement de la danse, demeurant essentiel car il symbolise l’âme guerrière de la tribu des Ouled N’har.
De nos jours, cette danse, virile et pleine de vivacité, fait la fierté des habitants de la région d’Oran et elle constitue, encore et toujours, une attraction de choix, surtout quand plusieurs formations se mesurent en compétition.
Touaregs Sebida de Dajnet (Tassilis)
L’une des premières manifestations « officielles » à avoir révélé la beauté et la profondeur de la mélodie touarègue a été le premier festival panafricain d’Alger en 1969. Le concert de l’ensemble touareg, immortalisé sur pellicule par le cinéaste américain William Klein, avait ébloui les spectateurs d’autant qu’un géant du jazz, Archie Shepp, s’était mis de la partie. Porteuse d’accents africains, ce qui est normal quand on sait que leurs ancêtres ont donné un nom à ce continent (Afrique dérivé de aferchane ou aferkane, noir en tamazight), soutenue par des instruments inspirés par leurs lieux de vie et des chants parfois haut perchés, la musique touarègue est restée confinée dans ses limites régionales. A l’image de son environnement, elle épouse les contours de ces tentes conçues pour être démontées facilement, de ces nattes de roseaux adroitement tressées par les femmes tout en surveillant le troupeau et de ces plateaux muets sur leurs secrets.
Les Touaregs aiment la fête et ne ratent aucune occasion de « rapprocher leurs cœurs » (et leurs chœurs) même s’ils » éloignent leurs tentes ». C’est notamment lors des veillées d’ahals, fête locale, qu’ils expriment le mieux leurs sentiments, heureux ou malheureux. Lors de ces moments, où la cour se fait discrètement, hommes au visage dissimulé par un chèche et femmes embellies par l’ocre rivalisent de compétition artistique et se répartissent les tâches instrumentales et vocales. Au son pathétique de l’imzad, vièle monocorde, au rythme saccadé du tindé, percussion à peau tendue sur un mortier qui retrouve dès le lendemain son usage domestique, détrôné actuellement par le jerrican, les Touaregs entament leurs mélopées récitatives en s’accompagnant de savants claquements de mains. De nos jours, cette musique perd du terrain face aux matraquages de la télévision et de la radio qui imposent un autre modèle. Les plus récentes formations qui se sont constituées s’orientent davantage vers la variété orientale ou inspirée d’autres aires du Maghreb. Heureusement que certains papys, et surtout des mamies mais aussi quelques rares jeunes, font de la résistance, à l’image de ce groupe Sebida, issu de Djanet, la ville fière d’abriter le plus grand musée à ciel ouvert du monde, riche de fresques remarquables.
Tarifs :
Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit : 5 euros
Navette aller-retour de paris : 5 euros
Partager :



