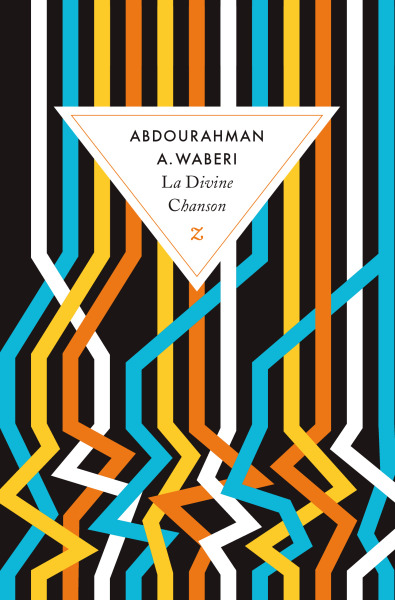Avec La Divine Chanson, Abdourahman Waberi, romancier, poète et essayiste, dresse le portrait d’un Gil Scott Heron retravaillé par la fiction dans la bouche d’un chat soufi. Une uvre qui se construit sous la forme d’un double album. Mais dont la force puise dans le mystique plus que dans la musique.
« Tu auras pour tâche de défricher et de déchiffrer le monde en en chantant le mystère
tu seras un maître de la parole, un génie de la musique, mon petit-fils
un génie brut, sans emballage, ni filtre »
Avec La Divine Chanson, Waberi se paie son double album. Pas en notes, mais en mots. Il n’en est pas à son premier coup d’essai. Dans une des nouvelles de Routes, rifts et rails, déjà, sa narration puisait déjà sa source sur un concept de production musicale, à certains endroits. Une construction en plages de disques, un personnage historique, mythique, avec Paris en décor de fond.
Pour raconter la vie de Sammy Kanau-Williams alias l’ « Enchanteur », ce « mage qui a consumé sa vie par tous les bouts », dans La Divine Chanson, son dernier texte, inspiré de Gil Scott Heron (1949-2011), il reprend le concept. Wabery construit son livre, tel un double album. Il y a le CD1, intitulé « un soir à Paris, Fin avril 2011 », et le CD2, portant le titre de « Revoir Harlem, fin mai 2011 ».
En écho au double récit ainsi fait, un « prologue ou Mélodie de la création », un intermède avec « une nuit d’extase et de chute, Berlin, début mai 2011 », et un « épilogue ou mélodie de la compassion ». Mais si on assiste à une tournée en Europe, à quelques éléments de vie sur scène, à l’évocation de certains titres phares comme The Revolution will not be televised ou I will here now les passages centrés sur la musique sont rares. Pas de live, ni de partition à lire pour le lecteur. Plutôt un discours sur la spiritualité, à partir de ce personnage issu des musiques noires du siècle dernier. La musique, la chanson dans ce roman, est avant tout une métaphore de la vie, de son mystère.
« Avec presque rien, l’univers tout entier se tient, pour reprendre l’image préférée de Mawlânâ, dans l’infini comme une chanson qui tournoie sur elle-même. Avec presque rien, la roue de la chanson continue de tourner. Avec presque rien, chaque être pousse un petit air en résonance avec la grande chanson universelle ». Le terme lui-même de chanson devient un motif sur lequel se tissent des interrogations existentielles. Sammy Kanau- Wiliams, la soixantaine, est à la fin de sa vie. Le début du roman le place dans un moment d’inspiration à bout. Les boites de production le boudent. Il a fait plusieurs séjours en prison, et il ne lui reste que quelques tournées, vécues comme un dernier round, pour survivre à sa musique. Le temps du succès est loin, celui des tourments a pris toute la place, mais la soif d’idéal persiste.
« Sammy est fils du blues. Poètes ambulants, les chanteurs du blues, issus du delta du Mississippi, colportaient de bourg en bourg la mémoire de la souffrance des esclaves, tout en frayant avec les personnages de la Bible et les mânes des forêts africaines ». Musique et spiritualité, musique et combat, entre passé et présent. C’est à l’époque où il accompagne au piano sa grand-mère, Lilly, à l’Église, que le personnage découvre, en secret, ses premiers airs de blues à la radio. Il s’imprègne du « Blues de Memphis » : « une plaque tournante pour les musiques du Sud, noires comme blanches ». Avec « les vieux blues du Deep south » d’un John Lee Hooker, Sammy construit sa légende. À partir du Tenessee, où il grandit auprès de Lilly, jusqu’à ses 12 ans : « là où le blues a vu le jour. Le son de la Création est né là-bas, dans le delta du Mississippi, c’est à dire dans la fange, les boyaux et la sueur acide des esclaves africains ».
La musique existe dans ce roman, tel un motif récurrent. Non par ses mélodies, mais par toute sa symbolique et son histoire. Le blues en rapport avec l’histoire, l’esclavage, le capitalisme. Le blues comme parole de résistance. Le blues dans toute sa mystique. Il n est pas étonnant de voir alors apparaître Papa Legba tout au long de La Divine Chanson. Lui, l’esprit vaudou, situé entre terre et au-delà, qui est sacré « Maître des carrefours » et qui hante l’uvre de bluesmen comme Tommy Johnson ou Robert Leroy Johnson et son célèbre Crossroad Blues. Et puis, il y a encore et toujours Lilly, figure qui souffle des bribes d’ancestralités africaines à l’esprit de Sammy.
Ado, Sammy débarque dans le Bronx où il étudie, monte ses premiers groupes dont les Voodoo Bodies et les Warlords, se distingue avec des compos d’ « une belle élégance », une plume « à la fois précise et sobre », à l’heure où les Last Poet cartonnent. Rien à écouter pour le lecteur, au sens strict. Mais le motif (la chanson) est là, toujours à courir entre deux phrases. Et puis, il y a Harlem où il plonge dans les luttes pour les droits civiques, avec les chroniques de Langson Hugues. Sammy, qui a peu connu son père, trouve son modèle en ce poète de la Harlem Renaissance. Pour Sammy, le père reste une blessure, celle de la séparation. Une histoire, celle des Noirs américains, fils et filles d’une plaie toujours ouverte, celle de l’esclavage.
La musique figure un symbole, une lutte. « De toutes ses fibres, il voulait lever son peuple, laisser une uvre musicale, tout en cassant les jointures de la machine diabolique du capitalisme. Il est parvenu, avec ses mots, à se faire guérisseur, prophète, meneur. Chasseur de djinns ». Et ce, malgré la réalité nouvelle d’un New York gentrifié, vidé de ses classes populaires, et de sa population noire. Dans un contexte, où « la musique noire, le grand courant électrique, qui rivalise avec le Gulf Stream, entre en crise, sous les assauts des courtiers et des directeurs artistiques ». Que peut vraiment la musique, face à un système capitaliste, qui continue d’écraser sur son passage ? « Je ne reconnais plus mon pays. même Oakland, la ville des Blacks panthers, est rentrée dans le moule mercantile […] ma braise politique ne vous remue plus mes frères ! Avouez que ma musique vous effraie. Et mes mots, mes mots d’esprit ne ricochent plus comme avant, non ? » écrit Scot-Heron en 2008.
Abdourahman Waberi dessine dans La Divine Chanson, avec toute la poésie qu’on lui connaît, un destin de personnage mythique, avec le Paris et le Berlin pour décor, en partant du fin fond de l’Amérique noire des années 70 à aujourd’hui. Sammy Kanau-Williams aux dernières heures de sa vie, racontées par un chat persan soufi, disciple de Mawlânâ et baptisé Paris. Une uvre qui, sous prétexte de musique, n’évoque que le génie et la folie d’un homme. « Côté pile : incendies et enfer. Chute et damnation. Gouffres abyssaux et démons. Côté face : illumination, musique et activisme, progéniture et coup de génies ». Le flow dans ce roman n’est d’ailleurs pas à trouver en musique, mais bien plus dans la poésie des références soufies, qui y sont distillées sous forme de contes et de paraboles, empruntés à l’Orient.
« Tout commence par une chanson et tout finit par une autre chanson. Entre-temps, les corps se mettent en mouvement comme sur un claquement de doigts, tournoyant allègrement au rythme du Vivant » est-il écrit dans le livre. Mais on en sort quand même avec ce manque. Cette absence du son, du chant, du groove. On ressent cette envie d’écouter l’uvre de Gil Scott Heron dans son intégralité pour mieux saisir ce qui inspire Waberi. Besoin de sentir cette musique que l’on ne fait qu’entrevoir, dans sa chair première, au-delà du discours qui l’enrobe dans le livre. Waberi nous rappelle que « l’amour, la révolution, la justice, la lutte des Black Panthers, le soulèvement contre l’apartheid à Johannesburg, le combat écologique avant l’heure, tout finit en chansons et en poème ». Du coup, il nous pousse à sortir du livre, pour se rendre à la source. Musique
///Article N° : 12858