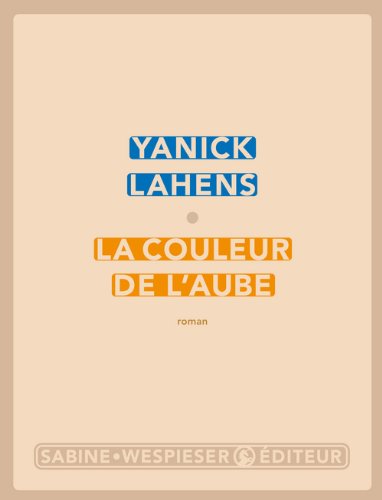Le 25e prix caraïbe de l’Association des écrivains de langue française (ADELF) a été attribué cette année, à la romancière haïtienne Yanick Lahens pour Guillaume et Nathalie publiée en 2013 chez Sabine Wespeiser éditeur. L’auteure avait par ailleurs reçu une mention spéciale du Prix Carbet en décembre 2013 pour ce même ouvrage. Africultures l’a rencontrée aux Francophonies en Limousin en octobre dernier. Elle assistait notamment à la lecture de son précédent roman, La couleur de l’aube, par de jeunes actrices haïtiennes, dirigées par la metteure en scène Eva Doumbia. Rencontre à bâtons rompus avec l’écrivaine, qui prépare actuellement un essai sur les voix féminines de la littérature haïtienne.
« Mais cela ne m’empêche pas d’avancer dans le brasier. Et de poser ma pierre au cur de ce brasier. Et même mieux (…) ma pierre de beauté »
–Guillaume et Nathalie de Yanick Lahens –
Dans votre dernier livre, Guillaume et Nathalie, vous abordez la question de l’érotisme et du désir.
Quand j’ai écrit Guillaume et Nathalie les gens étaient très étonnés : un roman sur le désir. Et oui cette thématique m’intéresse aussi ! Et depuis bien longtemps. Mais ce n’est pas évident d’écrire l’érotisme quand il s’agit de corps noirs. Beaucoup de projections fantasmatiques y sont associées. Nous-mêmes avons intégré un certain nombre de représentations sur notre propre corps. Comment mettre ce mécanisme du désir, de l’érotisme – qui est quand même une des choses importantes de la vie – en écriture. On m’a aussi demandé : « Pourquoi une histoire d’amour ? ». Les gens tombent amoureux aussi en Haïti !
Écrivez-vous toujours avec la crainte de la réception sur l’écriture en Haïti, oscillant parfois entre « carte postale ou cauchemar ». L’artiste peut-il faire fi de ce regard de l’autre ?
Non. Quand j’écrivais sur une femme qui parle de l’eros, j’ai foncé. Mais pour le corps noir, je savais qu’il y avait des choses qu’il fallait que je dise. Par exemple notre propre regard sur notre corps fait qu’une femme de la classe moyenne noire, va ressentir le regard de l’Haïtien de la classe moyenne ou de la bourgeoisie mulâtre comme dévalorisant. Et c’est intéressant qu’elle découvre sa beauté possible et sa féminité avec un homme blanc. C’est un choix. Beaucoup de femmes à qui j’ai parlé m’ont en effet dit avoir découvert qu’elles pouvaient être femme parce que l’homme blanc, quelque fois, est peut-être moins raciste dans son regard que nos propres congénères. Il fallait être très subtil pour raconter ça. Je ne me suis pas fait que des amis avec ce livre. Certaines personnes de l’élite, peut-être de l’élite créole, n’ont pas été à l’aise avec le livre. Mais ça ne me dérange pas du tout.
Vous sentez-vous donc plus libre en écriture désormais, après quatre recueils de nouvelles publiés et deux romans en plus de Guillaume et Nathalie ?
J’ai pris beaucoup de liberté. Mais on n’échappe pas à ce qu’on est. Il y a des thématiques qui reviennent. Je pense recommencer les nouvelles aussi. Ce sont des instantanés que l’on saisit au passage. Il faut éviter les digressions, amener le lecteur au paroxysme avant la chute. Quand on rate un paragraphe ça se voit, contrairement au roman. J’ai essayé le roman pour pouvoir déployer davantage la narration.
En plus d’un roman en cours d’écriture, vous préparez actuellement un essai sur les écritures de femmes haïtiennes.
Ce sont des interrogations qui me trottent dans la tête depuis pas mal de temps. L’essai s’intitulera ; Les femmes dans l’il du cyclone. Je vais le faire sur quelques voix féminines haïtiennes, du XXeme et XXIeme siècle probablement. L’objectif étant de montrer que certaines thématiques nous sont propres. Il y a une attitude spécifique depuis Marie Chauvet ; sa famille a acheté le stock de ses livres à Gallimard parce qu’elle y parle de désir, en plus elle met en scène la question de la couleur de peau avec une mulâtresse qui couche avec un homme noir
Elle dérange tout le monde ; elle dérange sa famille, elle dérange le pouvoir, parce que c’est un brûlot anti-duvaliériste, mais elle dérange aussi le dogme de la gauche. Et finalement les messieurs de la gauche ne disent rien. Pour eux, la littérature c’est nécessairement avec un héros sans faille qui va porter la bonne nouvelle ; la paysannerie avec l’avant-garde de la révolution dans Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, c’était le prolétariat avec Jacques Stephen-Alexis. Marie Chauvet arrive et dit au monde : « La vie ce n’est pas comme ça. Nous sommes des êtres très complexes tous ». Tous ont été pétrifiés à l’époque et finalement le silence fait autour d’elle a arrangé tout le monde. Jusqu’à ce qu’une nouvelle génération arrive : Dany Laferrière lui a rendu hommage dans les années 1985. D’autres lui ont fait de la place pour réaliser que c’est sa voix qui a commencé le roman moderne en Haïti. Cet hommage a d’abord été fait par des personnes de la diaspora, parce que les uvres de Marie Chauvet n’étaient pas accessibles en Haïti avant 1986.
En quoi existerait-il une écriture féminine ?
Esthétiquement, je me pose les mêmes questions que tout écrivain, homme ou femme. Je suis obsédée par le temps, la narration, et l’interrogation de l’agencement de la forme. J’ai déjà écrit en étant dans la peau d’un homme. Mais on ne peut pas échapper à sa situation, à son histoire, ni à son genre. Et je suis femme, haïtienne, noire. Je ne peux pas m’empêcher d’écrire à partir de ma situation de femme
aussi ! Je n’ai jamais milité pour la cause féministe. Mais quand je lis Marie Chauvet, ou les contemporaines comme Evelyne Trouillot et Ketly Mars, je remarque qu’on écrit les choses différemment. Parce qu’on a des vécus différents de ceux des hommes.
Au-delà de l’écriture, vous avez accepté la mise en scène de votre texte La couleur de l’aube, par Eva Doumbia. Comment avez-vous reçu cette interprétation en tant qu’auteur ?
J’ai vu le texte sur scène la première fois en Haïti. Gaëlle Bien Aimée avait travaillé seule sur le personnage d’Angélique. J’ai été très agréablement surprise. Au départ j’avais une certaine distance : « Est-ce que c’est moi qui aie écrit ça ? ». Et puis au fur et à mesure je me suis approprié sa parole. Parole qui était en fait la mienne mais mise en scène. Et ça m’a confirmé une chose : c’est un texte parlé. Ce texte se prêtait à cela. Après, il y a des choix faits par le metteur en scène. Quand on écrit un texte, c’est normal que les gens se l’approprient. C’était une expérience très intéressante
Quelle importance accordez-vous à l’histoire et sa transmission aux jeunes générations ?
Je ne suis pas historienne. Mais je discute beaucoup et cela m’est utile pour l’écriture. Par exemple j’ai appris il y a trois mois qu’Haïti avait envoyé des soldats en Grèce pendant la guerre. C’est incroyable ! On nous montre les choses de manière caricaturale ; quand on nous parle du roi Christophe comme quelqu’un de ubuesque alors que c’était un des premiers visionnaires, un homme d’État. Il a réorganisé les finances, créé une première académie des arts et de la culture, il a réfléchi sur le système d’éducation. C’est incroyable. Les gens me disent ; « oui mais il avait une couronne sur la tête ». On ne le replace même pas dans le contexte du XIXe siècle. La France ne connaissait pas encore la République. Haïti gagne son indépendance. Quels sont les seuls modèles qu’elle a ? Il y a des gens qui reviennent d’Afrique où il y avait des royautés et des royaumes. Et on regarde du côté de l’Occident il n’y a que des royautés. Mais on a toujours la lunette raciste et on voit tout de suite la caricature.
Qu’en est-il de la transmission du patrimoine littéraire haïtien en Haïti et au-delà ?
Il y a une tradition littéraire haïtienne. Même si elle est réservée à une élite, elle existe. Il y a un patrimoine. Les gens écrivent. Déjà au XIXe siècle il y avait le débat ; doit-on faire une littérature qui parle simplement d’Haïti ou d’ailleurs. Quand Louis Joseph Janvier écrit un roman qui ne se passe pas du tout en Haïti, les Haïtiens lui disaient que « non » il fallait exalter la patrie. On les appelait « Les évadés ». Ces débats ont déjà eu lieu au XIXe siècle. Ils continuent aujourd’hui.
Lors d’une rencontre à l’université de Limoges, je disais justement aux étudiants que ce débat sur la littérature nationale a été un grand débat avec les membres de l’association des écrivains haïtiens. Dernièrement à propos de Dantika. Depuis des décennies, il y a eu des phénomènes migratoires du nord vers le sud. Salma Rushdie est à cheval entre trois patrimoines ; le Pakistan, l’Inde et l’Angleterre le revendiquent. Et c’est très bien. Dantika ne parle jamais des États-Unis et voilà que les États-Unis la revendiquent. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le faire aussi ? Je n’ai pas de réponse définitive. Il se trouve qu’aujourd’hui des gens écrivent une littérature qui parle d’Haïti. Ils sont d’origine haïtienne, et le font en anglais ou en espagnol. Aujourd’hui on a des enfants qui sont scolarisés en espagnol : parce que trois fois plus d’étudiants haïtiens étudient en République dominicaine. J’en connais déjà qui écrivent en espagnol. Je ne peux pas arrêter le monde parce qu’il ne va pas dans le sens de mes définitions datées. Je suis juste sensible à quelque chose qui est en train de se faire.
Dans Guillaume et Nathalie le personnage de Nathalie m’énervait parfois ; ce n’était pas ma génération. Mais voilà je ne fais qu’observer. Quand j’écris j’ai envie que toutes les vies palpitent dans un roman. Il faut être extrêmement sensible à tout ça.
Dans une interview à Africultures Makenzy Orcel disait, « j’écris de ma chambre pour parler au monde ».
J’aime beaucoup cette image de la chambre. Dans un texte pour le journal Libération, j’avais écrit « ma chambre est le centre du monde ». Et concrètement à droite de ma chambre j’ai un bidonville, et à gauche c’est la partie occidentalisée avec des immeubles, des antennes paraboliques, des Organisations non gouvernementales (ONG) etc. Je me dis que j’ai le tiers-monde d’un côté et l’occident de l’autre. Je ne me pose pas la question. J’écris pour deux ou trois personnes. S’il y a 8 millions de personnes qui peuvent me lire, ça veut dire que j’aurai gagné le pari de sortir de l’enfermement intérieur. Et je pense que cela peut être le cas quand on a une parole vraie, peu importe la langue et l’endroit d’où l’on écrit.
Vous n’aimez pas parler de littérature engagée. Pourquoi ?
Non je n’aime pas. Ce que vous êtes va transpirer dans un texte.
Si vous n’êtes pas une écrivaine engagée, vous définissez-vous comme une femme engagée ? Vous avez participé à un gouvernement en Haïti, à un programme de l’Unesco sur la mémoire de l’esclavage, à différentes associations culturelles et littéraires.
J’ai fait tout ça. Mais en matière de littérature je ne pense pas qu’il faille parler de littérature engagée. Moi je ne veux pas. J’aime encore moins le terme activisme. Femme engagée, oui, parce que je continue à faire des choses, notamment avec les jeunes, mais je vois tellement de personnes qui font des choses plus extraordinaires que j’ai l’impression que je ravis un terme qui ne me convient pas. J’ai l’impression d’usurpation.
Vous dites que votre expérience politique a pu être traumatisante
Oui, je pense qu’on perd beaucoup en politique. C’est un mal nécessaire : il faut que des gens s’engagent en politique. Je suis très intéressée par la politique. Mais je ne sais pas si j’ai les atouts et les qualités pour en. Il y a des compromis, notamment par rapport à ma qualité de vie et aux relations humaines que je n’ai pas envie de faire. Les opportunismes
je ne peux pas. Ça m’a appris beaucoup sur les gens. Je pense qu’il faut des qualités que je n’ai pas.
Quel regard portez-vous sur une nouvelle génération d’artistes haïtiens comme ceux présent au festival de Limoges, qui sont à la fois acteurs, slameurs, comédiens ?
Ils sont incroyables. Quand je sors de chez moi en Haïti, la reconstruction n’a pas commencé mais eux n’ont pas attendu. Il y a des bars qui ont ouvert, des associations
Quelle énergie ! Ça m’épate ! Justement Nathalie, dans Guillaume et Nathalie, est de plein pied dans la globalisation. Certains m’ont dit « tu décris ma fille ! Je ne la comprends pas du tout ». (rires). Et malgré toutes ces contradictions, Guillaume et Nathalie, qui ne sont pas de la même génération, arrivent à vivre leur désir. Et heureusement, sinon la vie serait moche si tout était cadré !
Vous parlez de la création haïtienne. Mais qu’en est-il, par exemple de la chaîne du livre, de l’édition notamment ?
Il y en a deux qui émergent maintenant. Elles ne sont pas visibles parce que le système français bloque. Aucun livre édité en Haïti ne va être vendu en France.
Comment vous placez-vous par rapport à cette réalité ?
Mes livres sont vendus en France. J’avais dit à Serpent à plumes « je veux une édition haïtienne sinon les gens ne vont pas lire ». Ils ont été d’accord. Cela continue avec Sabine Wespieser. D’autres le font aussi. Les livres sont alors un peu plus accessibles. Certains le font à compte d’auteur mais c’est très lourd. je l’ai fait deux fois. Avec La couleurs de l’aube, c’était les presses nationales.
Qu’en est-il du réseau de diffusion ?
Maintenant il y a deux ou trois libraires et il y a Communication +, un système de diffusion. Elle va sur tous les lieux où il y des événements autour du livre. Il y a quand même un petit réseau qui est assez bien organisé.
L’écrivain n’est plus aujourd’hui cantonné à sa table de travail. Il semble aussi devoir assurer une visibilité médiatique. Que pensez-vous de ces changements de posture ?
La vie d’un écrivain a changé. Quand on pense au numérique et qu’on sait que l’année dernière il s’est vendu plus de livres numériques que de livres papier aux États-Unis
Et Amazone pense proposer aux auteurs de leur envoyer directement le manuscrit. Qui va faire le travail éditorial ? Cela pourrait nécessairement révolutionner encore davantage le travail d’écrivain.
Qu’en est-il de la question de la visibilité médiatique de l’écrivain ?
Je trouve ça fatiguant. Surtout la télévision. Les gens consomment des images et je n’ai pas l’impression que ça aille aussi loin que la radio par exemple. Mais on touche moins de gens avec la radio. Quand on m’a demandé de passer à La Grande Librairie sur France 5, j’ai joué le jeu. Je savais que j’étais dans une émission à grande écoute, et j’étais la femme noire, au milieu de quatre écrivains hommes. Il fallait se poser exactement au bon endroit. Il faut savoir se poser exactement là où on est droit. Je n’ai pas du tout l’impression d’écrire d’une périphérie. Est-ce que les gens se rendent compte que le monde a changé ? Le monde littéraire a changé aussi.
Quel est votre secret pour être à l’écoute des changements du monde et pour écrire ?
Je dors peu. (rires) Je m’interroge énormément. Je lis beaucoup. Et par exemple on a gardé un rituel à la maison : tous les samedis matins, des amis viennent et on refait le monde, on refait Haïti. Avec des anthropologues, des historiens etc. J’apprends énormément. Et autre chose aussi : quand on n’a pas en toile de fond qu’il y a plusieurs Haïti on peut passer à côté de plein de choses. On peut écrire de très belles choses dans cette ville sans savoir que dans cette ville il y a d’autres villes. Quand je me suis intéressée à la classe moyenne en Haïti dans La couleur de l’aube, j’étais obligée de changer de monde culturel. Je ne suis plus dans le monde judéo chrétien, je suis dans le monde majoritaire haïtien qui est autre chose. Il y a un travail de compréhension, d’observation permanente.
Quelles sont vos lectures ?
J’ai envie de faire une cure de lectures classiques en 2014 ; je vais reprendre depuis Antigone, – je l’ai lu mais quelqu’un m’a dit que La couleur de l’aube lui avait fait penser à Antigone-, je vais relire de la poésie, Michaud, Artaut. Il y a quelqu’un que je ne quitte jamais c’est Camus. Et puis les classiques haïtiens aussi. Mon roman est terminé et va paraître durant l’année. L’essai est quasiment prêt. Et je vais aussi faire un journal de voyage en République dominicaine pendant un mois
Je ne connais pas l’ennui ! (rires) Ce n’est pas possible en Haïti. Un ami installé en Martinique me disait : « Ce que je vis en deux jours en Haïti, je mets deux ans à le vivre en Martinique »
///Article N° : 12055