(to read in english here) Euzhan Palcy a présidé le jury du festival Dakar Court qui s’est tenu à Dakar du 9 au 14 décembre 2019. Elle a accepté de revenir sur son parcours au cours d’une masterclass et de répondre aux questions des jeunes cinéastes de l’atelier « Talents 2019 » qui ont suivi assidûment le festival.
Olivier Barlet : Merci Euzhan Palcy de prendre le temps de cet échange. Vous avez une position remarquable dans les cinémas d’Afrique et des diasporas puisque vous êtes originaire de Martinique et avez également tourné en Afrique. Vous êtes très rapidement venue à Paris pour apprendre le cinéma et y étiez déjà en contact avec des cinéastes africains comme Sidney Sokhoma, donc un intérêt pour l’Afrique dès le départ.
Euzhan Palcy : Tout à fait. J’avais dix ans en Martinique quand j’ai manifesté le désir de faire du cinéma ! Il n’y avait pas de salles sauf une salle paroissiale où on projetait beaucoup de films américains et quelques films français. Très jeune, je me suis demandé où nous étions, nous les Nègres, à l’image. Je ne l’acceptais pas. Ma grand-mère me disait tu as cinq minutes pour te plaindre mais une minute pour me dire comment tu vas faire pour changer les choses. J’ai toujours gardé ça en moi. Quand je suis allée à Paris pour faire des études, je me suis lancée à la recherche de mes sœurs et mes frères d’Afrique. J’avais eu le privilège d’être choisie par l’Office municipal culturel de Fort-de-France qui avait à sa tête Aimé Césaire, maire de la ville, grand poète, philosophe, historien et professeur. C’était un fils d’Afrique. Césaire connaissait l’importance de la culture. En plein centre de Fort-de-France, dans le parc floral, il a créé le SERMAC, Service municipal d’action culturelle, municipal car ce n’était pas le gouvernement français qui l’aurait fait à l’époque. C’était un centre culturel martiniquais : tout y était possible, cinéma, théâtre, arts plastiques, musique, etc. Les cours étaient gratuits. Mordue de cinéma, après mon baccalauréat, ne connaissant personne, c’était le lieu idéal pour me brancher et découvrir les films. 90 % des films projetés venaient d’Afrique : c’est ainsi que j’ai découvert les œuvres de Paulin Vieyra, d’Oumarou Ganda, Sembène Ousmane, Med Hondo et autres. Quand je suis allée à Paris, c’est très naturellement que je me suis mise à leur recherche. J’ai ainsi rencontré Med Hondo et Sembène Ousmane. J’avais vu Soleil Ô, La Noire de…, Le Mandat… Ils appréciaient mais ne pouvaient m’aider, étant eux-mêmes en recherche d’aide, mais pouvaient me donner des conseils.

Vous aviez une première expérience de cinéma puisqu’à 17 ans, vous aviez tourné La Messagère. Pourriez-vous en parler notamment aux jeunes cinéastes présents : comment on peut débuter dans le cinéma de façon improvisée ?
C’est vrai. J’étais très jeune quand j’ai écrit ce premier scénario. C’était les relations d’outre-tombe d’une jeune fille avec sa grand-mère. Elle était ce qu’on appelle une Da, femme noire qui élevait les enfants des Békés, les Blancs qui possédaient des plantations. Une nounou en somme. Elle meurt âgée mais a des enfants et des petits enfants, notamment une jeune fille qui a 17-18 ans à qui elle se manifeste dans des cauchemars. Avant de mourir, elle avait caché sa boîte à bijoux, un objet très important aux Antilles car il y a de l’or, et notamment le collier-chou ou grains d’or, un collier avec de petites boules et un fermoir. Le nombre de grains donnait le nombre d’années passées dans la famille des maîtres. Personne ne savait où était la boîte, que l’on cherche quand une femme décède. La grand-mère indique en rêve la cachette à sa petite fille mais cela confus au réveil. Elle décide donc d’aller là où a vécu la vieille dame. J’aimais beaucoup le suspens chez Hitchcock : le fauteuil de la grand-mère se met à bouger. Elle lui parle mais la petite fille n’entend pas. Finalement, après plusieurs essais, cette dernière est découragée mais lorsqu’elle passe devant un de ces petits calvaires qu’on voit souvent aux Antilles, tout lui revient et elle peut être « la messagère ». Elle ameute le village et les vieux vont défoncer le calvaire et trouver la boîte. Les héritiers des Blancs créoles avaient décidé de se débarrasser de la plantation de bananes. Leurs ouvriers et leurs enfants ne savaient où aller.
Cet or leur permettait de demander un prêt à la banque en montant une coopérative pour acquérir la plantation. Comme dans mon autre film Siméon, les morts ne sont pas morts et voient tout ce qui se passe sur terre.
Et comment cela faisait-il un film ? Aviez-vous une caméra à disposition ?
Je n’avais jamais fait de cinéma mais voyais beaucoup de films à la salle paroissiale, et lisais beaucoup. Je n’avais par contre jamais touché à une caméra. Michel Wuilstek, le directeur artistique de la radio-télévision de la Martinique, l’ORTF à l’époque, était un Français qui avait longtemps vécu en Afrique. C’était un mélomane : son violon d’Ingres était le piano. Il avait essayé de faire bouger la télévision. J’avais débarqué dans son bureau pour lui dire qu’il faudrait des Noirs à l’écran. On n’y voyait effectivement jamais un Noir ou bien les doudous en costume traditionnel qui dansaient lorsqu’un président était en visite ! Très jeune, j’écrivais des poèmes et participais à une émission de poésie. C’est comme ça que je le connaissais. Il a aimé le scénario mais ne pouvait rien faire : les caméras ne filmaient que de l’actualité. Emerveillé par le projet il m’a indiqué avoir fait l’acquisition d’une caméra 16 mm à une ethnologue Canadienne qui vivait en Martinique avec son mari martiniquais et s’est proposé comme opérateur. Pour la prise de son, mon frère a été initié au nagra. Un Corse qui travaillait pour la télévision à développer les bobines, M. Casanova, avait lui aussi une caméra 16 mm et rêvait de tourner. Cela nous faisait deux caméras et tout s’est fait dans le plus grand secret. Pour la pellicule, on a puisé les bobines dans le stock de la station et une fois tournées, M. Casanova les développait en cachette. Christiane, la première Antillaise envoyée à la Martinique comme monteuse parce qu’elle avait épousé un Métropolitain, a également été mise dans la complicité et je suis devenue son assistante. On a mis six mois à tourner le film, le week-end seulement car nous étions tous à travailler ou au lycée. Il fallait une actrice principale mais les essais n’étaient pas géniaux. Je me suis donc lancée et mon autre frère a incarné le personnage masculin. Une fois le film terminé, d’une durée de 52′, le directeur artistique l’a proposé en réunion de programmation avec son chef pour remplacer une énième diffusion de Mme Bovary. Il l’a regardé sur la table de montage. Il se trompait sur le titre, croyant qu’il s’appelait « La Ménagère ». Mais convaincu, le soir venu, il a annoncé l’événement avant la diffusion, récupérant l’histoire en disant qu’ils avaient ouvert leur porte à une jeune Martiniquaise. Et a encore annoncé « La Ménagère » ! C’était vraiment cocasse. Ce fut mon premier film.
Comme quoi il faut plonger !
(applaudissements) Il faut y aller ! Il faut du culot ! Ne pas attendre qu’on vous donne les choses. Quand on vous jette par la porte, vous revenez par la fenêtre.
Quelles furent les réactions ?
La télévision a été débordée de lettres se plaignant qu’il n’y avait pas encore eu de tels films et réclamant d’autres films. C’était la première fois que les Martiniquais se voyaient dans un film et où les gens parlaient le créole. Le créole était interdit à l’école. C’était un événement. Ils m’ont proposé de continuer mais je ne voulais pas bricoler et étais bien décidée à me former comme une professionnelle. Je suis donc partie à Paris pour faire une école de cinéma.
Marti, chanteur occitan, écrivait dans ses mémoires que dans la classe figurait un panneau indiquant « il est interdit de cracher par terre et de parler patois ». C’était mis au même niveau. Michel Le Bris disait la même chose pour la Bretagne. On retrouve le même phénomène de rejet de la diversité.
Oui, et c’était l’époque coloniale ! Quand on pense qu’on en trouve encore à dire qu’il y avait du bien dans la colonisation ! Dans chaque classe, il y avait un rectangle en bois verni avec l’inscription “carte créole”. L’élève de service (désigné pour toute la semaine et chargé des craies, etc.) espionnait les conversations des élèves de sa classe durant les récréations et s’il vous prenait à parler créole, il vous remettait la carte que vous étiez obligé de prendre. Il fallait se débrouiller pour la refiler à un autre avant le vendredi soir, sinon on était condamné à retourner à l’école le samedi après-midi et écrire cent fois « je ne dois pas parler créole » sur du papier. Je prenais trois stylos pour aller plus vite en écrivant trois lignes à la fois !
Vous parliez de l’influence d’Hitchcock. Serge Toubiana était présent avec nous au festival en tant que président d’Unifrance. C’est un ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Au départ, ceux qui faisaient les Cahiers étaient des critiques qui s’appelaient Truffaut, Rivette, Godard, Rohmer, etc. qui feront la Nouvelle vague. On les appelait les Hitchcocko-Hawksiens car ils soutenaient que le cinéma dit populaire de Hitchcock et de Howard Hawks était du cinéma d’auteur. Ils défendaient donc le cinéma américain. Vous qui êtes en Amérique, le cinéma de Hitchcock exerçait-il une influence importante ?
Oui, et d’ailleurs, Get out de Jordan Peel qui rencontre un grand succès est très hitchcockien aussi ! On regardait avec mes frères les films de Hitchcock et essayait de deviner qui était le coupable. Cela nous passionnait. Truffaut, Godard, Sembène Ousmane étaient aussi mes maîtres.
Vous faisiez référence à la poésie. Ce qui est frappant est que vos deux premiers longs métrages, Rue Case Nègre en 1983 et Une saison blanche et sèche en 1989, sont des adaptations de romans, le premier de Joseph Zobel et le deuxième d’André Brink.
Pourquoi être arrogant ou vaniteux ? Si vous trouvez tout ce qui vous concerne dans un livre, mieux vaut en acquérir les droits : ça vous fait gagner du temps. Adapter n’est pas copier : vous créez à partir d’une œuvre préexistante. Le livre La Rue Cases Nègres de Joseph Zobel ne rentre pas dans un film. On est obligé comme toujours, en adaptant, de prendre de réduire, de recomposer voire parfois prendre des libertés mais sans trahir l’oeuvre !
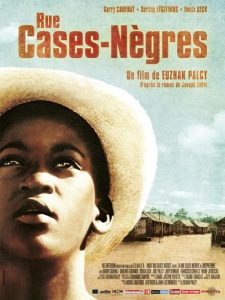 C’est un film qui vous tenait particulièrement à cœur.
C’est un film qui vous tenait particulièrement à cœur.
Oui, ma mère m’avait mis ce roman dans les mains. Elle voulait m’occuper car je posais trop de questions aux adultes et ça les énervait. Si on ne me répondait pas, je demandais pourquoi. On a fini par m’appeler Miss Pourquoi ! J’étais tout le temps avec les adultes car je m’ennuyais avec les gamins de mon âge. Ce texte a déclenché une éruption dans ma tête et dans mon corps : c’était pour la première fois pour moi le récit d’un Noir des plantations. Jamais on ne nous en parlait à l’école alors que c’était notre environnement. On nous disait que nos ancêtres étaient les Gaulois… Ce fut un choc culturel. Ce livre m’a hantée. La gamine que j’étais voyait le film en couleurs ! Il m’a obsédée. Après la prière collective, j’adressais une prière toute spéciale au petit Jésus pour grandir vite et faire un film avec ça ! On me disait pourtant que le Jésus ne voulait pas que l’on parle créole ! Du coup, un jour je l’ai regardé, et lui ai dit : “Cher petit Jésus, je t’aime et je te parle créole, je te le dis en face, punis-moi ! »
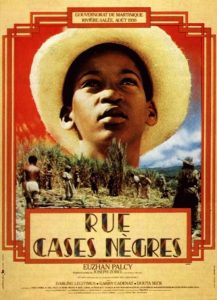 Et vous avez fait Rue Cases Nègres !
Et vous avez fait Rue Cases Nègres !
J’ai réussi à faire le film, mais non sans peine ! Il m’a d’abord fallu retrouver Joseph Zobel. Il était retraité à Anduze, dans le sud de la France, après avoir passé une bonne partie de sa vie ici à Dakar comme enseignant. Il ne voulait pas retourner en Martinique car il y avait beaucoup souffert sous la colonisation : plus on était noir, plus on était méprisé. J’avais amené le livre que ma mère m’avait donné. Il était tout abîmé. Je lui ai montré, avec tous les passages soulignés, en lui disant que j’avais déjà plusieurs versions du scénario et lui demandant de me céder les droits alors que je n’avais pas d’argent. Il m’a écoutée et m’a dit qu’il allait me faire un aveu : “Personne ne m’a jamais parlé ainsi de mon livre, avec un tel enthousiasme et une telle passion et de toute façon, j’ai toujours dit qu’il fallait encourager les jeunes ». Il se lève et prend une enveloppe sur la télévision : La Station de Ste Lucie lui demandait les droits pour une adaptation. Cela lui plaisait bien mais il préférait attendre. « Sans doute vous attendais-je » ! Il m’a donné une option indéterminée et gratuite ! Son éditeur, Présence Africaine, était furieux : donner son œuvre à une débutante ! et gratuitement !
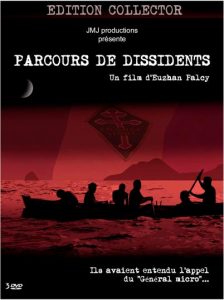 Quelle a ensuite été votre relation ?
Quelle a ensuite été votre relation ?
Nous avons lié des liens très forts lui et moi. Pour le personnage de Médouze, il m’a donné le contact de Douta Seck, qu’il voyait bien dans le rôle. Pour Zobel, il n’y avait jamais eu de retour au pays natal. Je voulais le ramener en Martinique et réparer ainsi l’injustice de l’humiliation qu’il avait subie. Il disait qu’il avait eu l’Afrique et que ça ne l’intéressait pas. J’insistais, me disant que je l’aurai à l’usure. Je lui racontais les scènes que j’avais transformées, complétant ce qu’il avait écrit. Il me donnait sa bénédiction, disant « le roman est mien, le film est tien ». Après avoir enfin trouvé l’argent du financement de ce film avec des Noirs, je lui ai dit qu’il fallait venir car il avait une scène à tourner. Il incarnait un personnage car je voulais qu’il signe ce film. J’ai fini par le convaincre. Zobel arrive à la Martinique quand je tourne la scène de la paie dans la rue Cases nègres. Toutes les stars de la musique antillaise étaient là. Les gens ont pleuré, ont applaudi, sont venus l’embrasser. Il était très touché. L’accueil était tellement émouvant que des gens se pâmaient.
Quel personnage incarnait-il dans le film ?
Joseph Zobel incarnait un personnage que j’ai créé, qui n’était pas dans le roman. Celui du curé noir. C’est Césaire qui lui avait conseillé d’écrire des romans. Zobel était surveillant dans le lycée Schoelcher où Césaire enseignait, et rédigeait des chroniques de foot pour Le Sportif, journal très apprécié par la population. Césaire avait repéré les récits de Zobel car ils étaient remarquables. C’est sous le conseil de Césaire qu’il s’est mis à l’écriture de romans. Le Mouvement de la Négritude l’influença pour le retour en Afrique. Tous ses enfants sont nés en Afrique.
On ne peut évoquer Rue Cases Nègres sans parler de Darling Legitimus.
Elle avait tourné dans 152 films français, des rôles de boniches, des danseuses, des nounous. Jamais un rôle à la mesure de son talent ! Les Noirs n’existaient pas dans le cinéma français ! C’était la grand-mère de Pascal Legitimus qui est devenu un acteur célèbre.
 Y avait-il d’autres films que vous vouliez absolument faire ?
Y avait-il d’autres films que vous vouliez absolument faire ?
Je voulais absolument porter à l’écran Rue Cases Nègres, mais aussi Pleure ô pays bien aimé d’Alan Patton qui parlait de la condition des Noirs en Afrique du Sud et faire également un film sur Toussaint Louverture, héros de la révolution haïtienne que Napoléon a enfermé dans la prison la plus froide d’Europe, au fort de Joux, puni parce qu’il aimait la France mais pas la France raciste, et surtout pour avoir défait son armée ! Comme je dis souvent, la grandeur d’une nation se mesure à sa faculté de s’approprier son Histoire avec toutes ses composantes belles et pas belles. Il faut assumer le passé pour ne pas en reproduire les erreurs.
Finalement, le livre d’Alan Paton avait déjà fait l’objet d’une adaptation.
Oui, même de deux. Mais un ami m’a présenté le chef d’oeuvre Une saison blanche et sèche d’André Brink, un Afrikaner, enseignant, professeur d’Histoire, qui luttait contre l’apartheid. Il avait refusé les droits de son roman à Hollywood, ce qui ne me laissait pas grande chance. Il était de passage à Paris et a accepté de me rencontrer. D’entrée, il m’a dit qu’en Afrique du Sud, il montrait en secret le film Rue Cases Nègres à ses étudiants. Et m’a donné les droits sans problème ! J’ai pu trouver une major à Hollywood, la Metro Goldwyn Meyer, pour avoir les moyens de faire le film que je voulais faire. C’est une production hollywoodienne, avec Marlon Brando, mais c’est un film d’Euzhan Palcy.
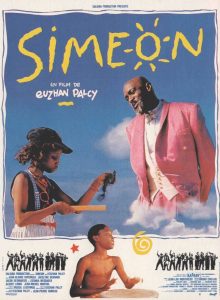 C’est l’impossibilité de réaliser les films que vous vouliez en France qui vous a portée vers Hollywood ?
C’est l’impossibilité de réaliser les films que vous vouliez en France qui vous a portée vers Hollywood ?
Malheureusement oui. Personne ne voulait de Rue Cases Nègres. Je ne suis revenue à la France qu’avec Siméon, une comédie fantastique et musicale antillaise puis Parcours de dissidents, un documentaire sur les engagés Antillais de la seconde guerre mondiale qui ont répondu à l’appel du 18 juin du Général de Gaulle. C’était un mémorial audiovisuel qui a donné lieu, 65 ans après, à la reconnaissance de leur courage avant leur mort. Mais Hollywood a aussi sa façon de voir les choses et ce n’est vraiment pas une ciné cure si je puis dire ! J’y ai reçu de multiples propositions après Une saison blanche et sèche mais les miennes ne passaient pas… Pour eux les Noirs n’étaient pas bankable et surtout si le personnage principal était une femme. Mais malgré le racisme et le sexisme, on a davantage de chances de tomber sur quelqu’un qui comprennent les choses et va mener le projet jusqu’au bout. Sur chaque nouveau projet, on repart à la case départ.
 Vous avez voulu aussi faire un hommage à Césaire avec une trilogie documentaire.
Vous avez voulu aussi faire un hommage à Césaire avec une trilogie documentaire.
Tout à fait. Je voulais que les jeunes puissent découvrir les pères de la Négritude. La parole de Césaire est une parole pour hier, plus que jamais pour aujourd’hui et demain. Elle est porteuse de force et d’espoir ! André Breton disait : “La parole d’Aimé Césaire, belle comme l’oxygène naissant !”
Débat avec la salle
Question : Merci pour l’engagement et l’humanisme. L’adaptation au cinéma a-t-elle le droit de trahir le livre ?
Une adaptation se doit de respecter l’œuvre. On ne peut pas inventer n’importe quoi. On peut transformer mais pas déformer. L’adaptation est une technique d’écriture, un art. Ce n’est pas un plagiat. Un personnage va parfois devenir composite, représentant plusieurs personnages de l’histoire. Ce n’est pas trahir l’œuvre. Un exemple : dans le roman, le gamin est allongé sur le lit de la grand-mère et lit un livre. Dans le film, je lui ai mis une oeuvre de Pagnol, Topaze. Dans mes films, il n’y a rien de gratuit. En voix-off, le gamin dit que la grand-mère l’autorise enfin à s’allonger sur son lit. Ce n’est pas dans le roman mais tout dans le roman le dit.
L’interdit était culturel, par respect pour les anciens. Cela lui permet de dire que sa grand-mère a changé. Le geste parle, le gamin le comprend. Il faut mettre les choses en images : le cinéma n’est pas fait pour parler ! L’Île nue de Kaneto Shindo n’a pas un seul dialogue et pourtant quel chef d’oeuvre !
Question : le ciné-club de Cinébanlieue passe des films chaque week-end : nous serions heureux de voir vos films !
Vous aurez mes films, c’est sûr.
Question : Quels livres devrions-nous lire ?
Lisez vos écrivains, vous allez trouver des mannes ! Moi, je rêve de porter à l’écran, avec les Africains, l’Histoire de Sundjata Keïta !
Question : Avez-vous reçu des menaces en tant que femme battante qui défend les Noirs ? La caméra est mon « arme miraculeuse”, pour utiliser une expression Césairienne ! Nous sommes là pour montrer qu’il n’y a pas que les Blancs qui savent faire et qui ont le droit d’être sur le grand et le petit écran ! Je suis pour la diversité et que tous travaillent ensemble ! Bien évidemment cela peut ne pas plaire, mais cela m’importe peu !









