Une table-ronde a réuni les cinéastes présents au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand le 2 février 2019, animée par Claire Diao qui participe à la programmation de la sélection Regards d’Afrique. Transcription intégrale. Cf. notre article sur les films africains du festival « L’intelligence des femmes ».
Claire Diao : Pour démarrer, je propose un tour de table : Où êtes-vous né ? Où avez-vous grandi ? Quelles études avez-vous suivi ?

Imwahulo
Lamar Bonhomme (Inhlawulo) : Je suis en Afrique du Sud à Durban. J’ai étudié le cinéma durant deux ans. J’ai arrêté pour devenir acteur. J’ai réalisé qu’acteur était un mauvais rêve. J’ai recommencé à faire des films il y a deux ans et Inhlawulo est mon premier court-métrage.
Ery Claver (Lúcia no céu com semáforos – Lucia in the sky with traficlights – Lucia dans le ciel avec des feux de circulation, coréalisé avec Gretel Marin) : Je suis né et ai grandi à Luanda, Angola. J’ai étudié la sociologie et un peu de philosophie, mais j’ai arrêté et j’ai commencé à travailler pour la télévision nationale. J’ai arrêté il y a deux ans et travaille maintenant dans une société qui produit des documentaires et autres films.

L’Oiseau bleu
Rafik Omrani (L’Oiseau bleu, coréalisé avec Suba Sivakumaran) : Je suis né à Tunis et ai étudié le marketing, un peu par hasard. Ayant réussi également un peu par hasard le concours de l’école nationale d’administration, j’ai fait carrière dans l’administration publique et ai ainsi travaillé durant dix ans dans la finance. Ce n’est par contre pas du tout par hasard que j’ai arrêté pour faire du cinéma. J’ai fait des courts-métrages et ai tout essayé : animation, fiction, documentaire. Je travaille maintenant sur un long-métrage d’animation.
Sade Adeniran (My Mother’s Stew) : Je suis née à Londres mais ai grandi dans un petit village au Nigeria, Idogun. Revenue en Angleterre, j’ai passé des diplômes en médias et anglais à la Plymouth University. Je n’ai pas étudié le cinéma mais ai travaillé comme assistante de vente, conseillère en affaires, manager de projets, etc. J’ai décidé de me consacrer au cinéma car je sentais que j’avais le feu et la passion en moi et que je ne m’étais jamais laissé la possibilité de l’exprimer. Je me considère davantage comme une raconteuse d’histoires. J’ai écrit un livre et réalisé des courts métrages. Je travaille maintenant sur un long-métrage d’animation.

Sega
Idil Ibrahim (Sega) : Je suis née en Californie de parents somaliens. J’ai grandi dans la diaspora somalienne aux Etats-Unis mais j’ai aussi habité au Kenya. J’ai étudié la théorie du cinéma mais aussi comment les films se situent dans un contexte politique. Mes productions sont globales mais s’intéressent au continent. Sur mon CV, on voit beaucoup « productrice » mais j’ai envie de réaliser. Je suis heureuse d’être à Clermont avec Sega qui est un projet très personnel.
Angèle Diabang (Ma coépouse bien aimée) : Je suis née à Dakar, j’ai grandi hors de Dakar et y suis revenue lorsque j’avais 14ans. Quand j’étais petite, je voulais être ambassadrice car j’étais fascinée par Barbara Hendricks. Mais en fait elle était ambassadrice non à cause du droit mais à cause de son art. J’ai étudié le droit à l’université et ai lâché quand je l’ai réalisé ! J’ai commencé par le montage au Centre culturel français de Dakar. J’ai arrêté car je me disais que je rêvais. J’ai été assistante de direction dans un centre d’appel à Dakar durant deux ans, mais je m’ennuyais et ai étudié au Media Centre de Dakar, une école de cinéma financée par la Norvège à l’époque, qui prenait six filles et six garçons chaque année. Après j’ai étudié la production à la Fémis à Paris et à la Filmakademie en Allemagne. Je viens de finir un master en administration culturelle à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Claire Diao : En tournant dans l’autre sens, combien de temps avez-vous passé à faire votre film et quel est son budget ?

Ma coépouse bien aimée
Angèle Diabang (Ma coépouse bien aimée) : J’ai eu deux jours de tournage. Il n’y avait pas de budget car je travaille sur un long-métrage sur la polygamie. Je suis documentariste et n’ai jamais réalisé de fiction. On voit dans le film la mince frontière entre documentaire et fiction, et ma timidité à franchir le pas. Durant les repérages, des femmes se confiaient à moi, notamment une femme de 64 ans qui voulait me voir. Elle a dit qu’il était important que je fasse ce film mais qu’il fallait que mes acteurs s’imprègnent de la réalité. Elle m’a donc raconté son histoire et m’a proposé elle-même de l’enregistrer. C’est comme ça que j’ai pris mon téléphone pour enregistrer et que, plusieurs femmes se confiant à moi, j’ai eu l’idée de ce film.
Idil Ibrahim (Sega) : Cela a commencé en 2011. Je travaillais sur d’autres projets mais j’avais cette histoire en tête, qui ne me quittait pas. La crise migratoire a entre-temps pris en importance, mais le film a été tourné avant que cela ne fasse les gros titres. Le montage a pris du temps car tout le monde travaillait sur d’autres projets. On l’a finalement terminé en 2018. Vu le temps que ça nous a pris, cela résonne encore plus fort par rapport au sujet. On l’a financé avec un financement participatif de 25 000 US$.
Sade Adeniran (My Mother’s Stew) : Mon film s’est réalisé par étapes, par journées sur deux ans. Cela a commencé par une nouvelle que j’ai transformée en podcast, mais en faisant mon dernier film, j’ai mis mon compte bancaire à découvert. En écoutant le podcast, je me suis dit que ça pourrait faire un bon film mais je n’avais pas les moyens d’une production. J’ai écrit le scénario et ai pensé à en faire une animation. Je ne dessine pas et j’ai donc embauché un dessinateur, lui précisant ce que je voulais. Il a fait un storyboard. On a eu beaucoup d’allers-retours pour arriver à la forme que je voulais. Sur la base de ses dessins, j’ai trouvé quelqu’un pour les animer informatiquement. J’ai ensuite réalisé le montage de ces images avec le son et la musique. Le budget s’est résumé aux salaires du dessinateur et de l’animateur.
Rafik Omrani (L’Oiseau bleu, coréalisé avec Suba Sivakumaran) : C’est un film réalisé dans le cadre de la Tunisia Factory de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, donc avec des contraintes : 15 minutes et une coréalisation avec quelqu’un que l’on n’a pas choisi. Par contre, un budget suffisant. Le défi était de coécrire le film. Ma coréalisatrice était sri-lankaise et ne connaissait pas du tout la Tunisie. On s’est rencontré une première fois à Paris et nous avons parlé du contexte tunisien. Nous sommes tombés d’accord sur le fait d’en parler sur un mode léger. Nous voulions le faire en s’amusant et c’est ce qui s’est passé. L’écriture a pris une semaine, le tournage cinq jours et la postproduction cinq jours, ce qui était court. Les quatre films ont été produits ensemble : ce sont les producteurs qui connaissent les chiffres.

Lúcia no céu com semáforos – Lucia in the sky with traficlights
Ery Claver (Lúcia no céu com semáforos – Lucia in the sky with traficlights), coréalisé avec Gretel Marin) : Nous n’avions aucun budget. J’ai eu de la chance car j’ai pu mobiliser mes amis. Chaque fois que je leur fais un câlin, ils me disent ok ! Le film a été aisé à tourner, en trois jours. Le cauchemar a commencé avec le montage. J’ai écrit un poème de 50 pages, basé sur une série d’entretiens avec des femmes victimes de violences domestiques. J’ai créé ce personnage de Lucia pour mettre toutes ces femmes dans une seule, mais le poème devient pour moi un peu confus car il y a trop de voix… Comme je suis un homme, j’ai invité ma collègue Gretel Marin, une réalisatrice, pour m’aider à développer ces voix. Nous avions beaucoup de scènes mais très peu de temps pour le montage car nous devions montrer le film au festival intitulé Fucking Globo. Nous n’avions qu’une plage de 15 minutes pour le film. Il a donc fallu condenser tout le poème et les images en 15 minutes.
Lamar Bonhomme (Inhlawulo) : La société de production a reçu un budget conséquent pour faire dix courts métrages en un an. En fait, cela a pris trois ans. Le mien était un des premiers à être réalisé. Je ne sais pas quel en était le jour. Il devait être tourné en cinq jours mais le troisième jour, il a commencé à pleuvoir alors que tout le film est basé sur une sécheresse sans fin ! C’était bien pour le pays mais pas pour le film ! On est revenus quinze jours après et je n’avais qu’une journée pour terminer le film qui n’était qu’à moitié fini… En plus, la costumière a oublié les costumes ! Au final, je n’avais plus que six heures pour tourner le tout ! Etonnamment, ce fut la partie la plus productive de mon tournage : quand j’avais du temps, c’était chaotique et quand je n’en avais pas, tout allait bien ! C’était en 2017 et comme il y avait dix courts métrages à réaliser, la post-production a pris un an et demi, et de mon point de vue, le film n’est pas terminé.
Débat avec la salle
Question : Est-ce que vous vous posez la question de la réception de vos films ? Y a-t-il des espaces de diffusion pour les courts-métrages et quelle en a été la réception ?
Lamar Bonhomme (Inhlawulo) : Clermont est la première projection. Il y a beaucoup de festivals en Afrique du Sud, mais c’était le premier festival où l’on a présenté le film. C’est aussi la première fois que je vais à un festival.
Ery Claver (Lúcia no céu com semáforos – Lucia in the sky with traficlights), coréalisé avec Gretel Marin) : J’ai montré ce film au Videoex de Zurich et au Curtas Vila do Conde au Portugal. En Angola, je l’ai montré un peu partout. La réception du public était variée. La plupart des gens me complimentent pour l’esthétique mais restent confus face au récit. C’est vrai qu’il est confus pour moi aussi ! J’apprends de mon film. Parfois il est sombre, parfois lumineux, et des fois je suis moi-même très perdu ! Il n’y a pas vraiment des salles de cinéma en Angola. Il n’y a que des multiplexes hollywoodiens dans les centres commerciaux. Du coup, on adapte des lieux pour montrer les films, par exemple un espace dans le centre de Luanda dans un hôtel abandonné, occupé par un collectif d’artistes qui y organise beaucoup de choses. On voudrait de même occuper des endroits de ce type dans le reste du pays pour faire de même.
Rafik Omrani (L’Oiseau bleu, coréalisé avec Suba Sivakumaran) : En Tunisie, ce n’est pas le paradis pour les salles de cinéma mais on a sans doute plus de chance. Il y a des salles engagées et maintenant aussi la Cinémathèque, mais bien sûr peu d’occasions de passer dans les salles commerciales. Le film a été vu en France, en Belgique, au Maroc, en Tunisie et divers festivals. Certains aiment l’atmosphère du film. D’autres vont plus loin pour aborder les conflits entre les personnages. Cela nous fait plaisir mais dans tous les cas, on est contents !
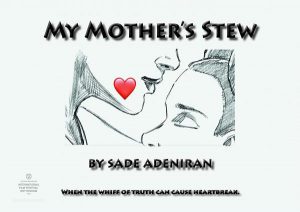
My mother’s stew
Sade Adeniran (My Mother’s Stew) : La réaction du public m’a beaucoup étonnée. Elle était positive pour moi car au départ je ne voulais le diffuser que sur youtube. Un ami m’a convaincu de le proposer alors que je ne pensais pas qu’un festival en voudrait. J’avais tort. Il a été sélectionné dans différents festivals, notamment au Nigeria. Les retours étaient parfois brutaux mais aussi très gentils ! Les cinémas au Nigeria ne passent que des films commerciaux : il n’y a pas de place pour les courts.
Idil Ibrahim (Sega) : Clermont est une première française. Le film a été projeté aux Etats-Unis et en Angleterre, et le sera bientôt en Egypte. Je serais heureuse de le montrer au Sénégal où il se déroule ! Les débats portent sur la migration. Les gens me demandent des chiffres… La Somalie est très fragmentée mais très concernée par les questions de migration. J’espère pouvoir le montrer dans le Somaliland, au nord de la Somalie, mais aussi dans tout le Continent car il y a beaucoup de similarités de situations.
Angèle Diabang (Ma coépouse bien aimée) : C’est le troisième festival pour le film. Il a été projeté au festival Dakar Court, le nouveau festival de courts métrages de Dakar. La version montrée n’était pas sous-titrée si bien que les professionnels présents qui ne comprenaient pas le wolof ont surtout voulu savoir ce qui était dit. Par contre, les femmes sénégalaises m’ont encouragé à poursuivre mon travail. Au niveau des salles, c’est semblable aux autres pays : quelques salles montrent des films américains. La salle du centre culturel français propose autre chose. La Tunisie nous paraît paradisiaque à ce niveau : il y a de grandes salles et elles sont pleines durant les Journées cinématographiques de Carthage ! Le tournage a duré deux jours mais le montage a pris une année : le sujet était délicat et, n’ayant pas d’argent, j’ai fait le montage moi-même. Ce sont des histoires vraies et il fallait faire très attention à ce que je retenais. Le film étant tourné, il me fallait choisir très attentivement les voix pouvant correspondre aux images. J’ai changé plusieurs fois les voix pour arriver à ce que voix et images résonnent correctement.
Question à Idil Ibrahim : Vous êtes américano-somalienne et le film se déroule au Sénégal ?
Idil Ibrahim (Sega) : J’ai habité au Sénégal en 2011 durant cinq mois. C’est à cette époque que l’on m’a raconté ce genre d’histoires. Je n’ai réalisé le film que plusieurs années après. C’était alors un moment où beaucoup de jeunes prenaient les pirogues pour aller aux îles Canaries. J’ai parlé à des amis, ai commencé à réaliser des interviews documentaires. Cela a pris longtemps pour se développer. Je revenais au Sénégal de temps en temps et j’y suis allée encore quelques mois pour le tournage.
Question à Ery Claver (Lúcia no céu com semáforos – Lucia in the sky with traficlights) : Le titre de votre film est-il inspiré de la chanson des Beatles Lucy in the sky with Diamonds ?
Ery Claver : Bien sûr. C’est une de mes groupes préférés. J’ai utilisé les feux de signalisation en raison de la métaphore de ces trois lumières. C’est pour moi une métaphore de la vie : quand vous marchez dans la rue, cela peut être rouge ou vert. Cela ne dépend pas de vous mais de la chance. J’aimerais pouvoir éditer le poème pour que l’on puisse mieux comprendre ce que j’ai voulu dire avec ce film.
Autre question à Ery Claver : Comment avez-vous fait pour transcrire votre poème en film ?
Ery Claver : J’ai travaillé pour la télévision et ai fait un reportage un jour sur la violence domestique, qui m’a beaucoup impressionné. J’ai commencé à écrire un poème sur ces femmes. Mais je voulais que ce soit un seul personnage. Cela devenait très visuel en écrivant : cela pourrait être un film. Mais je savais la difficulté que cela serait de transcrire les mots en images. Gretel Marin m’a aidé à traduire mon poème en film. Elle m’a dit que j’étais quelqu’un de très visuel mais je lui ai répondu que je voulais qu’une femme y mette son point de vue.
Question à Lamar Bonhomme (Inhlawulo) : Pourquoi la fille part avec l’homme qui a tué son père ?
Lamar Bonhomme : Quand j’ai écrit le film, je voulais parler de ma relation avec mon père. Il est devenu le beau-père. Sa fille doit choisir son camp. Mais maintenant, j’écris un long-métrage. Il n’est plus le beau-père mais le père ! Cela m’a ouvert à beaucoup de questions essentielles sur la paternité, qui ne pouvait pas être transcendée en d’autres personnages. J’ai montré le film à des amis qui travaillent dans le cinéma et la principale critique était le côté unidimensionnel de l’antagonisme. Il n’est pas assez dynamique. Je pense que c’est effectivement ce qui fait de bons personnages. C’est donc la principale leçon que j’ai retirée de cette expérience. Quand j’aurai précisé cet antagonisme, la fille pourra partir avec lui sans qu’on me demande pourquoi !!
Question : Comment trouvez-vous l’argent de faire des courts métrages en Afrique ?
Lamar Bonhomme (Inhlawulo) : Il y a des fonds ou non, mais on peut faire un film sans argent en Afrique du Sud car il vient avec les conditions générales. Une fois cela posé, après la réalisation de Moonlight, qui est un de plus beaux films fait avec peu de moyens, je ne crois pas que nous ayons encore des excuses. Ce film n’avait pas un budget supérieur à ce que les Sud-africains disposent pour faire leurs films. Le cinéma est intéressant quand il faut travailler sous contraintes. Quand la proposition est trop large, on ne sait pas quoi faire. Si on a une caméra, une focale, un acteur, un lieu de tournage, on peut se permettre de créer des paramètres.
Ery Claver (Lúcia no céu com semáforos – Lucia in the sky with traficlights), coréalisé avec Gretel Marin) : Nous n’avons pas de financement public en Angola, à moins de faire les histoires attendues par le gouvernement. Les idées sont censurées. Les artistes ne veulent pas de cet argent et préfèrent travailler de leur côté. C’est ce qui se passe à Luanda.
Rafik Omrani (L’Oiseau bleu, coréalisé avec Suba Sivakumaran) : En Tunisie, l’Etat soutient le cinéma. C’est limité face au grand nombre de projets, mais on s’estime heureux par rapport à nos voisins ! Il y a aussi des fonds indépendants qui ont ouvert une fenêtre pour les courts métrages, par exemple l’AFAC (Arab Funds for Art & Culture), un fonds destiné aux pays arabes. Le Doha Film Institue est également très efficace. On profite de notre position à la fois africaine et arabe. Mais cela prend beaucoup de temps pour les dossiers…
Sade Adeniran (My Mother’s Stew) : Il n’y a pas de fonds au Nigeria pour les courts métrages, mais les gens arrivent à faire des films. Il y a des fonds en Angleterre mais je n’y ai pas accès. Cela dépend du genre d’histoire qu’on raconte : les miennes ne sont pas retenues. Au Nigeria, les banques font des prêts pour les films mais cela signifie s’endetter pour longtemps !
Idil Ibrahim (Sega) : Il n’y a pas de fonds pour le cinéma en Somalie. Des ONG américaines financent des films mais il faut postuler en tant que cinéaste indépendant. Les campagnes de financement participatif sont une alternative.
Angèle Diabang (Ma coépouse bien aimée) : Au Sénégal, nous sommes contents d’avoir un fonds, le FOPICA. Nous attendons les résultats de la commission mais il faut pour cela que les élections soient passées pour savoir si le fonds sera encore abondé. Pour le moment, c’est le stand-by. Deux milliards de FCFA pour le cinéma, c’est énorme et je souhaite que le président élu assure la continuité du Fopica !









