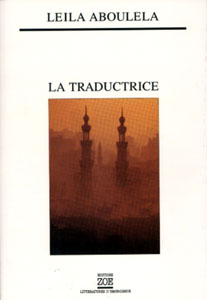Facile d’accès et de lecture, on imagine aisément Le Sang est toujours rouge de l’anglo-jamaïcaine Leone Ross adapté en une de ces séries télévisées de chroniques urbaines, version Black London : trois femmes, étudiante, actrice, journaliste, partagent appartement et confidences. Ross n’hésite pas à faire le parallèle entre les minorités raciales et sexuelles et la condition des femmes, qui » sans être une minorité, se sentent une minorité « .
En voulant faire abstraction des clichés, les personnages de Ross s’y heurtent encore plus violemment. De Nicola l’actrice qui pense que sa relation avec son metteur en scène blanc pourrait être vue juste comme une histoire d’amour, à Jeanette l’étudiante qui multiplie les aventures et croit qu’elle peut » baiser comme un homme » sans se faire remettre à sa place un jour ou l’autre, tous les personnages se laissent prendre au piège. L’égalité, rien qu’un doux rêve ? Ross préfère revendiquer un franc-parler nécessaire pour vivre ensemble. Elle dépeint des hommes noirs avec » trop de problèmes dans leur tête « , occupés qu’ils sont à dénoncer la discrimination dont ils sont victimes, mais non moins auteurs quand il s’agit de la gent féminine.
Certains n’apprécient pas et reprochent à Ross de renforcer des stéréotypes raciaux. Elle proteste : » Je souffre autant que les hommes noirs des préjugés raciaux. Mais être noir n’excuse ni le viol ni l’agression et quoi qu’on en dise, les hommes noirs, eux aussi, violent des femmes ! »
Secouer les images trop lisses, Leone Ross s’y était déjà attelé dans Le Rire orange. Son excellent deuxième roman, paru en France en 2001, est d’une intensité tout autre. Plus touffu, plus abouti dans sa structure et dans son écriture, il défie le lecteur par la voix de fou furieux de Tony, beau garçon réfugié dans les tunnels du métro new-yorkais. Ross n’a pas manqué de chambouler quelques âmes sensibles en faisant de son héros noir pire qu’un fou violent, un bisexuel. » Enfin, les Noirs ne sont pas pédés ! « , rit la jeune femme.
Maryse Condé choisit l’Afrique du Sud. Un pays où race rime toujours avec ségrégation, certes plus subtilement basée sur l’économie mais tout aussi efficace. Ici peut-être plus qu’ailleurs, la couleur de la peau assigne une place, instaure un ordre. On est tenté de voir des éléments autobiographiques dans le portrait de Rosélie, Guadeloupéenne d’abord mariée à un Africain, puis compagne d’un Britannique, passée par l’Afrique de l’Ouest et New York pour finir au Cap. Mais passons. Cela a peu d’importance face au portrait désarmant que nous fait Condé.
Histoire de la femme cannibale aurait pu s’intituler » histoire de la femme invisible « . C’est sous ce paradigme que Condé explore les relations interraciales : la femme noire ne peut être qu’invisible aux côtés d’un homme blanc. Invisible parce que sans personnalité, sans histoire, sans intérêt autre que celui d’un cliché, bien cadré, bien défini : pute, bonniche ou potiche, les regards blancs assignent vite sa place à Rosélie. » Ma femme « , dit Stephen en se délectant de l’effet de surprise, voire de malaise qui s’en suit. Rosélie préfère se terrer dans son atelier.
Dans les regards de ceux qu’on appellerait communément » les siens « , Rosélie a droit à une autre version : celle qui veut » un peu de blancheur dans sa vie « , celle qui » a trahi « . Elle a arrêté de se justifier.
Par petites touches, Condé dissèque subtilement toutes les étiquettes auxquelles Rosélie tente d’échapper, sans arriver à autre chose qu’une position d' » outsider « , en retrait, s’observant de loin. Un fil ténu sépare le » je » du narrateur extérieur, on pourrait s’y perdre et pourtant Condé rattrape admirablement la narration là où elle est déjà en train de dériver.
S’y glisse une délicieuse pointe d’ironie sur l’intelligentsia africaine, sur la petite bourgeoisie noire américaine si politiquement correcte, sur les Dogons » en tête du hit-parade ethnologique « , sur le tourisme culturel. On ne peut s’empêcher de sourire en voyant débouler un car de » Africultural Tours » !
Reste le portrait émouvant d’une femme en deuil, dans un désarroi profond, sans amarres, alors que les faibles certitudes de sa vie s’effritent une à une, la laissant pantelante de solitude.
Comme Rosélie, Sammar est veuve. Tariq est mort dans un accident de voiture en Angleterre. Après un bref détour par le Soudan, Sammar revient en Angleterre, assommée par le chagrin, laissant derrière elle son fils auquel elle a du mal à pardonner d’être en vie.
Autant Rosélie est tributaire du regard des autres, autant Sammar semble ignorer les rôles qu’on voudrait lui prêter. Elle avance en décalage constant par rapport au lieu où elle se trouve, rêvant de Soudan en Angleterre et d’un Anglais au Soudan. Elle ne comprend pas le discours de sa collègue d’origine pakistanaise qui parle d' » eux » et de » nous « , pour elle ce ne sont que des individus, tous aussi distants.
Ici, plus que la race, c’est la religion qui dresse des barrières. Musulmane fervente, Sammar s’éprend d’un Anglais certes spécialiste du monde musulman mais non moins athée ou presque, au grand désespoir de Sammar qui fait au passage voler en éclats quelques clichés de soumission. Voilée et pratiquante, la religion ne l’empêche jamais de faire ses choix, aussi audacieux soient-ils comme de demander en mariage l’homme que l’on aime, en exigeant sa conversion.
Le charme d’Aboulela est dans son écriture d’une extrême douceur, constamment à l’écoute des sens, du toucher, de l’odorat. On reste quelque peu perplexe en fermant le livre, tant cette douceur est prégnante, tant le portrait de Sammar fait abstraction de la race, érigeant la religion au-dessus de toutes les différences bassement temporelles et séculaires. La religion ferait-elle fi à ce point des races et des cultures ?
Quelle naïveté, rétorquerait peut-être Ross, fidèle à sa verve. Pourtant, dans ce roman, on est presque tenté d’y croire
Histoire de la femme cannibale, de Maryse Condé. Mercure de France, 2003, 320 p., 18 .
La Traductrice, de Leila Aboulela. Traduit de l’anglais (Soudan) par Christian Surber. Zoe, 2003, 242 p.
À lire aussi :
La Belle Créole, de Maryse Condé. Folio, 2003, 306 p. ///Article N° : 3004