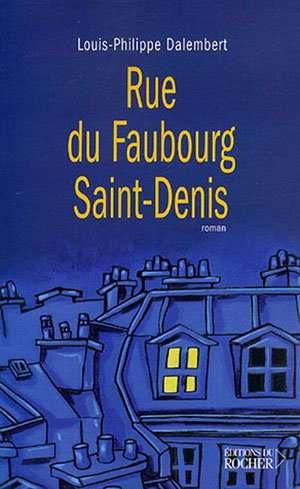Voici le plus beau jour de ma vie, car je vais au livre. Je sais que ma destinée, si singulière, finira dans un livre. Je meurs comme un livre se ferme. (
) Je meurs, mais je tranche.
G.-P. Effa
Elle souffrait comme c’est pas permis pour un chrétien. Son corps devenait un tremblement de terre à lui tout seul. Sa bouche un torrent en crue. Ça débordait de partout.
L.-Ph. Dalembert
Gaston-Paul Effa, philosophe et romancier camerounais, nous revient avec un récit au titre prophétique : Voici le dernier jour du monde. » Revenir » est en effet le verbe qui convient. L’auteur y fait part de ses connaissances en tout genre (des Fleurs du mal aux références philosophiques, de la théologie au Talmud, de Goya à Géricault, tous renvois souvent cachés, c’est-à-dire digérés). Il donne surtout la parole à un narrateur – écrivain comme lui -, qui avoue avoir quitté l’Afrique à 14 ans. Lorsqu’il y retourne vingt ans plus tard, c’est pour se faire le mémorialiste du chaos. D’où le titre déjà cité ; en voici l’explication : » La Bible dit que lorsque les hommes d’Église rencontrent l’iniquité, c’est l’annonce de la fin du monde « . On apprend très rapidement qu’un prélat a été tué par son jeune amant ; une femme danse sous la pluie, appelant le boa, qui, en copulant avec elle, la rendra riche. Plus loin, on retrouve l’allusion à la » fin du monde » dans la bouche de l’antihéros du roman, Fabien, doyen de l’université de Goa, capitale de la République de Bakassi, à qui il doit de revenir au pays. Mais le retour du narrateur est motivé par d’inavouables arrière-pensées, lesquelles ne se dévoilent qu’à toute fin du récit, et dont l’incipit rend compte parfaitement. Où l’on découvre que Voici venu le dernier jour du monde, un texte apparemment dépourvu d’intrigues, en est magistralement pourvu. En voici l’aveu : » Je n’ai pas connu mon pays. J’avais quatorze ans à peine lorsque je le quittai. En France mes livres n’avaient plus guère de succès. Même les Français avaient compris que pour colorer leur style, leurs romans devaient se nourrir de négritude ; Erik Orsenna, Philippe Duval, Patrick Grainville
M’avait-il donc fallu vingt ans pour retrouver tout cela, qui ne m’avait jamais quitté ? Ou en avais-je voulu si fort à ce continent, à cet enfant noir que j’avais été, avais-je tant aspiré à me délivrer de lui, que je l’avais étouffé et empêché à me délivrer de lui, que je l’avais étouffé et empêché de renaître ainsi pendant vingt ans ? « .
Le narrateur, à peine débarqué, tantôt s’identifie à sa patrie, tantôt exprime des réserves à son égard. Il y a une ambiguïté fécondante en lui – au vrai, une perversité insondable -, une forme de lucidité qui lui permet d’asséner des phrases politiquement incorrectes, du genre : » La BEAO : Banque des États d’Afrique en Or « , ou encore : » Et dire que l’OMC a décidé de baisser le prix des médicaments génériques, des antiviraux pour sauver nos vies ici. Tout est bon pour faire l’événement. Surtout la maladie. Le meurtre. Plus on est malade, mieux c’est. Plus on infecte, plus on est heureux « . Notre écrivain-narrateur, on le voit, n’entonne pas le Chant général (Pablo Neruda) des retrouvailles ; il établit plutôt le constat d’un état de folie généralisée. Son attitude constante est celle d’un être lisse, tempéré, dévoué, gentil, humain sans être pour cela démonstratif. En fait, il cache bien son jeu. Pour rendre crédible son personnage, Gaston-Paul Effa a pillé sa propre biographie, l’actualité mondiale et, particulièrement, celle de l’Afrique pour construire l’autobiographie fictive d’un pays qui ressemble au Liberia, mais qui se trouve situé en Afrique centrale. On s’y massacre en vue de passer sous l’égide des États-Unis. Même si la langue du roman est le français, il n’est pas vraiment précisé qu’on la parle dans le pays en question (Bakassi). Ses voisins sont le Nigeria, l’ancien Zaïre et le Congo. Gaston-Paul Effa commet des anachronismes au gré de ses propositions, nous faisant vivre tantôt dans un pays qui ressemble au Mali, au Sénégal – et même à la Gambie -, tantôt dans un pays qui ressemble au Cameroun et au Congo.
Le malaise, en vérité, ne quitte pas le narrateur. Comme écrivain, il est l’exemple saisissant de ces Africains dont l’imaginaire s’est totalement éloigné de l’Afrique. Nous saurons même à la fin qu’il la hait. Comme les Occidentaux, lui aussi a appris à en jouer pour des desseins parfaitement mercantiles, c’est-à-dire médiatiques et meurtriers. Il est vrai que l’Afrique adore l’enfer. La phrase qui la restitue s’élève, accède à un palier, s’y maintient brièvement et, après un ou deux rebonds, atteint à son paroxysme avec l’imparfait du subjonctif. Puis elle descend : la saveur de la conjugaison oscille entre un contentement de bon aloi et le sentiment que l’épreuve temporelle, à coup sûr, s’est chargée de mélodie. Elle décante les modes verbaux comme un bonbon acidulé. Ici, un tel art est dans son élément : le thème du retour est l’un des seuls qui, chez les écrivains, autorise l’usage de la confidence. Gaston-Paul y excelle. Il s’y dévoue à la manière des poètes pour qui une phrase ne tient jamais que par son chant.
Est-ce là l’élément qui donne à Voici le dernier jour du monde sa structure » rhapsodique » ? On y progresse par une série de courts chapitres (une, deux ou quatre pages – rarement six ou neuf), où l’auteur s’ingénie à inventer les histoires les plus cauchemardesques. La liberté de la phrase assure celle d’une imagination devenue gothique. Une imagination d’autant plus gothique que Fabien, un midi, se voit démis par un communiqué radiodiffusé de son poste de doyen. Sa maîtresse, la Française Rosie M., est, quant à elle, promue consul général de France à Gao. Voilà qu’arrive son frère, André M., qui, bientôt, accède à la fonction d’Ambassadeur. La jalousie étouffe Fabien, car le frère et la sur trempent dans des trafics de toutes sortes, notamment ceux des visas. Mais ce sont les interrogatoires, les tortures et la guerre civile qui auront raison de son intégrité psychique et physique. Nous basculons dès lors dans l’univers des survivants. La bouche de Fabien ne connaît qu’une rengaine : » Ça va aller « . En fait, il veut dire : » No future « , mais la force qu’exige cette parole de révolte lui fait défaut. La précarité est une usine à façonner l’espérance ; » ça va aller » est l’autopersuasion du mourant. Au passage, Gaston-Paul se cite lui-même : Le cri que tu pousses ne réveillera personne (1).
Rosie est bientôt égorgée dans sa maison. Bien entendu, la police accuse Fabien, son amant. Le narrateur soutient son ami, il le protège et le suit dans sa chute. Il l’éloigne de ses persécuteurs. Bakassi se couvre de cadavres ; on dirait un nouveau Rwanda. Cette fois, les chrétiens cèdent la place aux islamistes. Les deux amis sont en dérive. Les voici au pied des Monts Nimba. On y exploite des mines de charbon. André M., le frère de l’infortunée Rosie, se trouve être un gros actionnaire de l’entreprise. Il vient souvent parader dans les puits d’exploitation. Un éboulement enterrera André et Fabien. Pour ce dernier, cette mort est un couronnement logique. C’est même une délivrance. Il a humé les cimes ; le voilà qui réintègre les abîmes, son tombeau. C’est aussi l’instant que choisit le narrateur pour tomber le masque.
Ce qu’il nous dévoile du destin de Rosie, d’André et de Fabien est véritablement insoutenable. Notre écrivain est venu en Afrique pour écrire un livre de chair et de sang. On peut affirmer qu’il est servi, et même bien servi. Les événements, tels qu’il les a exploités, vont, bien sûr, lui assurer la célébrité. Erik Orsenna, Philippe Duval et Patrick Grainville n’ont qu’à bien se tenir. Pour les égaler, le narrateur deviendra un assassin. Comment y parvient-il ? À quelle étape du roman ? Et quelles sont ses victimes ? Au lecteur d’aller les découvrir par lui-même. Ce qui est sûr, Voici le dernier jour du monde n’est pas, comme on aurait pu s’y attendre, la révélation des présupposés métaphysiques de l’implosion africaine. Au contraire. Il se révèle n’être qu’une sordide machination d’écrivain en mal de reconnaissance. Le comble du cynisme, en somme.
L’autre fin du monde se passe à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, qui est aussi le titre du roman et l’adresse où habite son auteur. Il nous est raconté par le romancier haïtien Louis-Philippe Dalembert. L’autre jour, en débarquant Gare du Nord, en provenance d’Amiens, je me rends au bureau de poste du square Alban Satragne (qui se trouve à droite du boulevard Magenta, dans un enfoncement). J’aime bien cette poste. On y rencontre tout ce que la France compte d’immigrés de la toute petite classe : ouvriers du bâtiment, journaliers du chemin de fer, retraités décatis (des Maghrébins pour la plupart), des Roms au verbe haut, des Africains et Antillais douloureux et silencieux, des Pakistanais, des Yougoslaves, des Khmers, des Viets, des Chinois, des Français rongés par la précarité, en un mot, le spectre le plus édifiant de la misère urbaine. Les guichetiers font face avec une dignité admirable. C’est cette faune-là que Louis-Philippe Dalembert saisit à bras le corps, et qui plus est avec simplicité, avec maestria. Avec amour aussi. Et avec la conviction et la sincérité qui rendent possible l’hommage aux petites gens et l’hommage, en ce qui concerne l’écrivain qu’il est, aux auteurs qui ont formé sa sensibilité. L’un d’eux est ici particulièrement salué : Romain Gary alias Émile Ajar, et son inénarrable La vie devant soi. Faut-il rappeler que Le crayon du bon de Dieu n’a pas de gomme (1996, éditions Stock) de Louis-Philippe Dalembert était déjà un emprunt au roman qui avait valu à son cripto-auteur de recevoir pour la seconde fois le Prix Goncourt en 1975 (après Les racines du ciel en 1956), unique doublet historique dans les annales des lettres françaises ? Dalembert montre là sa dette envers le maître. Même avec la vogue de l’intertextualité, peu d’écrivains dévoilent leurs sources. (Verre cassé est un cas à part.) Plus rares encore sont ceux qui peuvent s’autoriser d’inclure dans leur récit douze citations parfaitement balisées. On s’expose en agissant ainsi ; on s’expose surtout à une forme de comparatisme dont on peut faire les frais. En effet, les fragments de La vie devant soi distillent une poésie de la lenteur où la voix du narrateur surprend par l’écart savant qu’il fait des formules les plus convenues : il les détourne sans faire des vagues. Nous en sommes tout retournés ; or il s’agit de petits riens. Rue du Faubourg Saint-Denis, lui, parle le » faubourien « , un mélange de verlan et d’argot au relent de naturalisme banlieusard. Le contraste est quelquefois saisissant.
Mais à bien examiner le faubourien dalembertien, on est surpris par sa virtuosité. Citons quelques exemples : » Y a aussi le Polonais rital. (
) À cause de lui, une fois j’ai gazé jusqu’au pont Mirabeau regarder la Seine couler pour que dalle » (p. 38) ; » J’ai beau essayer de causer à son image, parfois, ça m’échappe. Et puis, je me sens pas » (p. 46) ; » Parfois, dit-elle, la vie peut peser plus lourd qu’être en cloque de triplés » (p. 57) ; » C’est pour ça que maman et moi on se serre de si près que parfois on se marche sur les orteils. Pour ne pas se perdre » (p. 80) ; » C’est leur façon de causer, les petits vieux. Comme ils marchent en fait. Ils mettent un temps fou à aligner deux mots l’un à la suite de l’autre. Comme s’ils étaient en rupture de stock » (p. 97) ; » À croire qu’elle prenait son pied à se chagriner » (109) ; » Les keufs semblent gênés. Ils sont pris de court. La naïveté de maman a désamorcé le regard noir qui sied à leur rôle » (p. 127) ; « Alors quand l’autre il s’est amené avec sa gueule à caler des roues de corbillard et qu’il nous a fixés à l’entrée de l’église pour nous demander ce qu’on comptait faire des cendres, maman a rien pigé » (pp. 157-158) ; « Elle avait plein de cheveux sur la tête, ma’ame Bouchereau. On aurait dit qu’ils prenaient du volume à mesure que son corps se ratatinait et que ses poteaux enflaient. En une manière de défi au temps. Dont les seuls effets se voyaient dans leur blancheur uniforme et éclatante » (p. 161), etc.
Le découpage du roman en séquences cinématographiques accentue sa virtuosité. Ti-Jean, le narrateur du célèbre faubourg (débaptisé à juste titre » Onu » tant il est cosmopolite) y relate la canicule 2003 qui a décimé quelque 5 000 vieux parisiens. Ti-Jean avait connu intimement l’un d’eux : Mme Bouchereau. Mais comment raconter cette histoire, quand on ne parle que la langue de sa tribu (le faubourien) ? Ti-Jean n’a jamais oublié les mots de sa prof de gaulois, qui lui conseillait toujours, en citant Pierre Corneille : » Qu’en un jour, en un lieu, un seul fait accompli / Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli « . La règle d’or du théâtre classique vaut pour tout récit – du moins, pour l’efficacité narrative – et pour le cinéma du XXe siècle, même lorsqu’on parle le verlan. Car il n’est pas chébran, le petit Jean. Mélange d’antillais, d’africain et de gaulois pur porc, l’infortune de sa mère lui vaut de subir la vie, lui qui connaît sur les bouts des doigts la cinématographie la plus exigeante, toutes les séries américaines, les westerns, Léo Ferré et les chanteurs nanars, les boxeurs de légende, idem pour le foot, idem pour l’histoire française
Avec ça il est tout de même un déshérité, un préado, confesse-t-il – mais faut-il le croire ?
Djibril, un Algérien surdiplômé, est devenu pâtissier. Il le protège et lui refile le makroud et les cheveux d’ange. Il y a aussi m’sieu Kahn, un anar, un ancien avocat – ce qui est incroyable ! Il y a surtout m’ame Bouchereau, une vieille dame, une juive rescapée des camps. À force de patience, maman Brigitte et Ti-Jean ont réussi à l’apprivoiser. Brigitte lui fait son ménage, son fils l’occupe à ses heures : l’une et l’autre reçoivent de la menue monnaie en contrepartie. En vérité, ces deux Blacks-là, mère et fils, sont devenus la seule famille de cette gauloise aux jambes éléphantesques. Elle déteste les Arabes, tolère ces Noirs-là qui, forcément, le sont moins à ses yeux
Mais petit Jean ne se doutait pas qu’à travers Mme Bouchereau il connaîtrait la première mort – pour de vrai – de sa vie, le premier suicide – en fait, qui plus est, en pleine canicule, laquelle, historique comme on sait -, leur voudra d’être suspectés pour meurtre, même s’ils sont innocentés dans les heures qui suivent. Par la même occasion, ils se découvriront – stupéfaits et un brin scandalisés – héritiers de celle que la police croyait être leur victime, laquelle a exigé d’être incinérée – ce qui les révolte.
Ti-Jean, fidèle à son nom, tisse une histoire où c’est lui, l’enfant-miracle, le Petit Poucet des îles vaudouïsantes, qui tire les ficelles, respectueux en cela de l’avis du grand Corneille. Puisqu’il adore le cinéma, il va écrire le scénario idoine. Cette intention traduit la volonté de dominer son destin – et le rêve, en effet, est sa voie royale. Dalembert procède comme Dany Laferrière dans Le goût des jeunes filles. Ti-Jean a la malignité des personnages du Montréalais : malin, mutin, badin
mais pas farceur pour un sou. Le cinéma ne donne jamais à voir que du rêve. En un certain sens, il opère tout seul : le scénariste y compte pour du beurre. Ti-Jean l’avoue : » Alors je lui cause [à sa mère]. J’aligne des mots auxquels je crois peut-être même pas. Je sais pas si c’est du cinoche ou pas. Mais ça marche « .Voilà comment on terrasse son blues dans un studio qui n’a qu’un lit, un clic-clac que l’enfant partage avec sa mère. La promiscuité est aussi le sport auquel s’adonnaient leurs rares visiteurs – du moins, du vivant de son père : » Au bout d’une heure après avoir fait leur cinoche et avalé leur breuvage mielleux, ils ramassaient leur négritude (il mérite au moins le Nobel, ce gros mot) et se tiraient sans demander leur reste « .
La phrase de La vie devant soi diligente une douce et constante implosion. Elle est de bout en bout souffrance, de bout en bout beauté, de bout en bout chant. Louis-Philippe Dalembert atteint lui aussi à une semblable réussite avec Rue du Faubourg Saint-Denis. Qu’il nous parle de la mort d’Opium et Tornade, le chien et le chat de Mme Bouchereau, ou de la messe des morts que maman Brigitte, face au chandelier à sept branches – voilà qui est peu catholique ! -, dans sa petite chambre, dirige en récitant la Bible, on voudrait bien mourir si c’est Louis-Philippe qui s’occupe de la cérémonie ! Car le faubourien nous fait rire au-dedans, en ce lieu même où la souffrance nous mine. Nous redoutons la montée de l’angoisse, signes avant-coureurs qui nous alertent de notre avancée vers des vérités terrifiantes. Oui, il a raison le petit Jean : nous ne maîtrisons jamais que nos rêves. Et encore
Note
1. Roman, Gallimard, » Continents noirs « , 2000.
Louis-Philippe Dalembert, Rue du Faubourg Saint-Denis, roman, Le Rocher, 2005, 169 pages, 18,90 .///Article N° : 4160