Lors du festival Dakar court le 11 décembre 2020, Souleymane Cissé a répondu aux questions d’Aboubacar Demba Cissokho et d’Augustin Diomaye Ngom ainsi que des participants de l’atelier de formation « talents Dakar court » 2020.
Augustin Diomaye Ngom : Après vos études de cinéma à Moscou, comment avez-vous accédé à la réalisation ?
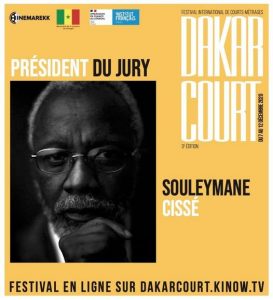 Je suis rentré au Mali en novembre 1969 et en 1970 j’ai travaillé pour les actualités. Au bout de quatre ans, je n’en pouvais plus. Entre moi et l’administration, ce fut un déchirement. Pour exister, j’ai fait un premier court métrage, Cinq jours d’une vie qui fut primé au festival de Carthage en 1972. En 1975, j’ai fait mon premier long métrage Den Muso en 1975, qui m’a valu d’être arrêté et emprisonné durant dix jours. Le Président Moussa Traoré m’a fait sortir, à qui j’avais exposé le problème. Mais le film fut interdit durant trois ans. Les comédiens et techniciens se sont réunis et ont décidé de faire un autre film, seule façon de répondre à ces escrocs. On s’est battu et on a pu faire Baara (Le Travail) qui a remporté beaucoup d’estime dans les festivals, ce qui m’a ouvert la porte. J’ai ensuite écrit Finye (Le Vent) sur deux jeunes qui s’aiment mais sont de milieux différents.
Je suis rentré au Mali en novembre 1969 et en 1970 j’ai travaillé pour les actualités. Au bout de quatre ans, je n’en pouvais plus. Entre moi et l’administration, ce fut un déchirement. Pour exister, j’ai fait un premier court métrage, Cinq jours d’une vie qui fut primé au festival de Carthage en 1972. En 1975, j’ai fait mon premier long métrage Den Muso en 1975, qui m’a valu d’être arrêté et emprisonné durant dix jours. Le Président Moussa Traoré m’a fait sortir, à qui j’avais exposé le problème. Mais le film fut interdit durant trois ans. Les comédiens et techniciens se sont réunis et ont décidé de faire un autre film, seule façon de répondre à ces escrocs. On s’est battu et on a pu faire Baara (Le Travail) qui a remporté beaucoup d’estime dans les festivals, ce qui m’a ouvert la porte. J’ai ensuite écrit Finye (Le Vent) sur deux jeunes qui s’aiment mais sont de milieux différents.
Aboubacar Demba Cissokho : Et vous-même, dans quel état d’esprit étiez-vous à l’âge de vos protagonistes ?
A cet âge-là, j’étais très cinéphile. J’avais l’amour du cinéma depuis que j’avais sept ans. Il ne se passait pas une nuit à Bamako sans que j’aille voir des films avec mes frères. C’était une curiosité, chaque film m’attirait, me disait quelque chose, même si je ne comprenais pas la langue. C’était un métier d’or. L’indépendance est venue, je n’étais pas militant mais on discutait beaucoup avec ma génération. J’étais projectionniste et on faisait des débats après les films. En 1961, j’ai eu la chance d’avoir une bourse pour aller faire mes études.
Un documentaire sur la mort de Lumumba a joué un grand rôle…

Oui, c’était des actualités qu’on se projetait entre jeunes, que des pays amis nous envoyaient. On est tombés sur l’arrestation de Patrice Lumumba. Cela a tout déclenché en moi. J’étais en larmes. Quand ils ont enfoncé du papier blanc dans la bouche de Patrice, j’ai crié comme un enfant. Ce fut un choc. Tout est parti de là. Quelquefois, on a des chocs avec les films, qui nous marquent pour toute la vie. J’ai décidé de m’engager dans ce métier. Je n’avais pas de forte base intellectuelle et n’avais pas le baccalauréat. Mon enfance s’est passée sur le marché, j’étais porteur pour les femmes qui venaient chercher leurs légumes. Cela me permettait d’aller au cinéma le soir. Ça m’a formé. Un jour une dame m’a accusé d’avoir volé son portefeuille. La police m’a arrêté. Ils m’ont pendu par les pieds, les mains attachées, et m’ont tapé avec des règles. Comme j’étais gosse, j’ai crié, crié : « J’ai pas pris ! ». C’était vrai : je n’avais pas pris. Au bout de trois jours, on m’a relâché. C’était un peu tragique mais ça forme l’homme ! Cette dame est venue s’excuser et j’ai continué à faire le petit porteur.
Sembène avait été exclu de l’école et faisait aussi des petits métiers, a été manœuvre puis docker en France avant d’aller étudier le cinéma à Moscou dans la même école que vous. Est-ce pour cela que votre cinéma porte un engagement social, politique et culturel ?
Je ne sais pas. C’est à vous de dire ce qu’est mon cinéma. Ce que vous appelez l’engagement, ce fut une prise de conscience. J’avais vingt ans et cela a bousculé ma vie. Chaque film est un engagement, il faut qu’on soit tous engagés mais chacun est libre. Il faut que la population puisse tirer profit de cette liberté.
Moscou : quelle était l’ambiance ? Quelle vision du cinéma était transmise ?
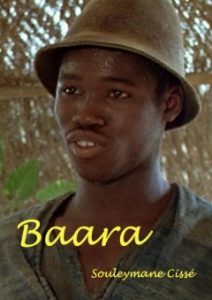 Chaque école a sa littérature. J’avoue que j’étais parti pour apprendre la technique du cinéma. Les maîtres qui m’ont formé ne m’ont jamais inculqué un système. On n’échappe pas aux influences mais j’ai surtout appris à faire des films. Nos professeurs étaient engagés : si nous n’avions pas compris durant la classe, ils venaient dans notre foyer pour poursuivre. J’ai beaucoup admiré cela. On m’a dit ensuite que Baara ou Finye étaient socialistes, mais quand Yeelen est arrivé, on m’a laissé tranquille !
Chaque école a sa littérature. J’avoue que j’étais parti pour apprendre la technique du cinéma. Les maîtres qui m’ont formé ne m’ont jamais inculqué un système. On n’échappe pas aux influences mais j’ai surtout appris à faire des films. Nos professeurs étaient engagés : si nous n’avions pas compris durant la classe, ils venaient dans notre foyer pour poursuivre. J’ai beaucoup admiré cela. On m’a dit ensuite que Baara ou Finye étaient socialistes, mais quand Yeelen est arrivé, on m’a laissé tranquille !
Den Muso : une fillette est violée. Nous allons regarder cet extrait.
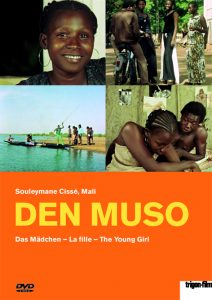 (la scène du viol est emblématique de la qualité du cinéma de Cissé : il ne montre pas l’acte mais avec quelle violence l’homme contraint la femme, ses mains en plaquant les bras)
(la scène du viol est emblématique de la qualité du cinéma de Cissé : il ne montre pas l’acte mais avec quelle violence l’homme contraint la femme, ses mains en plaquant les bras)
Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce film ?
Dans les années 70-73 au Mali, les jeunes filles de 13-14 ans étaient souvent enceintes. C’était comme une mode ! Cela faisait mal parce que ces jeunes mères ne savaient plus où aller. Elles étaient rejetées par leur famille et par la société. Je l’ai vécu dans ma famille et ne supportais pas cette injustice envers des enfants qui sont tombées dans des pièges. C’est ce qui m’a poussé à écrire ce scénario. Les moyens étaient élémentaires. On tournait en 16 mm, on envoyait les pellicules à Paris pour qu’elles y soient développées et on attendait les rushes, parfois deux ou trois mois. Le tournage s’arrêtait en attendant… Une fois, tout était noir, sur 30 minutes de rushes ! La déception était si grande que chacun a pleuré. On a refait le tournage et renvoyé à nouveau : on voulait faire ce film mais on n’était pas professionnels. Les jeunes techniciens avaient fait de petits stages…
Augustin Diomaye Ngom : il est frappant de voir que vous montrez les jeunes de cette époque très proches, sans problème de genre ou par rapport au corps et à la nudité. Pourquoi en est-on arrivé à tant de censure aujourd’hui ?
 Votre question est très pertinente. Quand j’ai fait mes films, je ne me suis jamais soucié de la censure. La question pour moi était de comment le faire. Dans Finye, deux jeunes se douchent ensemble. La nudité a une valeur, une esthétique. Il faut savoir la mettre en valeur, sans vulgarité. Sinon, on n’aide ni la femme ni la société. C’est la vulgarité qui révolte. Par contre, la censure religieuse commence à venir. J’ai des films qui ont été censurés par la télévision nationale. Sans parler des chaînes religieuses elles-mêmes. Nous ne devons pas baisser les bras. Tout passe. Chaque chose a son temps. On évolue. On ne va pas prendre notre retraite !
Votre question est très pertinente. Quand j’ai fait mes films, je ne me suis jamais soucié de la censure. La question pour moi était de comment le faire. Dans Finye, deux jeunes se douchent ensemble. La nudité a une valeur, une esthétique. Il faut savoir la mettre en valeur, sans vulgarité. Sinon, on n’aide ni la femme ni la société. C’est la vulgarité qui révolte. Par contre, la censure religieuse commence à venir. J’ai des films qui ont été censurés par la télévision nationale. Sans parler des chaînes religieuses elles-mêmes. Nous ne devons pas baisser les bras. Tout passe. Chaque chose a son temps. On évolue. On ne va pas prendre notre retraite !
Aboubacar Demba Cissokho : tout est dans la manière de filmer. Ce que vous dites du Mali est vrai du Sénégal aussi, même pour un bisou dans une série ! Les débats sur Ceddo de Sembène (1976) restent houleux à l’université !
(extrait de Finye) Qu’est-ce qui vous faisait sourire en revoyant ces images ?
Ce sont des actes naturels. Les mêmes gestes. Ce film date de 1980. En 2020, je ne vois pas le changement au Mali !
Augustin Diomaye Ngom : ici, c’est tout le contraire. Beaucoup de gestes ont changé. Lorsqu’on étudie le paysage audiovisuel, tout est extrêmement centré sur un standard de vie, le luxe. Les repères de vie ne sont plus les mêmes, ainsi que les dynamiques dans les couples. N’y aurait-il pas quelque chose d’universel dans les valeurs, alors qu’on entend les gens dire : « ce ne sont pas nos valeurs » ? Les jeunes sont entre le marteau et l’enclume, entre ce qu’ils ont envie de faire et ce qu’on leur impose.
Cette génération devrait voir Finye. En le regardant aujourd’hui, je le vois comme une sorte de provocation, mais quand je le faisais, tout était naturel. Cela correspondait à la réalité. J’ai essayé de moderniser un peu : les étudiants, c’est l’avenir ! Il y a même une scène de ping-pong alors que c’était très nouveau à l’époque ! Ce film pose le problème des jeunes aujourd’hui.
Aboubacar Demba Cissokho : Vous avez reçu deux fois l’Etalon de Yennenga : comment l’avez-vous vécu ?
Les prix, c’est un complément. Je n’aurais jamais pensé qu’un film comme Cinq jours d’une vie puisse recevoir un prix. J’étais sous le choc. Les prix arrivent ? Bravo, mais ce n’est pas le moteur. Il faut faire le film qu’on veut faire, en n’écoutant que soi-même.
Binta Diallo (atelier Talents Dakar court) : Pourquoi ne pas écrire aussi sur l’excision alors que le Mali la pratique énormément ?
Je crois que ce rôle vous revient car personne ne peut le sentir comme vous. Je ne suis pas pour mais je n’ai pas eu l’occasion. Si vous avez un beau scénario sur le sujet, on trouvera quelqu’un qui le fera mieux que moi.
Augustin Diomaye Ngom : Cela recoupe la question de la légitimité de parler d’un sujet. Il devient par exemple problématique de voir un Blanc parler du racisme, un homme parler de la condition des femmes, un bien-portant parler du handicap, etc.
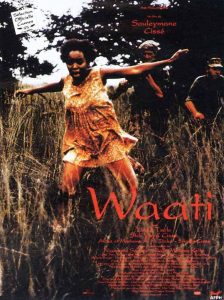 Ce n’est pas une affaire de spécialistes. N’importe qui peut traiter de l’excision, même si ça ne se pratique pas chez lui. Waati parle du racisme de l’apartheid en Afrique du Sud. Il y était censuré, mais on va le restaurer et le ressortir. Lorsqu’un film ne correspond pas à la vision dominante, on le bloque.
Ce n’est pas une affaire de spécialistes. N’importe qui peut traiter de l’excision, même si ça ne se pratique pas chez lui. Waati parle du racisme de l’apartheid en Afrique du Sud. Il y était censuré, mais on va le restaurer et le ressortir. Lorsqu’un film ne correspond pas à la vision dominante, on le bloque.
Augustin Diomaye Ngom : On a encore au Sénégal ce problème de caste où les enfants abandonnent l’homme ou la femme de leur vie car les parents ont décidé que la classe sociale de l’autre ne convenait pas.
C’est de notre rôle de cinéaste de dire que ce n’est pas juste. Nous n’avons pas besoin d’agresser, simplement amener le public à adhérer à ce que nous disons. C’est une question de cinéma. Sur les problèmes cruciaux, il faut amener les gens à voir ce qu’ils n’ont pas vu. Les sujets ne manquent pas ! Foncez !
Question de la salle : nous sommes dans un monde où l’argent domine. Comment s’en protéger ?
 Il nous est difficile de faire des films sans devoir passer par le système capitaliste… Chaque créateur passe par des chemins différents. Le bon art se vend bien aussi. L’important est de s’exprimer. La nature donne toujours les moyens d’arriver si on aime ce qu’on fait et qu’on le fait bien. On a monté Yeelen mais le résultat ne me plaisait pas, j’ai arrêté ! Après un mois et demi de tournage. Cela a coûté ce que ça a coûté mais je savais que sinon ce serait raté.
Il nous est difficile de faire des films sans devoir passer par le système capitaliste… Chaque créateur passe par des chemins différents. Le bon art se vend bien aussi. L’important est de s’exprimer. La nature donne toujours les moyens d’arriver si on aime ce qu’on fait et qu’on le fait bien. On a monté Yeelen mais le résultat ne me plaisait pas, j’ai arrêté ! Après un mois et demi de tournage. Cela a coûté ce que ça a coûté mais je savais que sinon ce serait raté.
Toumani Sangaré, producteur-réalisateur : dans l’extrait de Den Muso, on voit une pirogue passer sur la rivière tandis que l’action continue. Est-ce que vous maîtrisez tout ce qu’on voit à l’image ? Cette pirogue est-elle mise en scène ou le fruit du hasard ? Dirigez-vous les acteurs durant les prises de manière instinctive ou bien tout est-il prévu avant ?
Le cinéma que j’ai fait jusqu’à Yeelen, c’était avec des amateurs, sauf rares exceptions. Je travaillais avec les acteurs avant le tournage. Je leur donnais mes indications et leur laissais la liberté de jouer, ce qui leur permettait de donner ce poids au film. Quant à la pirogue, elle passait derrière : nous n’avons pas payé pour qu’elle vienne, mais nous savions que dans ce lieu des pirogues passaient. A un moment, on a attendu une heure de temps avant d’en voir une venir ! Au marché, j’avais peur pour le garçon car je craignais que tout le marché se mette contre lui ! Mais il faut profiter des cadeaux de la réalité !









