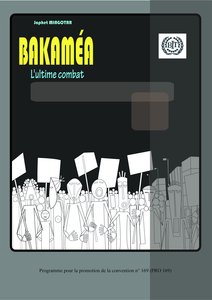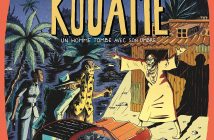Depuis plusieurs années, le dessinateur Camerounais Japhet Miagotar, se fait remarquer par son style original, très stylisé et dépouillé. À l’occasion de la sortie programmée de son premier album, Peur sur Abidjan, dans la collection L’Harmattan BD, il revient sur son parcours et sa démarche artistique.
« Je ne prétends pas être le défenseur des gens, mais je suis très sensible à la condition de l’homme, peu importe sa couleur, son statut, son origine
»
Japhet Miagotar
Tout d’abord, de quelle partie du Cameroun venez-vous ? J’ai l’impression que vous êtes musulman, c’est rare un auteur de BD camerounais musulman
Je suis de la région du Nord-Cameroun. Peut-être que si dès mon jeune âge, on m’avait demandé de choisir ma religion, j’aurais choisi d’être musulman. Mais, ce ne fut pas le cas et je suis né dans une famille chrétienne. Dès lors, vous comprendrez que je suis aussi chrétien comme tous les enfants à mon père. Avant je faisais la différence entre chrétien et musulman, mais plus maintenant. La seule chose qui compte c’est l’homme et ses valeurs. Peut-être que la religion enseigne ces valeurs, mais je crois aussi qu’on naît avec. Sinon, comment expliquer le silence ou l’impuissance de la religion face à toutes ses injustices, violences, mensonges
Quel est votre parcours en matière de BD ?
Mon parcours est quelque peu atypique. Je suis arrivé dans l’art beaucoup plus pour des raisons disciplinaires, éducatives que pour des prédispositions quelconques que je n’avais d’ailleurs jamais manifestées auparavant. Disons que je suis parti de l’enseignement littéraire pour arriver dans une école d’art et où j’ai été contraint de m’inscrire dans la filière céramique. Mais c’est en 2002 que je fis mes premières planches de BD à l’issue d’un séminaire de quatre semaines organisé par l’Institut de formation artistique de Mbalmayo au Cameroun et animé par le bédéiste italien Pierpaolo Rovero. De là sortit Ingratitude, une uvre de quatre planches noir et blanc, faite à la main, avec des personnages sculpturales figées dans un espace très pauvre en décor (sable, montagne, dunes). Elle fut publiée dans le magazine bimestriel du COE (centro orientamento educativo) en février 2003, puis par Laura Scarpa, éditrice basée en France. Il a fallu attendre 2004 pour présenter une nouvelle BD de quatre planches L’Espoir perdu et participer à un concours de BD co-organisé par le COE et la commune de Fiume-Veneto. J’ai eu le 1er prix avec cette bande dessinée. Il faut avouer que jusque-là, je n’avais pas un réel intérêt, une véritable passion, pour cet art. En 2005, j’avais participé au festival de la BD d’Angoulême mais sans grande conviction.
Quelles études avez-vous fait ?
J’ai fait des études littéraires avec probatoire en A4 Espagnol, puis la céramique à l’IFA (probatoire et bac). Depuis quelques années, je suis étudiant à l’université de Yaoundé I, département des arts et archéologie, filière arts plastiques et histoire de l’art.
Quand avez-vous commencé à y croire ?
En 2007-2008, j’ai participé au concours d’Africa comics avec deux uvres de quatre pages chacune, Guizi : la longue traversée initiatique, qui eut d’ailleurs le 1er prix ex-æquo, et Sous-dent. En 2010, j’ai participé à nouveau au même concours avec deux uvres : Trafigoura I et Ingratitude, la suite de la BD envoyée précédemment. Mais, on m’a fait comprendre que le niveau technique de mes propositions était élevé et on m’a invité à faire partie du jury. Entre mai et juin 2010, j’ai fait le voyage pour Bologne. J’en ai profité pour avoir des séances de travail avec des élèves et étudiants de quelques écoles d’art de toute la région du Piémont, notamment à Turin, Vercelli, Novara, Biela, Asti, Alessandria, Cuneo
En octobre 2010, j’ai participé au Fibda (Festival international de la bande dessinée d’Alger) avec Trafigoura II qui comportait dix-neuf planches, donc encore inachevé. J’ai eu le 2e prix dans la rubrique « Meilleurs projets ». Au même moment j’ai reçu une commande de l’OIT, à travers son bureau d’Afrique central, pour une BD sur la discrimination des peuples autochtones et tribaux. De là est sorti Bakaméa : l’ultime combat, uvre de vingt et une planches. En 2011, j’ai participé à nouveau au Fibda et Trafigoura II, alors achevé avec 48 planches, obtient la Mention spéciale du jury pour son originalité. En début janvier 2012, j’ai achevé une nouvelle BD pour l’OIT : Coup d’éclat à la discrimination, ouvrage qui paraîtra d’ici peu. Depuis, quelques mois je travaille avec des amis bédéistes sur un projet de magazine collectif de BD made in Cameroun, Waka. La sortie du 1er numéro a eu lieu à la mi-mars de cette année. J’ai illustré un scénario de Stéphane Akoa, Phalènes, BD de huit planches.
Votre projet Trafigoura II va sortir sous le titre Peur sur Abidjan dans la collection L’Harmattan BD, pouvez vous développer la trame ?
Trafigoura II parle de la triste et sombre histoire du Probo koala, survenue en Côte d’Ivoire en septembre 2006. En effet « Trafigoura » est le nom de l’affréteur et Probo koala le nom du bateau panaméen qui a transporté les produits toxiques. En Côte d’Ivoire, tout commence le 19 août 2006 par l’arrivée et l’accostage du Probo koala au port d’Abidjan. Des policiers, des douaniers, les services sanitaires, l’attendant sur le quai, semblent tout ignorer de son contenu. Du 19 au 20 août, la société Tommy, une filiale de Trafigoura, basée aussi à Abidjan, se charge du versement de la cargaison toxique, 528 tonnes d’après certaines sources, dans une dizaine d’endroits habités de la ville d’Abidjan. Puis les habitants des quartiers où ces produits ont été déversés commencent à souffrir des malaises, tout en ignorant la cause. Il y eut dix-sept morts et près d’une dizaine de milliers de personnes contaminées. Le bateau quitte le port le 22 août malgré des demandes d’immobilisation. Des voix s’élèvent partout dans le monde pour condamner cet acte. Dans la foulée, le 6 septembre 2006, le premier ministre ivoirien démissionne avec l’ensemble de son gouvernement, quelques ministres sont limogés et d’autres responsables impliqués dans l’affaire sont suspendus ou arrêtés. Le gouvernement ivoirien demande justice et réparation. Le TOI se saisit de l’affaire, les responsables du bateau sont arrêtés puis relaxés par manque de preuve. Une femme et son fils décident de leur régler leur compte. À un certain endroit, j’ai occulté la véritable histoire en l’interprétant à ma manière, en lui donnant une autre issue que la vraie. Par exemple je n’ai pas fait mention des cent milliards de francs CFA versés à l’État ivoirien contre l’abandon des poursuites judiciaires contre l’affréteur et qui ne seront sans doute jamais versés aux victimes.
Y a-t-il un message que vous essayez de faire passer dans votre travail ?
Oui ! Tout simplement que mes BD soient éditées ! Pour moi, la BD est un support de communication, une sorte d’auto-journalisme. Le 9e art est un médium de traitement et de transmission de l’information. Avec Trafigoura II, je traite l’actualité à ma manière. Son sujet est réel, ce n’est pas de la science-fiction. C’est un ouvrage que je dédie aux victimes silencieuses de ce genre de folie. Tout le monde sait ce qui passe actuellement partout dans le monde, un monde de fou ! Je ne prétends pas être le défenseur des gens, mais je suis très sensible à la condition de l’homme, peu importe sa couleur, son statut, son origine
Ce n’est que naturel de le faire puisqu’on se sent interpellé. Dès lors, ce message est clair dans chacun de mes ouvrages.
Sinon, d’où vient ce style avec vos personnages ? De la céramique ? Vous cherchez à créer un style typiquement africain ?
Il faut avouer que je n’avais pas directement commencé le dessin par les personnages connus actuellement. Auparavant, je m’appliquais à décorer les céramiques de motifs abbia. C’est à partir de 2001, après qu’une commande spéciale m’ait contraint de proposer autre chose que ce qui était alors fait jusque-là. Je suis allé dans une bibliothèque parcourir des ouvrages d’histoire de l’art et puis ce fut le coup de foudre. Il est bien vrai que sans la céramique, je ne serais peut-être jamais arrivé à ces personnages inspirés de la statuaire africaine en général et fang en particulier. Par ailleurs, et très honnêtement, la recherche d’un style n’a presque jamais été ma préoccupation. Je préfère parler d’innovation, de nouveauté. En plus, je n’ai pas encore la preuve ou certitude absolue que je suis la seule personne à le faire à l’heure actuelle. Vous savez, le monde est très grand, et ce qu’on n’a pas encore vu et connu peut exister ou avoir existé quelque part ailleurs. Je suis réservé sur la question. Je ne peux pas non plus parler d’un style africain par rapport à mes créations graphiques. L’Afrique est multiple, et rien n’est jamais figé à l’échelle du temps. Les hommes, la culture, tout bouge. En plus, le terme « africain » lui-même est très difficile à cerner, à définir. Qu’est-ce-qui peut être considéré comme africain ? Par qui ? Selon quels critères ? Où commence ce qui est africain ? Et où s’arrête-t-il ?
Je comprends, mais les visages en forme de masque, les corps particuliers dans vos BD, c’est carrément d’inspiration africaine, non ?
Vous avez raison. En effet, je suis parti d’un principe qu’il fallait s’inspirer des formes de masques et statues africains pour créer des personnages qui racontent une histoire. Dès lors il me fallait trouver une démarche, un processus, parce que je pense que la création, bien que parfois intuitive, se doit de respecter une certaine logique scientifique. Au fil des recherches et de multiples essais, je suis arrivé à en trouver une que j’ai nommé « S.V.A. » – simplification-variation et animation – Je me suis appuyé sur les travaux de Engelbert Mveng, de Louis Perrois, Günter Tessmann et bien d’autres. C’est en effet mon sujet de recherche de master II. Au début, le travail était intuitif et peu à peu je suis arrivé, du moins je l’espère, à en faire un travail presque scientifique applicable à toutes formes de masques et statues, voire, toutes formes d’objet. Parfois, je ne modifie presque rien du canon anatomique des éléments sources que j’utilise. J’en fais juste une adaptation graphique par l’habillement, l’environnement dans lequel ils évoluent. Je leur impose aussi un mouvement variable d’un personnage à un autre. Vous savez que les statues et masques sont des objets tridimensionnels fixes. Leur traitement graphique en simples dessins en aplats évoluant dans un espace à trois dimensions, presque réels (tout au moins graphiquement) été un véritable défi. Et je ne sais pas si j’ai vraiment réussi le pari
On a le sentiment que vos travaux sont une suite d’essais, d’expérimentations
Je ne sais pas si j’essaie de faire quelque chose, de montrer ou démontrer ce qui est faisable ou pas. Je sais seulement que j’aime de plus en plus ce que je fais. Je me cause à moi-même. C’est une forme « d’auto-communication », parce qu’on est au moins sûr d’être entendu ou compris par soi-même. C’est ma façon de refuser à voix basse ce que je ne peux refuser à haute voix. J’ai l’impression qu’on m’a montré une voie à suivre et je la suis aujourd’hui mais en me posant beaucoup de questions ; en ayant peur de l’incertitude, de l’inconnu, de l’avenir. Il y a plus d’une raison qui peut amener quelqu’un à prendre un stylo ou un crayon pour faire quelque chose pour soi-même ou pour les autres. Autant j’aime le présent, le monde moderne avec sa technologie, autant j’ai de la nostalgie pour le passé, pour ces sculptures entassées dans des musées, très loin de leur base, très loin de leur milieu d’origine et exposées dans des conditions qui ne sont pas les leurs. J’adore les masques et les sculptures de mes cousins. La masse, le volume, les plans, la profondeur traités ainsi me fascinent beaucoup. Et pourquoi ne pas les animer pour soi, les voir et les avoir tout près, si proches en quelques lignes ; les faire parler, chanter, danser, pleurer, revendiquer, leur donner un fragment de béquille
Elles ont perdu leurs jambes et ne pourront guère rentrer. Ce n’est pas non plus un retour aux sources, mais plutôt une marche vers l’avant, à la rencontre de Soi.
Quels sont les artistes qui vous ont influencé ?
Pierpaolo Rovero, j’aime beaucoup ses personnages et son style scénographique ; Tomaz Lavric, alias TBC, pour la simplicité de ses formes, la composition des planches et vignettes ; Andréa Pazienza pour sa philosophie et ses thèmes ; l’auteur chinois, Benjamin, pour ses palettes de couleurs, Benoît Schuiten pour le gigantisme et la finesse de ses dessins. Je me plonge aussi dans l’univers des théories esthétiques surréalistes, cubistes, impressionnistes
Je lis également beaucoup : Aimé Cézaire, Antoine Gallant, Cheik Anta Diop, Louis Perrois, Engelbert Mveng, Paul Gravett
Je discute avec les personnes âgées ici au Cameroun. Je consulte très régulièrement les collections des musées. C’est tout ça qui explique ce que je fais maintenant.
Quels sont vos projets ?
ils sont très nombreux, mais certains sont prioritaires : par exemple ouvrir un cabinet d’étude et d’appui dans les arts et le patrimoine, mais spécialisé dans la BD, le cinéma d’animation et la mode. Créer une maison d’édition de BD. Faire une thèse en anthropologie, puis en sociologie, après celle en arts plastiques, pour connaître l’Homme. Enfin, et pourquoi pas, fonder une famille ? ! !
Enfin, de quoi vivez-vous ?
Pour survivre, je dois cumuler et me débrouiller. Je dispense des cours dans une école supérieure d’art à Yaoundé, dans les filières de design de mode et cinéma d’animation. Je travaillais également dans une entreprise de communication visuelle mais j’ai arrêté il y a quelques mois. Depuis deux ans, je peux dire que je vis aussi de la BD ou de l’illustration. Je vends des peintures et des céramiques que je réalise et expose ça et là. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je fais aussi dans le transport de temps en temps.
Vous avez travaillé récemment avec un scénariste – Stéphane Akoa – comment cela se passe ?
En tout cas, je trouve que c’est facile de bosser avec lui. Il comprend bien la BD et voit souvent très juste. Pour ce que nous avons fait ensemble jusque-là, c’est lui qui trouve et écrit l’histoire. On en discute pour voir le style graphique qui peut le mieux correspondre. Je fais des ébauches, on en discute encore, on ajuste, on corrige, parfois on invite aussi d’autres amis pour avoir leur point de vue. Puis quand nous sommes d’accord, je me retire pour faire le définitif. C’est très amical, très convivial. On n’a pas l’impression d’être sous pression à chaque étape du travail.
Vous n’êtes membre d’aucune association ou autre regroupement professionnel. Pourquoi ? Désir d’être indépendant ?
Je suis membre de Grap-Africa – groupe de recherche sur les arts et le patrimoine – fondé en 2010. Par rapport à la BD, j’évolue seul, peut-être parce que je considère que je n’ai fait que de l’expérimentation jusque-là. Néanmoins, je participe à certains projets collectifs relatifs à la BD, par exemple le projet Waka dont le 1er numéro est sorti le mois dernier.