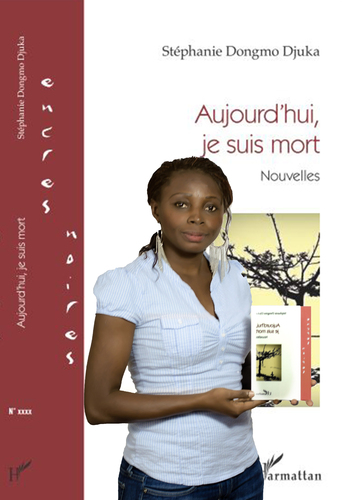Stéphanie Dongmo, compte ces dernières années parmi la jeune et bouillonnante génération des critiques culturels camerounais. Le 12 décembre 2012, j’ai eu le plaisir d’un échange avec elle dans le quartier de Belleville, à Paris. Au cours de cette rencontre, j’ai eu l’occasion de lui poser un certain nombre de questions à propos de son premier ouvrage Aujourd’hui je suis mort, publié aux éditions L’Harmattan. Ce recueil de nouvelles est profondément ancré dans le quotidien camerounais. Au fil de ses courts récits, Stéphanie Dongmo s’attache à décrire une société pleine de tristesse et de douleurs, à donner une voix à ceux dont on parle si peu, à décrire leurs morts et – surtout – à donner un sens à leurs vies.
Je peux mettre une date sur la première fois où j’ai croisé Stéphanie Dongmo. C’était le 10 juin 2010. J’étais alors dans un taxi avec mon ami, l’éditeur François Nkémé. Nous traversions le quartier Tsinga, à Yaoundé. Le taxi s’est arrêté pour « charger » un passager supplémentaire. Stéphanie Dongmo est montée dans la voiture et, comme François et elle se connaissent, ils ont entamé la conversation. Stéphanie nous a alors appris le décès de Ferdinand Léopold Oyono, illustre auteur d’Une vie de boy, du Vieux nègre et la médaille, de Chemin d’Europe
J’aurais tant aimé pouvoir m’entretenir avec cet auteur que je n’ai alors pas pu m’empêcher de penser – égoïstement – « je ne le rencontrerai donc jamais ! » Mais c’est ainsi, au moment de la mort d’un célèbre écrivain, que j’ai aussi fait la connaissance d’une future auteure.
Ce sont les hasards de l’existence : quelques milliers de kilomètres plus loin et deux années plus tard, j’ai donc eu la chance de discuter avec Stéphanie Dongmo de son premier ouvrage et de ses premiers pas au sein de la littérature camerounaise
Stéphanie Dongmo, j’ai aujourd’hui le plaisir de m’entretenir avec vous au sujet de votre premier ouvrage intitulé Aujourd’hui je suis mort. Il s’agit d’un recueil de quatre nouvelles sorti aux presses de L’Harmattan le mois dernier. Mais avant de parler de votre livre, j’aurais toutefois aimé en savoir un peu plus sur vous et votre parcours ! Qui est donc Stéphanie Dongmo ?
Je suis née dans une petite ville qui s’appelle Nanga-Eboko, à 160 kilomètres de Yaoundé. Je suis arrivée à Yaoundé après le Bac, et j’ai alors fait un BTS en journalisme. J’ai ensuite fait une Licence de sociologie, parce que je souhaitais « comprendre ». Je me disais : « la sociologie va m’ouvrir l’esprit et va me permettre de comprendre les autres ». C’était très important pour moi, d’aller à l’université. J’étais très timide à l’époque ! Mes amis me disaient : « si tu vas à la fac, tu ne pourras plus être timide ! », parce que l’université de Yaoundé I, c’est un peu la jungle. Pour être à la Fac et « survivre », il faut avoir des griffes et il faut se battre ! J’ai donc fait cette Licence de sociologie, et j’ai même entamé une maîtrise en sciences politiques que je n’ai pas terminée, faute de temps. J’ai ensuite commencé à travailler dans une radio de Yaoundé, avant d’arriver au quotidien Le Jour, où j’ai travaillé pendant cinq ans. J’écris aujourd’hui pour le mensuel Mosaïques et en free-lance. Je suis aussi la présidente du « Cinéma numérique ambulant » au Cameroun. Le « Cinéma numérique ambulant » est un réseau international d’associations installées dans huit pays. L’objectif du projet est la diffusion de films africains de sensibilisation et de fiction dans les villages d’Afrique et dans les quartiers pauvres des villes. Notre but est d’amener le cinéma africain aux populations africaines qui en sont les premiers destinataires, de former le public à l’image, de susciter un public pour le cinéma africain et partant, de contribuer à son essor.
Que nous vaut le plaisir de votre présence à Paris en cette fin d’année 2012 ?
Depuis deux mois, je suis en stage à la rédaction parisienne d’Africultures. Je suis une journaliste culturelle et je voulais améliorer ma pratique du métier. L’objectif étant d’arriver à une plus grande rigueur dans la pratique de ce métier, d’acquérir des réflexes et des aptitudes pour être à la hauteur des attentes du public, de perfectionner ma pratique quotidienne de la critique et de l’écriture du fait culturel. Sur les cultures africaines, Africultures est une référence. Le fait d’être intégrée dans une rédaction à l’étranger me permet de regarder le métier avec des yeux neufs, d’apprendre d’autres pratiques professionnelles qui m’aident à développer une certaine polyvalence et une meilleure adaptabilité. C’est vraiment une très belle expérience qui m’a permis de connaître mieux la France et même l’Afrique. Car Paris c’est un peu « la capitale » de l’Afrique. Ici, on a l’occasion de rencontrer des professionnels de tout le continent qu’on ne verrait pas si on restait chez soi, qu’ils soient installés ici ou simplement de passage. La richesse et la diversité des manifestations culturelles est aussi un bonheur pour un journaliste culturel.
À ma connaissance, il y a au Cameroun des initiatives comme Les Écrans noirs, un festival de courts-métrages (Yaoundé-tout-court)
Oui, heureusement, car il n’y a plus de salle de cinéma. Les festivals de cinéma, les projections itinérantes du Cinéma numérique ambulant, la vente des films sur DVD, c’est très bien mais ça ne remplacera jamais la salle. Et il est regrettable que dans un pays comme le Cameroun, on ait des critiques de cinéma qui n’ont jamais regardé un film en salle. Comment peut-on évoluer en tant que critique si on n’a pas accès aux films, s’il faut attendre un festival pour espérer regarder des films ?
J’aurais aimé que nous abordions votre travail d’écrivaine, car voilà une autre « casquette » de Stéphanie Dongmo ! Vous vous êtes lancée dans l’écriture, mais je dis « lancée »… S’il s’agit effectivement de votre premier ouvrage, c’est un projet débuté il y a plus d’une dizaine d’années, en 2000. Pourquoi avoir attendu tout ce temps ?
J’écris depuis l’âge de 12 ans. N’étant pas quelqu’un de très expressif, c’est le meilleur moyen que j’ai trouvé de me défouler, de dire mes sentiments et mon indignation. Quand j’ai décidé de publier, j’ai buté contre des éditeurs qui demandaient à être payés. J’ai donc fini par publier en toute connaissance de cause à L’Harmattan, où les conditions d’édition sont drastiques pour les auteurs et où la promotion du livre n’est pas assurée
Au sujet de votre choix éditorial, votre positionnement m’intéresse également : vous êtes journaliste culturelle et critique littéraire : est-ce que ce n’est pas un exercice difficile de passer « de l’autre côté » et, de critique littéraire, devenir soi-même écrivain ?
Peut-être qu’il faut passer de l’autre côté comprendre ce qu’un auteur peut ressentir lorsqu’il lit une critique à propos de son uvre. C’est une expérience qui permet de comprendre qu’il faut nuancer les choses, de se dire que l’auteur a quand même pris du temps pour écrire, qu’il y a mis de l’énergie, des espoirs
Et si un éditeur a pris le pari de le publier, c’est qu’il n’est pas complètement mauvais. D’être auteur, ça permet de voir les choses de manière plus ouverte. Ce qui ne veut absolument pas dire qu’il faut être complaisant.
Si vous le voulez bien, nous pourrions maintenant « rentrer » un peu dans l’uvre. Aujourd’hui, je suis mort, c’est aussi le titre de la première nouvelle. Mais commençons déjà par la base : pourquoi ce choix de la nouvelle ?
Peut-être un peu par paresse ! (rires) La nouvelle, c’est une forme d’écriture qui permet que dès lors qu’on tient une idée, on peut écrire un texte du début à la fin en seulement quelques heures. Même si, après relecture, on peut faire des corrections. Après, on passe à autre chose. Un roman demande plus de temps, plus de concentration, une écriture suivie. Il faut être posé pour ça. La nouvelle présente l’avantage de concentrer une histoire en quelques pages, elle se contente de peu de descriptions. C’est le genre par excellence des débutants qui y font souvent leurs armes avant de passer au roman. Plusieurs romanciers vous diront qu’ils ont commencé par écrire une nouvelle avant d’écrire un roman, même s’ils ne l’ont pas publiée. Mais attention, elle a aussi ses contraintes. Il faut pouvoir surprendre le lecteur et le maintenir en haleine du début à la fin.
Parlons un peu du texte et d’une écriture « dure ». Vous avez évoqué le découragement que vous avez ressenti à une époque où vous cherchiez à faire éditer le livre
mais on sent aussi beaucoup de découragement dans votre écriture ! On est ici face à un texte difficile, sombre, peuplé par quatre morts : des morts aussi bien physiques, morale, sociale, affectives
Il faut dire que j’ai écrit ces nouvelles à une période de ma vie où je rencontrais beaucoup de difficultés. Une période où je m’interrogeais beaucoup sur la mort, sur ma propre mort, sur l’origine et le but de la vie. C’était une période de grands questionnements pour moi. Forcément, cela a déteint sur ce que j’écrivais. Je ne suis pas sûre qu’aujourd’hui, j’aurais écrit les mêmes histoires. On écrit aussi en fonction de son état d’esprit. Pour moi, la mort n’est pas seulement physique. L’absence de spiritualité, le manque d’amour, l’immoralité, pour moi, ce sont des petites morts. On doit pouvoir se renouveler.
Et puis aussi cette mort sociale, cette exclusion au cur de votre recueil. Il y a par exemple cette femme, vendeuse d’arachide itinérante, qui sombre peu à peu dans un engrenage d’échecs, sa situation ne faisant qu’empirer et empirer
Oui, justement, ce que je voulais dire c’est que chaque société fabrique des conditions d’exclusion d’une catégorie de personnes, qui vivent dans la société sans pour autant en faire partie. C’est un peu le cas de cette femme. Toutes les conditions sont réunies pour qu’elle ne soit pas autre chose qu’une vendeuse, et la machine répressive est là pour la broyer. Elle est victime d’une société qui a honte des rebuts qu’elle a elle-même fabriqué et qui essaie de les cacher à la face du monde. C’est un système qui fait que quand on est né pauvre, on est destiné à le demeurer. Tout est fait pour en tout cas. C’est un texte que j’ai écrit en 2010, lorsque la Communauté urbaine de Yaoundé a lancé une campagne d’assainissement des rues de la ville. Initiative louable, qui s’est malheureusement accompagnée de beaucoup de brutalité. Des mendiants, des malades mentaux et des vendeurs ont été interpellés et gardés à vue. On n’a pas tenu compte du fait que pour beaucoup de ces vendeurs, vendre dans la rue est la seule solution qu’ils aient trouvé pour nourrir leur famille. On ne leur a jamais proposé d’alternative. Quand vous voyez une femme qui parcourt les rue de Yaoundé, un plateau d’arachides sur la tête et un bébé au dos, alors qu’il fait 30°, pensez-vous qu’elle ait le choix ? Il faut trouver des solutions durables aux problèmes. Et dans le cas d’espèce, ce n’était pas d’interpeller ces vendeurs, puisqu’aujourd’hui, ils se sont réinstallé et jouent régulièrement au chat et à la souris avec la police. C’est comme si, au lieu de découvrir la blessure pour la soigner, les pouvoirs publics la recouvraient juste, le temps de recevoir quelque visiteur de marque. Si ça continue, dans vingt ans, on sera toujours en train de chercher des solutions aux mêmes problèmes. Ce qui m’indigne le plus, c’est de voir des gens qui sont victimes d’injustice se taire. Chacun, à son niveau, doit pouvoir trouver une forme de contestation.
Cela me permet de vous poser une autre question : il y a plusieurs personnages dans vos nouvelles : Apocalypse le fou, la femme victime des faux paroissiens
Ces personnages semblent, quelque part, nous avertir, nous mettre en garde, ou en tout cas nous pousser vers quelque chose
Apocalypse parle d’une révolution, cette autre femme « maudit » le piège des faux paroissiens dont elle a elle-même été victime
J’aurais aimé vous questionner sur ces « petits personnages » qui en appellent à une contestation, une réaction
ou du moins à une vigilance.
On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais la vérité sort aussi de la bouche du fou qui peut se permettre de dire les choses que les autres personnes, considérées comme normales ou lucides, n’osent pas dire. Le fou, lui, peut se permettre de poser le doigt là où ça fait mal. Concernant la femme victime de faux-pasteurs dont vous faites allusion, elle a développé une forme de résistance. Elle a été vaincue, mais elle n’a jamais capitulé. J’aime beaucoup cette citation d’un poète turc, Nazim Hikmet, qui dit :
Être captif, là n’est pas la question
Il s’agit de ne pas se rendre.
Une autre femme incarne aussi une forme de résistance, ou de résilience, peut-être : Il s’agit de cette mère de famille que nous avons déjà évoquée et qui vit sa dernière journée. Jusqu’au bout, elle va penser à son enfant, à ses enfants. D’une certaine manière, j’ai pensé que le combat de cette femme est peut-être aussi indirectement perçu, puisqu’une journaliste assiste à sa fin, de manière impuissante certes
mais n’est-ce pas aussi le rôle d’information des journalistes qui est ici pointé du doigt ?
Pour nous, journalistes, c’est un échec de l’admettre, mais parfois, le journaliste aboie et la caravane passe. Cela s’est vérifié plusieurs fois au Cameroun, sur des faits d’actualité. Dans un contexte et fragilité économique, de corruption endémique et de faiblesse intellectuelle, le journaliste est-il encore le quatrième pouvoir ? Certains se plaisent à le croire, pas moi. Je me pose aussi des questions, de savoir quel est l’implication du journaliste que je suis dans le malheur des gens. Est-ce que je ne m’en sers pas comme d’un prétexte pour alimenter les pages d’un journal, dans le seul but de vendre du papier ?
Il y a aussi la solitude qui m’intéresse dans vos nouvelles. Dans chaque nouvelle, on a le sentiment que les personnages sont seuls. Ils ont beau être entourés, ils restent seuls. Ils se trouvent au milieu des institutions, que ces dernières soient l’État, que le village, l’église ou l’hôpital (je pense à ce médecin qui est uniquement préoccupé par le bruit que font les gens dans son hôpital) et même dans la famille ! Si je devais résumer votre recueil, ce serait peut-être par la phrase suivante : « Dieu, l’État, le village, la famille sont là pour tous
mais c’est avant tout chacun pour soi ». Face au destin et à la vie, on est toujours seuls, quelque part
Ma conviction profonde est que, de la même manière qu’on naît seul et qu’on meurt seul, on traverse aussi la vie seul. On a beau être entouré d’un mari, des enfants, des frères et des amis, il y a en chacun de nous une part de solitude, des choses qui ne se partagent pas. Cette solitude ne devient un problème que si l’environnement ne joue pas son rôle d’intégration, que s’il se développe un sentiment fort d’exclusion ou de rejet. Et c’est souvent ce qui arrive dans une société en panne. Et puis, on écrit toujours un peu à partir de son histoire… Je suis habitée par une solitude et une mélancolie que je caresse comme un bien précieux, et que je transmets dans mon écriture.
J’ai relevé plusieurs analepses, plusieurs retours en arrière dans vos nouvelles. Ces flash-back éclairent tous un passé plus doux, une époque où les choses étaient plus faciles pour les personnages, ou en tout cas une période où l’espoir était encore permis. Certains personnages se réfugient aussi dans leurs souvenirs pour se donner du courage. Vous semblez écrire que quelque part « avant c’était mieux », ou peut-être que les temps meilleurs sont révolus
Révolus pour le Cameroun, ou pour chaque personnage peut-être ? Ou bien est-ce que c’est la difficulté du présent qui fait que l’on se réfugie toujours dans le passé ?
Oui, il y a aussi un peu de ça ! Quand ils n’ont plus d’espoir en l’avenir, les gens ont tendance à sublimer le passé, pour se convaincre d’une époque où on était plus heureux, même si ce n’est pas forcément vrai. On se dit toujours « avant c’était mieux ». Par exemple, on voit bien dans ces pays où le peuple a beaucoup lutté pour faire partir un régime, il y a après des gens qui disent : « avant, c’était mieux ».
Il y a d’ailleurs un personnage dans une de vos nouvelles qui a choisi le nom de Germaine Ahidjo, une ancienne femme de notable qui s’est retrouvée à la rue et a perdu la raison
Il s’agit d’un personnage qui existe vraiment. J’ai voulu rendre hommage à cette dame que l’on peut voir dans les rues de Yaoundé. On l’appelle ainsi et il se raconte une histoire à propos d’elle. Je n’ai pas cherché à savoir si c’était vrai ou faux. Je m’interroge néanmoins sur ce surnom qu’elle porte. Germaine Ahidjo est l’épouse du premier président du Cameroun, Ahmadou Ahidjo.
Germaine Ahidjo est précisément un des deux personnages qui va prendre soin de l’enfant d’une autre. Sur cette question des enfants : ils sont un peu dans chaque nouvelle les seuls à exprimer et recevoir de l’amour
Mais un amour qui perd face la vie : les enfants sont impuissants
Ces enfants, qui représentent pourtant l’avenir, incarnent-t-ils nécessairement un avenir désabusé ?
Clairement. On dit que l’enfant est l’avenir de l’homme mais est-ce qu’on le considère comme tel ? Un enfant, c’est de la pâte à modeler que la mère façonne dans nos sociétés patriarcales. Dans la dernière nouvelle du recueil, j’ai aussi voulu apporter le regard sévère et caustique d’un enfant de trois ans sur les adultes qui l’entourent. Un enfant qui vit très mal l’arrivée de sa petite sur. C’est un véritable traumatisme.
Dans cette nouvelle le petit va ainsi chercher une mère de substitution
Sans raconter toute l’histoire, il y a une rupture affective qui survient à un moment entre cette mère de substitution et l’enfant. C’est un questionnement sur la place de la mère naturelle et de la mère adoptive dans le cur d’un enfant.
Il y a beaucoup de pistes de réflexion dans toutes vos nouvelles ! J’ai parlé tout à l’heure de cette tristesse qui baigne chacun de vos écrits, omniprésente. Quelque part, vous refusez un peu la « petite lumière » qui irait vers un happy end ou au moins un espoir, une possibilité
C’est aussi cela que je trouve intéressant d’ailleurs : vous ne cherchez pas la facilité en disant au lecteur « cela va s’arranger, ne vous inquiétez pas ». C’est alors au lecteur de faire avec ce choix. Le Cameroun est « aussi froid que les collines du Grassfield », comme vous l’écrivez ?
Je dirais plutôt que le Cameroun est un pays que je trouve violent. C’est une violence passive sur lequel on devrait pouvoir s’interroger. Actuellement, il y a très peu d’espoir pour beaucoup de jeunes. Ils passent beaucoup d’années sur les bancs de l’école, en sortent avec une formation au rabais, commencent une carrière vers 30 ans pour gagner une misère. Je n’écris pas pour donner de l’espoir, j’écris pour interpeller.
Vous auriez pu écrire un texte similaire à partir de Paris ?
Non, même si je crains que dans tous mes écrits, la tristesse et la solitude soient toujours présentes parce qu’elles m’habitent
À Paris, l’environnement est différent. J’écrirais une solitude qui n’est plus intérieure, mais sociale. Ce ne serait plus le père de famille qui se sent seul, bien qu’entouré, mais cette vieille dame qui multiplie les visites chez le médecin, seulement pour avoir quelqu’un à qui parler de temps à autre.
Merci pour toutes vos réponses. Aurons-nous le plaisir de lire de nouveaux écrits de Stéphanie Dongmo prochainement ?
J’espère bien. Je ne compte pas m’arrêter à ce premier ouvrage. J’ai des nouvelles qui dorment dans les tiroirs, mais je crois que je vais les laisser dormir encore un peu plus. Je travaille actuellement à un premier roman. Je veux prendre le temps d’écrire des choses qui parlent aux gens.
///Article N° : 11212