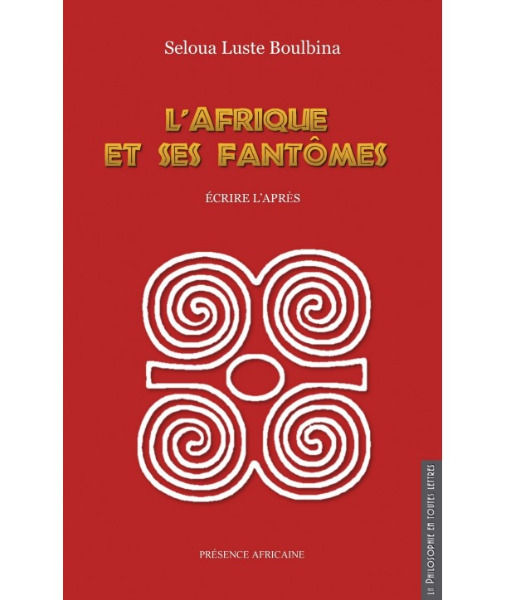Née en France, Seloua Luste Boulbina grandit dans l’Alger de l’après indépendance et poursuit des études de philosophie et de Sciences Politiques à Paris (agrégation, doctorat, habilitation à diriger des recherches). Théoricienne du post-colonial, elle s’intéresse aux phénomènes de subjectivation, qu’ils soient politiques, littéraires ou artistiques.
Actuellement directrice du programme « La décolonisation des savoirs » au Collège international de philosophie et chercheuse associée au Laboratoire de changement social et politique de l’Université Denis Diderot Paris 7, Seloua Luste Boulbina est également membre du comité de rédaction de la revue d’art contemporain Afrikadaa. Elle a notamment publié Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie (Sens Public, 2008), Les Arabes peuvent-ils parler? (Blackjack, 2011/ Payot Poche 2014) et L’Afrique et ses fantômes (Présence africaine, 2015). Elle a dirigé et contribué à de nombreux ouvrages collectifs et a publié de nombreux articles.
Je m’interroge, d’abord, à propos du titre » L’Afrique et ses fantômes » et du sous-titre » Écrire l’après « . De quoi s’agit-il ? Quels sont ces fantômes qui hantent » l’Afrique » ? Et, à la lecture de votre livre, on sait qu’ » Écrire » indique sans doute le sens de votre projet critique. Comment » Écrire l’après » ?
Seloua Luste Boulbina : Ce livre est une réflexion sur le présent de l’Afrique ou des Afriques. Celui-ci comporte trois dimensions, le passé du présent, le présent du présent, le futur du présent. Autrement dit, au même moment, a lieu une rencontre heureuse ou malheureuse entre les trois modalités du présent. Les fantômes re-viennent du passé et produisent des répétitions quelquefois remarquables. Ils sont multiples et restent généralement impensés, in-analysés.
Une langue peut ainsi être hantée par une autre langue lorsqu’on s’exprime dans une langue selon les structures d’une autre langue. On peut par exemple parler en arabe, en anglais ou en français ! Une histoire peut tout à fait ne pas être réellement prise en charge en dépit des récits nationaux qui se sont élaborés pour et par les indépendances. Je pense particulièrement à la guerre largement passée sous silence – car les guerres ont été nombreuses sur le continent, que ce soit pour les indépendances ou après les indépendances -. Les blessures physiques et psychiques des individus sont restées, si l’on peut dire, sans recours. Les vies humaines ne sont pas toujours estimées à leur juste valeur. De nombreux sujets restent tabous. De façon générale, je crois important de situer la réflexion au niveau des sujets.
» Écrire l’après » : j’emprunte cette expression à l’écrivaine Assia Djebar et à son livre intitulé Des voix qui m’assiègent. Il me semble en effet que l’on écrit ce que l’on ne peut pas dire. En ce sens, ce dont on ne peut parler, il faut l’écrire. Comme lectrice, j’ai toujours aimé les textes qui ouvrent des pistes, déplacent les perspectives, et présentent une certaine radicalité théorique. C’est pourquoi j’apprécie tant un Fanon ou un Saïd qui, de mon point de vue, écrivent l’après. Comment ? Les voies sont multiples et les possibilités diverses. Pour moi, la connaissance de soi est la condition de tout après.
Ce n’est donc pas un hasard si Achille Mbembe, dans sa belle préface, insiste sur votre riche parcours et la particularité de votre démarche dans laquelle la pratique et l’expérience occupent une place de choix
S. L. B. : J’ai été formée à la philosophie en France. On m’a appris à tenir des discours abstraits, normatifs et surplombants sur des sujets considérés comme nobles quand (tant) ils étaient désincarnés. J’ai choisi de compléter cette formation par des études de Sciences politiques, pour mieux comprendre la consistance des concepts philosophiques au regard des situations empiriques dont il était au fond question. Les textes de Tocqueville sur l’Algérie ou sur l’esclavage, par exemple, sont considérés comme mineurs et sont séparés de ses analyses de la démocratie américaine ou de l’Ancien régime et la révolution. Mais il ne suffit pas d’être opposé à l’esclavage, il faut savoir comment en sortir. Alors, une autre pratique de la philosophie est en jeu.
C’est ainsi que j’ai élaboré, ultérieurement, et notamment à partir de la lecture de Tocqueville, le concept de colonie. Le terme de colonisation en usage dans l’historiographie exprime en fait l’idée que, du point de vue des colonisateurs, la colonisation n’est jamais achevée, n’est jamais complète, n’est jamais suffisante. J’entends ne pas reprendre le point de vue colonial. La colonie est une réalité politique qu’il convient de penser, d’autant qu’elle est un régime d’exception qui contredit frontalement le discours universaliste tenu par ailleurs.
La phase des indépendances est le début de la décolonisation car il me semble que la lutte pour l’indépendance ne doit pas être confondue avec la décolonisation. Les années glorieuses ne sauraient occulter les années de plomb et leurs problématiques spécifiques. J’y suis d’autant plus sensible que j’ai vécu dans l’Alger de l’après indépendance. Pendant une décennie, la politique étrangère de l’Algérie indépendante fut sublime et Alger le grand » rendez-vous du donner et du recevoir « , selon la fameuse formule de Senghor, la capitale du Tiers Monde, des minorités et des luttes de libération. Bouchra Khalili expose actuellement à Paris une pièce intitulée Foreign Office qui exhume et exhibe l’intense internationalisation de l’époque, et son panafricanisme. Mon enfance a baigné dans le cosmopolitisme.
Sur le plan personnel, et je ne crois pas qu’il soit théoriquement indifférent, je suis habitée par ces questions. Mon père était l’un des quatre » Français musulmans » avocats du FLN en France. Il était en charge de la région Sud-Est. Il a contracté le mariage post-colonial par excellence – parce qu’il consacre l’égalité enfin gagnée – en épousant une » Européenne « , une Française blonde aux yeux bleus. Car, non seulement il n’y avait pas d’unions entre » Européens » et » Musulmans » mais les relations sexuelles coloniales s’établissaient – illégitimement mais licitement – entre » Européens » et » Musulmanes « .
J’ai aussi connu l’un des premiers collectionneurs » nationalistes » en Algérie, Laïd Mécheri, qui a été très important pour moi. Pour soutenir les jeunes artistes algériens, il leur a systématiquement acheté des uvres. Je pense particulièrement à Denis Martinez que j’appréciais beaucoup. » Pied noir « , il a choisi de rester en Algérie après 1962 et est l’un des fondateurs du groupe Aouchem (Tatouage), un groupe dissident qui, dès 1963, représentait en quelque sorte un » salon des refusés « .
En effet, votre introduction pose clairement et précisément quelques bonnes questions. Votre point de départ concerne » Ce que vivent les gens, ce qu’ils portent en eux, quoique souvent imperceptible, n’est pas toujours inaccessible » De quoi s’agit-il ?
S. L. B. : La communication mintéresse au plus haut point tant il y a de troubles divers de la communication. Je suis frappée par exemple par l’impossibilité – que beaucoup relèvent chez beaucoup – de se projeter dans l’après. Très souvent, les affaires sont traitées au jour le jour, quasi clandestinement. La programmation, la diffusion des informations ne sont pas automatiques. On peut assister quelquefois, pour des raisons diverses, à une culture voire un culte du secret. Du dehors, ce n’est pas nécessairement manifeste ; du dedans en revanche, la situation est parfaitement observée tant elle se répète. Qu’est-ce qui se révèle et s’exprime dans cet habitus caractéristique ?
Que signifie d’autre part être orphelin quand on a perdu son père ou sa mère dans une lutte militaire ou politique? Quelles sont les conséquences d’une condamnation à mort quand on y a survécu ? L’élimination des opposants politiques n’est pas sans effet, que ce soit sur le plan politique ou personnel. Dans quel état est plongé celui dont un parent ou un ami est accusé de trahison ou d’espionnage, sans parler de la personne mise en cause ? On sait que les peines ne sont pas strictement politiques et judiciaires mais aussi sociales et privées. Elles n’atteignent pas individuellement mais collectivement. Les non-dits, les silences sont tout aussi dangereux qu’ils sont nombreux.
Enfin, je parlerai pour vous répondre de la question de la race au nord de l’Afrique. Les Français ont distingué les » Bruns » d’Afrique du Nord des » Noirs » d’Afrique. Qu’est-ce qu’être noir en Tunisie, en Algérie ou au Maroc ? La population de ces pays est socialement racialisée. Les » Africains » y sont les » autres « , les » Noirs « . A l’inverse, toute rencontre de philosophie africaine exclut par principe les Africains du Nord, considérés comme » arabes « . Voilà qui signifie qu’il y a des transmissions problématiques correspondant à une certaine histoire et à certains préjugés.
Parmi les auteurs que vous citez souvent, il y a Frantz Fanon et Edward Saïd. Dans le chapitre qui ouvre votre essai, » Sauver sa peau « , vous dites : » Car la peau dont parle Fanon n’est pas seulement la peau noire pour laquelle les masques blancs sont prescrits et pour finir proscrits. C’est la peau même du colonisé« . Quelle est cette peau ? Et comment peut-elle être sauvée ?
S. L. B. : Je vais revenir sur le groupe Aouchem que j’ai évoqué. S’il a existé explicitement en Algérie, il a existé, informellement si l’on peut dire, en Tunisie et au Maroc. Aux lendemains des indépendances, des peintres ont choisi de se référer dans leur travail plastique aux inscriptions symboliques traditionnelles tracées sur la peau, en particulier celle des femmes, pour exprimer leur inventivité et leur rupture avec tout orientalisme et tout colonialisme. Plus de paysage portuaire, plus de chameaux dans le désert, plus de portrait de femme dévoilée. La peinture de ces artistes allait entrer de plein pied dans l’histoire générale de l’art. Pour ce faire, la peau est placée au premier plan. Je pense notamment au travail du Marocain Farid Belkahia, aujourd’hui décédé, qui a travaillé sur du cuivre, du bois mais aussi – et surtout – des peaux. Il a participé et au festival des Arts Nègres de Dakar, en 1966, et au festival Panafricain d’Alger, en 1969.
La peau demande à être protégée des atteintes qu’elle peut subir et notamment des blessures narcissiques qui font d’un épiderme le signe patent d’une infériorité. L’égalisation épidermique n’est pas une mince affaire tant l’imaginaire racial est puissant c’est-à-dire aussi partagé. C’est un partage politique et esthétique du sensible. En ce sens, je nomme peau ce que Hegel appelle, du moins dans la traduction française de la Phénoménologie, » être-là sensible « . S’imposer comme » conscience de soi « , et sauver sa peau, exige un travail considérable. Ce travail est également une restauration narcissique qui, politiquement, est passée par le nationalisme, le panafricanisme, le tiers-mondisme sans même parler, philosophiquement, de la négritude. Il est fort remarquable, à cet égard, que Césaire, reprenant les trois questions kantiennes dans son Discours sur le colonialisme, transforme la question » que puis-je connaître ? » en » qui suis-je ? « . L’assignation et l’interpellation raciales et coloniales ont forcé ceux et celles qui étaient ainsi assignés et interpellés à se définir par eux-mêmes, tâche impossible s’il en est, mais nécessaire dans le contexte.
Ici cependant, en faisant de la peau une catégorie à part entière, je m’inspire surtout, outre Fanon, de l’idée de » moi-peau » développée par le psychanalyste Didier Anzieu. C’est pour lui » une figuration dont le Moi de l’enfant se sert au cours des phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme Moi contenant les contenus psychiques, à partir de son expérience de la surface du corps « , un » parchemin originaire « , une surface d’inscription(s). Il déplace ainsi la question du moi et de l’autre et la remplace par celle du dedans et du dehors, corrélés au holding (tenir) et au handling (soigner). Je trouve intéressant de réfléchir sur le sujet en termes de limites surtout quand il s’agit du sujet colonial et post-colonial. La colonialité, en effet, c’est l’absence de limites et de limitations. L’opération coloniale est extraordinairement » touche-à-tout « . Or la peau est, fonctionnellement, une interface, une frontière, le groupe un contenant. Le Moi-peau peut devenir passoire, enveloppe dont la continuité est interrompue par des trous. Paradoxalement, le moi est d’autant plus ouvert qu’il est moins troué. C’est ainsi que, pour une part, je conçois la décolonisation.
La réflexion sur le » devenir décolonial » est aussi une réflexion sur l’histoire, » une architecture intérieure « . Comment examiner les faits historiques ? Il faut » changer d’échelle » dites-vous, parce qu’il n’y a pas de » faits du dehors » sans » émotions du dedans « . Dans ces conditions, comment concevoir l’histoire ?
S. L. B. : Parler d’architecture intérieure revient à dire que l’histoire nous structure par-delà la mémoire et que l’opposition entre l’histoire et la mémoire demeure relativement artificielle. Le point de vue historique est toujours – mais plus ou moins – celui de Dieu ou – tout du moins – du » spectateur impartial » qui n’est pas directement concerné par l’action et se trouve placé dans une spécularité méthodologique qui rend la sympathie possible. Ce spectateur est une espèce de juge qui examine les faits du dehors. Il est, selon les termes de Smith, » imaginaire « , » supposé « , » abstrait « , » un homme en général « . Il est – croit-il – transparent, du moins à lui-même. Il peut alors manifester toute la » prudence » qui s’impose et trouver le » point de convenance « .
Mais on peut examiner les choses tout à fait différemment en les regardant non du dehors mais du dedans, non comme juge ou spectateur mais comme agent ou acteur, non » objectivement « , consciemment et clairement mais » subjectivement « , dans l’opacité, notamment à soi. L’histoire n’est pas alors un objet d’étude et d’enseignement mais un écheveau de transmissions. Il n’y a plus alors de point de convenance, de prudence épistémologique, de juste milieu déontologique. Je crois que la meilleure référence historiographique française en la matière est celle d’Ivan Jablonka pour lequel l’histoire est » une littérature contemporaine » (2014). Quand il travaille sur la Shoah, il écrit » l’histoire des grands-parents que je n’ai pas eus » (2012). Cela ne l’empêche pas d’enquêter sur » les enfants en exil, transfert de pupilles réunionnais en métropole » (2007) car il n’y a pas de véritable solution de continuité entre les deux champs.
De mon point de vue, il est indispensable de s’exprimer » en son nom propre » ou » à la première personne » ; cela évite de se laver les mains des événements. Il me semble curieux de s’intéresser à certaines questions comme s’il s’agissait du sexe des anges, c’est-à-dire scolairement ou académiquement sans être pratiquement ou empiriquement investi. Je comprends parfaitement que, sur ce plan, Edward Saïd préfère Frantz Fanon à Michel Foucault. En 1968, celui-ci restait à la bibliothèque. En 1954, Frantz Fanon choisissait le FLN.
Architecture intérieure
» C’est la maison qui constitue la seule représentation typique, c’est-à-dire régulière, de l’ensemble de la personne humaine (
) font également partie de ce symbole les fenêtres, portes, portes cochères qui symbolisent les accès dans les cavités du corps, les façades, lisses ou garnies de saillies et de balcons pouvant servir de points d’appui » : Freud a, dans son Introduction à la psychanalyse, comparé le sujet à une maison avec ses espaces différenciés et a pu ainsi dire » le moi n’est pas maître dans sa propre maison « . L’architecture n’est ni construite par le sujet, ni entièrement connue du sujet lui-même. Le changement d’échelle est également un changement de plan.
Vous envisagez également le passage de l’historique à l’historicité, dans une réflexion sur la » violence, clé de la décolonisation « . Pourquoi ?
S. L. B. : Si la violence est une clé de la décolonisation, c’est comme un mal nécessaire. Car ses effets positifs pour les indépendances se transforment négativement puisque les ennemis de l’extérieur se trouvent très rapidement remplacés par des ennemis de l’intérieur, les opposants politiques au pouvoir en place. Le militaire l’emporte alors sur le civil, comme c’était le cas dans le cadre colonial. C’est pourquoi je parle de soleil noir des indépendances car elles ne sont pas toujours synonymes de joie. Elles renvoient aussi aux pathologies psychiques dans lesquelles l’histoire d’hier habite le présent subjectif.
Je me souviens de la projection, en 2012, d’un film d’Olivier Py au Forum des images à Paris. Ses parents, » pieds-noirs « , avaient filmé leur quotidien dans l’Algérie des années cinquante : pique-nique à la plage, déjeuners dominicaux
puis leur vie en France : réunions de famille, jeux d’enfants
Quelqu’un, dans la salle, s’est scandalisé de ces images, affirmant haut et fort qu’elles étaient honteuses. Pour lui, les images parlaient au présent, comme si la guerre d’Algérie était un présent et les parents d’Olivier Py d’horribles adversaires, comme si le temps n’avait pas passé. C’est la différence entre Histoire et historicité. Les temporalités subjectives ne sont pas ajustées sur le calendrier, ce qui n’est pas sans provoquer curiosités et bizarreries.
C’est pourquoi je considère qu’il faut traduire le passé en présent, pour accéder au présent du présent lui-même et ne pas porter les chimères qui entravent toute avancée dans le temps, c’est-à-dire tout passage, toute transformation, et, au fond, toute trahison du passé.
La question linguistique est clairement posée : » Les langues obligent ou empêchent de dire « , dites-vous
S. L. B. : Oui. Les usages ne sont pas indifférenciés. En Europe, Elias Canetti a narré ses aventures linguistiques dans un récit qui est aussi celui de la migration. Né en Bulgarie, et parlant le ladino, il déménage avec ses parents en Angleterre. A la mort de son père, il part pour la Suisse et apprend l’allemand avec sa mère en vue de s’établir en Autriche. Il passe finalement son adolescence à Zurich. L’allemand n’est pas sa langue primitive ; elle est néanmoins une langue maternelle qu’il élira en littérature. Cette situation très particulière est cas général sur le continent africain car – les écrivains en témoignent largement – on y écrit dans une langue qui n’est pas celle que l’on parle à la maison, ou en famille. Ailleurs, un Edward Saïd a précisément décrit la situation dans laquelle sa famille se trouvait lorsqu’elle vivait au Caire. Dans son autobiographie, il a parlé de son père, de son accent (langue fantôme), du divorce, si l’on peut dire, entre l’usage de l’anglais et la fonction de l’arabe.
Le statut des langues est en Afrique tel qu’il est au fond prescriptif et crée des disparités considérables entre ceux qui, polyglottes, s’expriment dans des langues qui » ne s’écrivent pas » et ceux qui ont appris les langues coloniales – notamment à les écrire – tout en maintenant l’usage d’une autre langue pour d’autres sphères de leur vie personnelle. Le cas de l’arabe est singulier car le Coran se comprend, se récite et se dit en arabe, ce qui sacralise cette langue, du moins dans son usage religieux, et en tout cas dans les pays du continent non arabophones. Là aussi, le partage n’est pas indifférent. Il est issu de différences et produit des différences dans une inégalité qui relègue certaines langues à l’usage domestique et destine d’autres langues à l’usage politique ou religieux.
Enfin, la vie sexuelle peut-elle se dire dans n’importe quelle langue et indifféremment ? Les études montrent que l’élection d’une langue plutôt que d’une autre n’est pas aléatoire. Bien au contraire, elle est déterminée, notamment par le genre.
L’Afrique et ses fantômes concerne, bien sûr, » l’espace sexué et le genre dévoilé « . Quels rapports entre genre, histoire et politique ?
S. L. B. : Pour l’Afrique, les premières analyses ne mentionnent pas même la question du genre. Qu’il s’agisse de démocratie ou de développement, d’analyse ou de pronostic, le propos est » général « , c’est-à-dire qu’il occulte et omet la division sociale du travail, la construction du genre, l’aliénation des femmes. Ce n’est que de façon spécifique que les problèmes sont abordés. Je pense par exemple au livre que la féministe Awa Thiam a publié en 1978 : La Parole aux négresses. Des ouvrages politiquement et historiquement fondamentaux font l’impasse sur le sujet. Les écrivaines ont gagné une certaine visibilité internationale, en particulier lorsqu’elles ont émigré. En revanche, les théoriciennes restent reléguées à l’arrière-plan. Ce qui s’observe dans la pratique est répliqué ou dupliqué dans la théorie.
Historiquement, les héroïnes sont vite oubliées. Elles ne participent pas aux festivités si elles contribuent aux luttes. Qui se souvient de l’une des femmes les plus connues et les plus médiatisées du XXe siècle, l’Algérienne Djamila Bouhired, auprès de laquelle son défenseur, Jacques Vergès, faisait pâle figure ? S’agissant du passé, leur rôle est minimisé. Pour le présent, le misérabilisme l’emporte trop fréquemment sur l’analyse. Il est vrai que le machisme et la misogynie sont la règle. Les droits consacrent rarement la pleine égalité. Dans les faits, les femmes sont aux fourneaux et très visiblement destinées, dans le partage, à l’espace domestique, y compris lorsqu’elles sont éduquées, qu’elles sont urbanisées et exercent une activité professionnelle. En d’autres termes, la subalternisation reste un fait majeur avec son corrélat, le » service « , quelle que soit la forme que prend celui-ci.
Ce qui m’a intéressé avec le genre dévoilé, c’est la complexité de la situation coloniale et, par voie de conséquence, post-coloniale. Le voile, métaphore de la peau, paraît faire barrage aux volontés du colonisateur qui cherche à en faire disparaître spectaculairement et autoritairement le port. Car l’imposition de la volonté – et de l’arbitraire – reste la caractéristique du pouvoir et plus particulièrement du pouvoir colonial. Le voile est une limite insupportable pour qui veut éprouver sa puissance de façon maximale. Il s’agit d’un cas idéal-typique qui montre combien le colonialisme apparemment indifférencié – un indigène n’est ni homme ni femme, ni vieux ni jeune, ni parent ni enfant
– institue des différences – entre hommes et femmes, jeunes et vieux, noirs et bruns, etc – et combien le genre est au centre des opérations coloniales.
En 1900, Hubertine Auclert publiait Les Femmes arabes en Algérie. Féministe, elle écrivait ceci : » Il n’y a que les femmes qui soient en état d’enquêter en Algérie, parce qu’étant dans la situation des Arabes, comme eux hors le droit, elles ne peuvent leur faire un reproche de leur exclusion politique « . Et elle poursuit : » Des femmes enquêteuses songeraient à prendre l’avis du peuple arabe avant de consulter les présidents de douars. Elles interrogeraient les êtres qui chez les conquis sont les plus opprimés, les plus privés de liberté : les femmes arabes « . En d’autres termes, quand l’oppression paraît la plus intense chez les hommes, elle peut être bien plus atroce pour les femmes sans que cela ait quelque existence politique – et donc discursive – que ce soit, avant les indépendances et après elles.
Aujourd’hui, le black feminism et le coloured feminism se développent surtout aux États-Unis, dans le contexte particulier de ce pays. Can the subaltern speak ? l’ouvrage de Gayatri Chakravorty Spivak auquel j’ai fait référence dans le chapitre que vous mentionnez est toujours d’actualité, spécialement en Inde. Mais il demeure pertinent pour d’autres régions du monde. Globalement, décoloniser les savoirs consiste aussi à réfléchir à la décolonisation en termes de genre, après que les études en termes de race et de classe ont été menées.
Qu’est-ce qu’on entend, finalement, puisqu’il faut » avoir de l’oreille » ?
S. L. B. : » De trop près de trop loin on n’entend rien « , dit Pascal qui désigne tout à la fois la vision et la compréhension. Il convient d’ajouter l’audition tant il est fréquent que les subalternes soient inaudibles, quel que soit leur degré ou leur mode de subalternité. On les regarde mais les entend-on ? Même leurs cris peuvent ne pas être entendus. Le travail consiste donc, à l’opposé, à tendre l’oreille pour saisir ce qui ne peut se dire qu’à demi-mot, semi-secret, vraiment discret comme ce qui s’exprime de façon pour partie inarticulée. Quand on entend une langue familière, on peut combler les vides, les signes et les sons qui n’ont pas été véritablement perçus et on peut saisir ce qui s’exprime entre les lignes. Il ne s’agit pas d’un apprentissage mais d’un exercice.
Avoir de l’oreille, c’est percevoir la complexité et la polyphonie d’une parole, d’un discours et, métaphoriquement, d’une situation. C’est relever les » accrocs » et être capable de les interpréter justement, comme de » fausses notes » signifiantes. C’est aussi entendre la diversité et la pluralité des langues qui affluent dans l’usage politiquement et culturellement prédominant des langues européennes : en ce sens, c’est entendre ce qui ne s’entend pas et c’est compter avec ce qui échappe à l’oreille, faute de posséder, en l’espèce, l’oreille absolue. Si Freud n’a pu totalement comprendre son fameux » homme aux loups « , c’est parce que celui-ci, qui s’exprimait en allemand, parlait russe et anglais dans son enfance. Ces deux langues ne furent pas – sur le plan inconscient – remplacées par l’allemand mais déformées et déguisées dans l’allemand.
Enfin on ne peut recourir à un jargon et avoir de l’oreille. Le jargon est en effet une langue de bois académique qui permet à des spécialistes de jouir d’une autorité. Il détruit irrémédiablement la polyphonie et dissout les énonciations originales dans la répétabilité des énoncés.
Un mot pour conclure ?
S. L. B. : Toute réflexion post-coloniale est un tour du monde. Le post-colonial est en effet le corrélat de la mondialisation. Il en est la condition de possibilité. Car la mondialisation renvoie à une égalisation des mondes – celle-ci fut-elle relative. Des pays » émergents « , selon cette formule aussi énigmatique que parlante, pour dire que la terre présente des reliefs géopolitiques considérables.
Propos recueillis par Tanella Boni
///Article N° : 12958