Rencontre-débat exceptionnelle : « L’Afrique au coeur de l’Humanisme : tradition et modernité de la Confrérie des Chasseurs et de la Charte du Mandé »
Intervenants :
Youssouf Tata Cissé,
Amadou Tioulé Diarra et Bernard Dumont
avec la contribution du chantre Sibiri Samaké et des deux musiciens Soumaïla Fofana et Kadiatou Samaké
Moderateurs : Nassé Sangaré et Jean-Louis Domergue
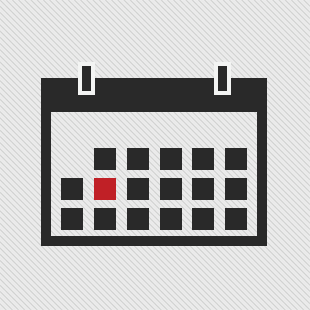
Conférence-débat
Le 06 Mai 2008
Horaires : 00:00
Horaires : 00:00
Interculturel/Migrations
Aux Ateliers Berthier – Odéon – Théâtre de l’Europe – 8 bd Berthier -(à 50m du métro), 75017 Paris – France
Heure : 17h45 à 19h45
L’accès à cette rencontre est gratuit.
Inscription :
Tél. : 01 43 48 14 67
[email protected]
Français
« On n’appartient jamais dans la vie à une ethnie, à une race ou à une communauté par la naissance ou par le sang. On en devient membre par la culture et le respect de certaines traditions » Ahmadou Kourouma, Yacouba chasseur africain (Gallimard 1998). Issu de nobles chasseurs-guerriers malinkés, il a appris à chasser avec son père et son grand-père. Est-ce en écoutant la grande geste des chasseurs qu’il a forgé l’indocilité de son écriture et de sa thématique ? Est-ce au contact de l’enseignement de ces « chasseurs, héros africains » – titre d’un autre de ces livres – qu’il a aiguisé son insolence comme sa lucidité ? Cela n’aurait rien d’étonnant. Les chasseurs furent les premiers à s’élever contre l’esclavagisme. Ils furent de tout temps et sont encore aujourd’hui protecteurs et guérisseurs ; ils veillent à la sécurité de la communauté ; défenseurs des valeurs traditionnelles, ils revendiquent l’équité et s’insurgent contre la corruption et la perte des principes moraux. Il est logique que cela n’aille pas parfois sans ambiguïtés ou malentendus, comme en témoignent les conflits avec les administrations que répercutent abondamment les journaux africains. … Alors que les chasseurs français, du moins dans leur expression les plus extrémistes, se replient sur un corporatisme obsolète au mépris des exigences écologiques de la modernité, les chasseurs de l’Afrique de l’Ouest constituent une force étonnante, profondément ancrée dans le tissu social rural et jouant un rôle loin d’être négligeable dans la préservation des équilibres, le soin et la protection des populations. Ils mettent au service de leurs semblables un savoir acquis par initiation. Contrairement à la culture judéo-chrétienne qui privilégie l’identification avec des modèles paternels, l’initiation africaine laisse chacun libre de définir sa modernité dans le cadre des valeurs collectives universelles : un contenant où chacun peut définir son contenu. C’est ainsi que la geste des chasseurs transmet, comme les mythes traditionnels, cette connaissance ancestrale sur ce qui fait l’homme et permet à la communauté de se définir un avenir. Ainsi, on n’est pas chasseur par naissance mais par initiation. A l’heure où de Côte d’Ivoire nous parviennent des discours politiques donnant dramatiquement droit de cité à la xénophobie, la parole des chasseurs d’Afrique de l’Ouest, dont la solidarité ignore les frontières, remet les pendules à l’heure et trouve une brûlante actualité. Ce texte est extrait et réarrangé de l’édito du n° 33 (décembre 2000) de la revue Africultures. Ce numéro est essentiellement consacré à La Société des Chasseurs d’Afrique de l’Ouest qui organisa du 26 au 31 janvier 2001 à Bamako, Ségou et Yanfolila au Mali un rassemblement exceptionnel regroupant les Chasseurs de six pays (Mali, Sénégal, Guinée, Gambie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso). La Société des Chasseurs a une histoire très ancienne. Certains chasseurs la disent « millénaire », d’autres en font remonter l’origine « moderne » au 12ème siècle, à l’époque de l’apogée de l’Empire du Mandingue, cet Etat organisé qui étendit son influence sur la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest. La Société des Chasseurs est une société initiatique ; elle a traversé les siècles et elle est toujours vivante aujourd’hui. Elle montre un certain nombre de similitudes avec la Franc-Maçonnerie.
La Charte du Mandé aurait été proclamée en 1222 par Soundjata KEITA, fondateur de l’Empire du Mali et ses pairs. Elle reste la référence majeure des sinbo, Grands Maîtres chasseurs du Manden. Les Chasseurs sont donc, en quelque sorte les gardiens de cette Charte. Sa conservation et sa transmission jusqu’à nos jours est le fait, comme souvent en Afrique, de la tradition orale. Elle n’a été transcrite et traduite en Français que récemment. Ce texte tel qu’il est maintenant transcrit (cf la traduction de l’ethnologue Youssou Tata Cissé en annexe, extraite de l’ouvrage d’Aboubakar Fofana chez Albin Michel éditions) a certainement subi l’influence des modes d’aujourd’hui mais ceci n’enlève certainement rien aux valeurs qu’il entend véhiculer. Doit-on la qualifier de Charte des Droits de l’Homme au sens où l’Occident et plus particulièrement l’Europe, ont généré, bien plus tard des Chartes de même essence ? Des historiens, des anthropologues, des sociologues et autres chercheurs scientifiques se réunissent régulièrement depuis quelques années sur ce thème. Un des derniers exemples est la réunion qui s’est tenue à Bamako du 31 mai au 3 juin 2007 sous le titre « La Charte de Kurukanfuga en question : Culture et droit de l’homme » dont il a été rendu compte (par exemple) dans « Le Malien » du 08/06/2007 :
http://www.maliweb.net/category.php?NID=19096
Il s’agit dans cette Rencontre-Débat : (i) de faire connaître une société de pensée africaine qui est toujours bien vivante actuellement. Cette société a les mêmes fondements que les philosophies du 18ème siècle européen et notamment concernant la primauté de l’homme sur la société (à ce titre elle a pleinement participé aux combats contre l’esclavagisme en Afrique pré-coloniale) ; (ii) de faire connaître la Charte du Mandé comme Déclaration des Droits Humains. L’Afrique a elle aussi nourri l’humanisme. Ces objectifs justifient bien la labellisation de cette Rencontre-Débat dans le cadre de l’Année Européenne du Dialogue Interculturel.
La Charte du Mandé aurait été proclamée en 1222 par Soundjata KEITA, fondateur de l’Empire du Mali et ses pairs. Elle reste la référence majeure des sinbo, Grands Maîtres chasseurs du Manden. Les Chasseurs sont donc, en quelque sorte les gardiens de cette Charte. Sa conservation et sa transmission jusqu’à nos jours est le fait, comme souvent en Afrique, de la tradition orale. Elle n’a été transcrite et traduite en Français que récemment. Ce texte tel qu’il est maintenant transcrit (cf la traduction de l’ethnologue Youssou Tata Cissé en annexe, extraite de l’ouvrage d’Aboubakar Fofana chez Albin Michel éditions) a certainement subi l’influence des modes d’aujourd’hui mais ceci n’enlève certainement rien aux valeurs qu’il entend véhiculer. Doit-on la qualifier de Charte des Droits de l’Homme au sens où l’Occident et plus particulièrement l’Europe, ont généré, bien plus tard des Chartes de même essence ? Des historiens, des anthropologues, des sociologues et autres chercheurs scientifiques se réunissent régulièrement depuis quelques années sur ce thème. Un des derniers exemples est la réunion qui s’est tenue à Bamako du 31 mai au 3 juin 2007 sous le titre « La Charte de Kurukanfuga en question : Culture et droit de l’homme » dont il a été rendu compte (par exemple) dans « Le Malien » du 08/06/2007 :
http://www.maliweb.net/category.php?NID=19096
Il s’agit dans cette Rencontre-Débat : (i) de faire connaître une société de pensée africaine qui est toujours bien vivante actuellement. Cette société a les mêmes fondements que les philosophies du 18ème siècle européen et notamment concernant la primauté de l’homme sur la société (à ce titre elle a pleinement participé aux combats contre l’esclavagisme en Afrique pré-coloniale) ; (ii) de faire connaître la Charte du Mandé comme Déclaration des Droits Humains. L’Afrique a elle aussi nourri l’humanisme. Ces objectifs justifient bien la labellisation de cette Rencontre-Débat dans le cadre de l’Année Européenne du Dialogue Interculturel.
Partager :



