Pour sa huitième édition, fidèle à son intention de départ, le FIFDA propose des films inédits ou rares prenant comme sujet les diasporas africaines. Ce ne sont ainsi pas des oeuvres célébrées dans le circuit des autres festivals que sélectionnent Diarah N’Daw-Spech et Reinaldo Barroso-Spech, basés à New-York où ils dirigent Artmattan Productions (festival et diffusion de films), mais des fictions sensibles et des documentaires centrés sur le monde noir, notamment des portraits de figures historiques ou d’artistes.
Ce vendredi 7 septembre, le festival s’est ouvert au cinéma CGR Paris Lilas sur un beau film à ne pas rater. Mais d’autres films sont aussi à découvrir.
 Le Citoyen (Az állampolgár, 2016; 108′) de Roland Vranik se déroule en Hongrie, un pays dont on sait l’aversion des dirigeants pour les réfugiés. Le fait qu’il ait pris ce thème comme sujet en dit assez sur son courage et sa pertinence face à la montée des populismes. Il est largement porté par le charisme tranquille de son acteur principal, Dr. Cake-Baly Marcelo, qui interprète Wilson, un réfugié dont la famille a été tuée durant la guerre civile en Guinée-Bissau. Wilson, qui travaille comme gardien de sécurité dans un supermarché de Budapest, a du mal à répondre aux critères qui lui permettraient d’obtenir la nationalité hongroise. Il prend des cours auprès de Maria (Ágnes Máhr), la sœur de son patron, pour perfectionner sa connaissance de la culture et de l’Histoire hongroises. Ils ont tous deux dans les 50-60 ans et apprennent à se connaître et à s’aimer. Mais il y a Shirin (Arghavan Shekari), une jeune réfugiée iranienne sans papiers, que Wilson héberge secrètement. Enceinte, elle accouche chez lui. Il la protège alors même que Maria quitte homme et enfants pour vivre avec lui…
Le Citoyen (Az állampolgár, 2016; 108′) de Roland Vranik se déroule en Hongrie, un pays dont on sait l’aversion des dirigeants pour les réfugiés. Le fait qu’il ait pris ce thème comme sujet en dit assez sur son courage et sa pertinence face à la montée des populismes. Il est largement porté par le charisme tranquille de son acteur principal, Dr. Cake-Baly Marcelo, qui interprète Wilson, un réfugié dont la famille a été tuée durant la guerre civile en Guinée-Bissau. Wilson, qui travaille comme gardien de sécurité dans un supermarché de Budapest, a du mal à répondre aux critères qui lui permettraient d’obtenir la nationalité hongroise. Il prend des cours auprès de Maria (Ágnes Máhr), la sœur de son patron, pour perfectionner sa connaissance de la culture et de l’Histoire hongroises. Ils ont tous deux dans les 50-60 ans et apprennent à se connaître et à s’aimer. Mais il y a Shirin (Arghavan Shekari), une jeune réfugiée iranienne sans papiers, que Wilson héberge secrètement. Enceinte, elle accouche chez lui. Il la protège alors même que Maria quitte homme et enfants pour vivre avec lui…
Le Citoyen n’est pas du « cinéma de pancarte ». C’est la dimension humaine que Roland Vranik veut aborder dans ce mélodrame réaliste : aucun personnage n’est rejeté ou idéalisé, chacun a son intégrité. Le drame vient d’un Etat aux pratiques discriminantes qui rend caduque la générosité des êtres. Certes, le racisme ordinaire est présent, celui auquel tout Noir est confronté en Europe – petites phrases assassines, clichés sans cesse rappelés, agressions verbales et regards sur l’étranger – mais il n’est pas général : Wilson aime vivre en Hongrie et la plupart des gens y sont accueillants. Roland Vranik ne fait pas l’apologie de son pays pour autant : il n’évite pas la dureté des lenteurs administratives systématiques envers « les Africains » et des reconduites à la frontière. On sent une volonté de faire réfléchir sans brusquer.
La généralisation des plans rapprochés et la rareté des extérieurs pourraient donner à l’ensemble une facture de téléfilm, mais le soin apporté aux lumières, au cadrage et au montage ainsi que la qualité du jeu des acteurs font de ce scénario bien abouti un film prenant et émouvant.
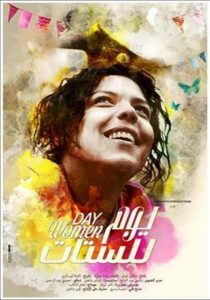 Il est intéressant de poursuivre la découverte avec Un jour pour les femmes (Youm lel Setat, 2016, 110′) de l’Egyptienne Kamla Abou Zekri. Multiprimé en festivals, inédit en France, il s’attache à des femmes de caractère dans un quartier populaire du Caire en 2009, à la fin de l’ère Moubarak. On annonce que la nouvelle piscine sera réservée aux femmes le dimanche. Dès le premier dimanche, les femmes se rassemblent. Azza (Nahed El Sebaï) avait longtemps rêvé de porter un maillot de bain, la rebelle Shamiya (Ilham Shahin) trouve enfin quelqu’un pour écouter ses histoires privées et Laila (Nelly Karim) essaye de dépasser le deuil de son fils et de son mari dans l’incendie du ferry Al-Salam qui avait sombré en Mer Rouge en 2006. La piscine devient un rendez-vous hebdomadaire, un lieu privilégié d’échanges et d’expression de soi en liberté, ce qui n’est pas sans troubler les hommes… L’enjeu sera la solidarité des femmes face au patriarcat. Ce nouveau film se situe ainsi dans la continuité de One-Zero (Whaded-Sefr, 2009) où la réalisatrice abordait la question du divorce et remariage des femmes coptes. Il s’inscrit dans l’émergence de réalisatrices dans le cinéma égyptien et dans l’amplification des thématiques féministes : le harcèlement sexuel dans Les Femmes du bus 678 de Mohamed Diab (2012), les femmes atteintes du sida dans Asmaa d’Ihab Amr et Amr Salama (2011), es filles de la rue dans le documentaire Ces filles-là (El-Banate Dol, 2018) de Tahani Rached, etc. Il y avait cependant des précurseurs, par exemple dans le « nouveau réalisme » des années 80 où avait débuté Enas El Deghedy, réalisatrice et actrice qui s’était attaquée au problème des femmes égyptiennes se prostituant dans les pays du Golfe ou à celui de l’inégalité face à l’adultère. Sans oublier le rôle des femmes dans la naissance de l’industrie cinématographique égyptienne dans les années 20 ou les thématiques féminines de certains films d’Henry Barakat.
Il est intéressant de poursuivre la découverte avec Un jour pour les femmes (Youm lel Setat, 2016, 110′) de l’Egyptienne Kamla Abou Zekri. Multiprimé en festivals, inédit en France, il s’attache à des femmes de caractère dans un quartier populaire du Caire en 2009, à la fin de l’ère Moubarak. On annonce que la nouvelle piscine sera réservée aux femmes le dimanche. Dès le premier dimanche, les femmes se rassemblent. Azza (Nahed El Sebaï) avait longtemps rêvé de porter un maillot de bain, la rebelle Shamiya (Ilham Shahin) trouve enfin quelqu’un pour écouter ses histoires privées et Laila (Nelly Karim) essaye de dépasser le deuil de son fils et de son mari dans l’incendie du ferry Al-Salam qui avait sombré en Mer Rouge en 2006. La piscine devient un rendez-vous hebdomadaire, un lieu privilégié d’échanges et d’expression de soi en liberté, ce qui n’est pas sans troubler les hommes… L’enjeu sera la solidarité des femmes face au patriarcat. Ce nouveau film se situe ainsi dans la continuité de One-Zero (Whaded-Sefr, 2009) où la réalisatrice abordait la question du divorce et remariage des femmes coptes. Il s’inscrit dans l’émergence de réalisatrices dans le cinéma égyptien et dans l’amplification des thématiques féministes : le harcèlement sexuel dans Les Femmes du bus 678 de Mohamed Diab (2012), les femmes atteintes du sida dans Asmaa d’Ihab Amr et Amr Salama (2011), es filles de la rue dans le documentaire Ces filles-là (El-Banate Dol, 2018) de Tahani Rached, etc. Il y avait cependant des précurseurs, par exemple dans le « nouveau réalisme » des années 80 où avait débuté Enas El Deghedy, réalisatrice et actrice qui s’était attaquée au problème des femmes égyptiennes se prostituant dans les pays du Golfe ou à celui de l’inégalité face à l’adultère. Sans oublier le rôle des femmes dans la naissance de l’industrie cinématographique égyptienne dans les années 20 ou les thématiques féminines de certains films d’Henry Barakat.
 Un jour pour les femmes est produit par une femme (Ilham Shahin, qui interprète Shamiya), écrit par une scénariste (Hanaa Atteya) and filmé par une opératrice (Nancy Abdel Fattah). Cela donne un film où les femmes se déploient et s’émancipent, ce que souligne la douce musique de Tamer Karawan. Les hommes, eux, restent caricaturés (le frère de Laila en brute islamiste) ou peu crédibles (Farghaly, l’amoureux de Laila). Ce déséquilibre affaiblit le film dont le montage est parfois étonnant, au détriment du rythme global, mais il reste de sa vision une vitale énergie.
Un jour pour les femmes est produit par une femme (Ilham Shahin, qui interprète Shamiya), écrit par une scénariste (Hanaa Atteya) and filmé par une opératrice (Nancy Abdel Fattah). Cela donne un film où les femmes se déploient et s’émancipent, ce que souligne la douce musique de Tamer Karawan. Les hommes, eux, restent caricaturés (le frère de Laila en brute islamiste) ou peu crédibles (Farghaly, l’amoureux de Laila). Ce déséquilibre affaiblit le film dont le montage est parfois étonnant, au détriment du rythme global, mais il reste de sa vision une vitale énergie.
 Discrètement sorti en salles en février 2018, Le Crime des anges de Bania Medjbar construit un récit dramatique sur fond sociologique de la Busserine, grande cité des quartiers Nord de Marseille. Une petite arnaque mal montée va finalement tourner au drame lorsque l’engrenage des mauvaises idées pour s’en tirer plonge le jeune Akim (Youssef Aghal) dans le milieu des dealers et gangsters. La réalisatrice est issue de la Busserine et cet ancrage se sent dans ce film autoproduit où jouent nombre de gens du quartier. On le retrouve dans les gestes et attitudes, cette corporalité qu’atteint parfois le film et qui permet de sentir ce qui anime les jeunes. Il est cependant dommage que le récit dramatique du glissement de la petite vers la grande délinquance prenne peu à peu le dessus sur cet ancrage, non pour le détourner du réel, mais pour virer vers la prévisible impasse d’un jeune ange coincé à qui l’on souhaiterait de trouver les ailes de s’en sortir. Le film y perd en légèreté ce qu’il gagne en gravité du constat, des dialogues qui tentent de faire passer des messages à l’inexorabilité de l’enchaînement fatal. Il y perd aussi la possibilité de donner à ses protagonistes l’espace où le cliché laisse la place au vertige, où le sauvage prend le dessus, hors des sentiers battus. Il manque ici l’âpreté et l’énergie solaire qui fait les grands films, la férocité de mise en scène qui nous emporterait, mais ce début n’en reste pas moins prometteur : on s’attache à suivre Akim et ses péripéties jusqu’à l’accompagner dans son implacable destin.
Discrètement sorti en salles en février 2018, Le Crime des anges de Bania Medjbar construit un récit dramatique sur fond sociologique de la Busserine, grande cité des quartiers Nord de Marseille. Une petite arnaque mal montée va finalement tourner au drame lorsque l’engrenage des mauvaises idées pour s’en tirer plonge le jeune Akim (Youssef Aghal) dans le milieu des dealers et gangsters. La réalisatrice est issue de la Busserine et cet ancrage se sent dans ce film autoproduit où jouent nombre de gens du quartier. On le retrouve dans les gestes et attitudes, cette corporalité qu’atteint parfois le film et qui permet de sentir ce qui anime les jeunes. Il est cependant dommage que le récit dramatique du glissement de la petite vers la grande délinquance prenne peu à peu le dessus sur cet ancrage, non pour le détourner du réel, mais pour virer vers la prévisible impasse d’un jeune ange coincé à qui l’on souhaiterait de trouver les ailes de s’en sortir. Le film y perd en légèreté ce qu’il gagne en gravité du constat, des dialogues qui tentent de faire passer des messages à l’inexorabilité de l’enchaînement fatal. Il y perd aussi la possibilité de donner à ses protagonistes l’espace où le cliché laisse la place au vertige, où le sauvage prend le dessus, hors des sentiers battus. Il manque ici l’âpreté et l’énergie solaire qui fait les grands films, la férocité de mise en scène qui nous emporterait, mais ce début n’en reste pas moins prometteur : on s’attache à suivre Akim et ses péripéties jusqu’à l’accompagner dans son implacable destin.
Des figures noires exemplaires
Le FIFDA 2018 offre une série de documentaires sur d’importantes figures que l’Histoire ne saurait oublier.
 « Je suis née noire et femme ». C’est ainsi que Lorraine Hansberry commence sa biographie et l’on sent à quel point ces deux mots sont chargés de sens. Activiste, journaliste et dramaturge, féministe et lesbienne, proche de Baldwin, elle s’est battue contre les injustices de la société américaine. Elle n’a vécu que 34 ans jusqu’à son cancer (1930-1965), mais est célèbre pour la première pièce écrite par une femme noire à être jouée à Broadway, A Raisin in the Sun (Un raisin au soleil), adaptée au cinéma par Daniel Petrie en 1961, avec Sidney Poitier dans le rôle principal, sur une famille pauvre africaine-américaine qui reçoit un chèque de 10 000 $, montant de l’assurance-vie que le père avait contractée. Chacun se met à rêver de ce qu’il pourrait réaliser… Déjà, les parents de Lorraine Hansberry avaient refusé l’inscription de l’expression negro sur son certificat de naissance et imposé le mot black. Elle luttera pour les droits civiques et ceux des femmes, mais aussi contre l’impérialisme et le colonialisme. Sighted Eyes / Feeling Heart de Tracy Heather Strain est le premier long métrage documentaire à lui être consacré. Il entremêle avec une grande maîtrise aux interviews de gens proches des archives, des films privés, des photos d’époque et des documents inédits. “One cannot live with sighted eyes and feeling heart and not know or react to the miseries which afflict this world” (on ne peut vivre les yeux ouverts et le coeur sensible sans voir les misères qui affectent le monde ou y réagir), disait Lorraine Hansberry, d’où le titre de ce passionnant documentaire.
« Je suis née noire et femme ». C’est ainsi que Lorraine Hansberry commence sa biographie et l’on sent à quel point ces deux mots sont chargés de sens. Activiste, journaliste et dramaturge, féministe et lesbienne, proche de Baldwin, elle s’est battue contre les injustices de la société américaine. Elle n’a vécu que 34 ans jusqu’à son cancer (1930-1965), mais est célèbre pour la première pièce écrite par une femme noire à être jouée à Broadway, A Raisin in the Sun (Un raisin au soleil), adaptée au cinéma par Daniel Petrie en 1961, avec Sidney Poitier dans le rôle principal, sur une famille pauvre africaine-américaine qui reçoit un chèque de 10 000 $, montant de l’assurance-vie que le père avait contractée. Chacun se met à rêver de ce qu’il pourrait réaliser… Déjà, les parents de Lorraine Hansberry avaient refusé l’inscription de l’expression negro sur son certificat de naissance et imposé le mot black. Elle luttera pour les droits civiques et ceux des femmes, mais aussi contre l’impérialisme et le colonialisme. Sighted Eyes / Feeling Heart de Tracy Heather Strain est le premier long métrage documentaire à lui être consacré. Il entremêle avec une grande maîtrise aux interviews de gens proches des archives, des films privés, des photos d’époque et des documents inédits. “One cannot live with sighted eyes and feeling heart and not know or react to the miseries which afflict this world” (on ne peut vivre les yeux ouverts et le coeur sensible sans voir les misères qui affectent le monde ou y réagir), disait Lorraine Hansberry, d’où le titre de ce passionnant documentaire.
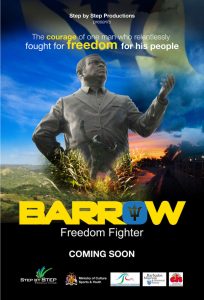 Barrow: Freedom Fighter de Marcia Weekes (72′) fait le choix du docu-fiction pour décrire le combat d’Errol Walton Barrow pour l’indépendance de la Barbade, enfin obtenue le 30 novembre 1966 après plus de 300 ans de colonisation britannique. Il mêle des scènes jouées aux interviews et documents d’époque. C’est à la fois sa force et sa faiblesse : la reconstitution séduit les sens mais réduit la réalité, figeant un homme et son contexte dans une représentation ne laissant plus de place à l’imagination. Le film se fait dès lors panégyrique et flirte avec l’emphase. Il décrit cependant une figure de courage et de détermination, dont la lutte est riche d’enseignements, tout en gardant en tête qu’aujourd’hui, l’idéalisation des grandes figures prophétiques est remis en cause par la nécessité de ne plus investir en elles l’espoir de changement mais de le réaliser par soi-même.
Barrow: Freedom Fighter de Marcia Weekes (72′) fait le choix du docu-fiction pour décrire le combat d’Errol Walton Barrow pour l’indépendance de la Barbade, enfin obtenue le 30 novembre 1966 après plus de 300 ans de colonisation britannique. Il mêle des scènes jouées aux interviews et documents d’époque. C’est à la fois sa force et sa faiblesse : la reconstitution séduit les sens mais réduit la réalité, figeant un homme et son contexte dans une représentation ne laissant plus de place à l’imagination. Le film se fait dès lors panégyrique et flirte avec l’emphase. Il décrit cependant une figure de courage et de détermination, dont la lutte est riche d’enseignements, tout en gardant en tête qu’aujourd’hui, l’idéalisation des grandes figures prophétiques est remis en cause par la nécessité de ne plus investir en elles l’espoir de changement mais de le réaliser par soi-même.
 « La musique a volé ma vie », dit d’entrée Jocelyne Beroard, figure emblématique du groupe Kassav. Ce groupe mythique a fait vibrer la planète avec le zouk, démontrant que les descendants d’esclaves ont su puiser dans les traces culturelles de leur tragique ascendance leur vitalité et leur émancipation. Mais ce n’est pas seulement la musique mais aussi et surtout la langue que met Jocelyne Beroard en avant dans Jocelyne, Mi Tche Mwen de la cinéaste martiniquaise Maharaki (2017, 90′), de ses prestations sur scène à la sensibilité de ses textes. Ses chansons semblant autobiographiques, Maharaki a développé une approche intimiste pour suivre ses aventures avec Kassav, ses combats face à un vécu parfois douloureux en société matrifocale et la résistance qu’elle a su investir dans son art. Ni résignation, ni soumission aux hommes : c’est une femme debout qui se raconte dans ses chansons. Son merci final à sa famille est aussi touchant que le reste de sa biographie.
« La musique a volé ma vie », dit d’entrée Jocelyne Beroard, figure emblématique du groupe Kassav. Ce groupe mythique a fait vibrer la planète avec le zouk, démontrant que les descendants d’esclaves ont su puiser dans les traces culturelles de leur tragique ascendance leur vitalité et leur émancipation. Mais ce n’est pas seulement la musique mais aussi et surtout la langue que met Jocelyne Beroard en avant dans Jocelyne, Mi Tche Mwen de la cinéaste martiniquaise Maharaki (2017, 90′), de ses prestations sur scène à la sensibilité de ses textes. Ses chansons semblant autobiographiques, Maharaki a développé une approche intimiste pour suivre ses aventures avec Kassav, ses combats face à un vécu parfois douloureux en société matrifocale et la résistance qu’elle a su investir dans son art. Ni résignation, ni soumission aux hommes : c’est une femme debout qui se raconte dans ses chansons. Son merci final à sa famille est aussi touchant que le reste de sa biographie.









