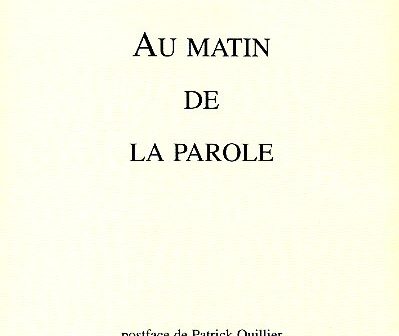À l’occasion de la parution du recueil de textes de Gabriel Mwènè Okoundji réunis dans Au matin de la parole, Patrick Quillier a rédigé une postface éclairée qui revient sur le cheminement littéraire du poète.
Il faut risquer une parole apte à faire contrepoint à la tienne, Okoundji, qui s’élève d’une région reculée de la géographie et d’une ère très ancienne dans le temps.
Tu nous convoques ici et maintenant au moment étrange de tout commencement, lorsque l’éveil des sens et des consciences ouvre, dans l’étonnement, l’émerveillement et l’émulation, à une perception du monde tout à la fois accueillante et méditative. Or, les temps qui nous sont contemporains, enserrés dans le tourbillon factice dont l’économie, la finance et la guerre ravagent, typhon enragé, un monde de plus en plus indifférencié, tendent à encercler ce qui reste d’attention dans le cadre légitime mais étroit de la survie, vaille que vaille et coûte que coûte, au milieu de ruines diluviennes. Une autre voix venue de loin, celle de Boris Gamaleya, en appelle à l’urgence d’une arche, non de Noé, mais d’Orphée, car Orphée peut être considéré comme une origine de la parole poétique et, partant, comme un modèle de sagesse par temps de furie. Gamaleya se donne Orphée pour blason en faisant remonter à la surface de ses mots une tradition grecque multiséculaire. Toi Okoundji, ton aurore de parole, elle surgit du fonds antique de l’animisme africain, fonds façonné par des siècles et des siècles d’observation généreuse du monde. De génération en génération, par le fait d’une transmission personnalisée toujours réitérée, mais aussi par l’accumulation de strates d’un savoir patiemment élaboré, à la façon d’un souffle ténu mais opiniâtre à travers les airs ou d’une lame de fond courant à travers les océans, sillonnant « la mer qui bat l’éternité au métronome de ses flux et reflux », il y a bien eu ce que tu nommes acheminement. Ampili et Pampou ont touché ta parole avec ce souffle fertile, l’ont baignée dans cette onde venue, depuis les confins immémoriaux du temps, épandre en toi ses vibrations en te rendant poreux aux énergies infimes de la vie.
Comment faire ici un heureux contrepoint aux dialogues que tu relates entre les deux voix de ton initiation propre, mais aussi aux entretiens où tu exprimes ton aventure en poésie, mais encore aux textes où tu consignes la philosophie profonde de tes poèmes, si ce n’est en retrouvant la voie de l’ode antique, celle par laquelle Pindare n’avait de cesse de faire l’éloge de la vie, ou celle dont Horace tirait les accents sereins d’une sagesse ?
Oui, il faudrait ici pouvoir renouer les fils des sentences héraclitéennes, parménidiennes et orphiques, et tresser avec eux le tissu soyeux d’une ode capable de scintiller en écho à ton chant l’arc-en-ciel des nuances, les flux évanescents de l’échange, l’acceptation généreuse de tout ce qui survient, de tout ce qui s’embrase, de tout ce qui s’éteint.
Oui, je devrais ranimer dans les souterrains de ma mémoire culturelle la plus enfouie, celle de mes « humanités » latines et grecques, le feu sacré d’une parole traversée par les vents, les fleuves, l’ombre, la lumière, les résonances de tout avec tout. Et c’est là précisément que se trouve la difficulté : les dissonances, les délais, les négations, les écarts, bref la distance malheureuse que l’Occident moderne a creusée en toute pensée, en tout mode de relation au monde, aux autres, cette coupure à la fois gigantesque (elle passe partout) et infime (elle est tapie au cur secret de chacun), comment ne pas sentir qu’elle rend bien fragile la reprise d’une parole inaugurale, inaugurale certes non comme un verbe religieux, un logos surplombant faisant du poète un prophète nimbé de surhumanité, mais inaugurale au sens d’une (re)découverte quotidienne des vérités sensibles les plus banales, celles qu’on oublie tant leur présence est discrète, humble, effacée, et pourtant elles sont la matière même de notre existence ?
J’aime qu’il t’arrive d’évoquer des figures mythiques occidentales, tel ce Protée, fils de Poséidon, avec qui tu entends partager « le secret des flots de l’existence ». Ce faisant, tu accomplis la confluence au lieu même du partage des eaux mentales et sensibles, dont nous avons tant besoin : dans le grand fleuve de l’animisme africain viennent fluctuer les courants les plus vifs de la pensée occidentale, ceux qui n’ont jamais brisé la continuité dynamique entre corps et esprit ; mais aussi : l’hydrographie européenne, avec ses Danube, Rhin, Meuse, Loire, Spree, Tage, Pô et autres Garonne, Ilissos et rivières de nos villages (pour parler comme Caeiro, que tu connais bien), se voit ainsi augmentée d’affluents venus du sud, de l’autre bord de la Méditerranée, Nil, Sénégal, Niger, Zambèze, Alima ou Congo
C’est que pour retrouver les eaux présocratiques, il me faut sans nul doute puiser aussi aux sources extra-européennes ; peut-être d’ailleurs que, pour écouter et vivifier la fluide parole de l’animisme ancestral, il t’a été nécessaire d’entendre les rumeurs d’Orphée ou de Poséidon, je veux dire, aux côtés de ton « doyen » Senghor, de Bourra Mam Kandet, de Tchicaya U Tamsi ou de « l’indépassable Césaire », les voix « occidentées » (pas oxydées pour autant, ou alors c’est d’une alchimie fondamentale, et accidentées, oui, sans doute, mais comme les paysages les plus sublimes du monde), tu nous le confies, d’Isidore Ducasse (avec la machinerie de son « vieil océan »), d’André Breton (dans tous ses flux magnétiques, selon tous ses arcanes) et de « tous les surréalistes » (je t’imagine faisant un feu avec Éluard pour ramener l’azur au bercail de vos curs, ou marmonnant quelque glossolalie rituelle avec Robert Desnos
), de René
Char (avec qui tu partages l’amour de la panthère, le dialogue avec les « Transparents », la pratique du murmure vertigineux, la « rougeur des matinaux »
), de Bernard Manciet (dont la langue nocturne et solaire à la fois a su, avec celle d’autres « occitans », s’enlacer amoureusement à la tienne, qui le lui rendait bien), et sans doute de bien d’autres
Au seuil de ce livre à qui ma tentative d’ode souterraine entend fournir une coda apte à finir sans finir, l’eau est présente, dans les nuages et dans la mer, et elle offre à ta posture initiale, qui est de méditation, l’environnement élémentaire propice. Pour que la posture soit accomplie, après la marche (tu achemines et chemines, nous y reviendrons), il faut, humblement, sereinement, ancestralement, s’accroupir : c’est alors le sable qui intervient, le sable dont tu dis que tout naît de lui, et qu’il est « ce grand corps immortel qui contient tous les corps ». C’est ainsi que tu nous invites à accueillir de toute notre sensibilité, avec les énergies liquides et aériennes (tu fais d’emblée l’éloge de l’oiseau, maître des airs et des chants), les minérales, les telluriques, denses projections de vibrations fondamentales, diapasons concrets de toutes les musiques possibles. Le sable fragmenté est pour toi tout autant ultime qu’originaire, puisqu’il est la matière qui, en s’agglomérant, crée le monde et les vivants (qui sont plus diversifiés qu’on ne le croit), et, en se désagrégeant à nouveau, signe le retour du monde et des vivants, via la mort, à la mémoire granulaire, celle où « tout change, mais rien ne meurt ». Et en effet, le sable est présent aussi dans le dernier texte de ton livre, où, à travers la litanie qui psalmodie sa « mémoire sourde » de minéral éclaté en atomes dans l’attente d’un nouveau clinamen créateur, c’est toute « l’agitation millénaire des poussières » qui donne à entendre, selon « l’impérieuse nécessité d’affirmer une continuité », la mélopée secrète de ce que certaine science moderne nomme l’interdépendance universelle, et que tu appelles, toi, dans la lignée de tes initiateurs africains, l’incessante traversée des « états du vivant ».
La « poésie d’initiation » que tu prônes consiste donc en l’accord d’une parole (dans ses concepts, ses images, sa prosodie, son rythme même, bref selon toutes ses dimensions) avec les flux continus du monde. Voilà sans doute pourquoi et Protée et Poséidon, le premier par sa capacité d’immersion dans tout, le second en raison de ses ondulations marines, sont convoqués in fine pour un implicite dialogue fructueux avec Ampili, l’inspirée du fleuve Alima, et Pampou, le mage des terres appelées Mpana. Il y a là une cohérence profonde, sous la douce autorité de laquelle, de proche en proche, tout respire avec tout, tout con-spire, comme Hippocrate et, avec lui, de nombreux sages, ici comme ailleurs, l’ont affirmé. La « poésie d’initiation » vers laquelle on est toujours en cheminement est elle-même un acheminement, pourvoyeuse qu’elle est d’une nourriture subtile faite pour reconstruire un corps et un esprit plus souples, plus légers, plus transparents à l’émouvant mouvement maintenu qui, à la manière d’une basse continue, fait tenir ensemble le monde et les vivants (bien plus nombreux qu’on ne le croit). Du monde et de ses vivants à la parole, aucune faille, aucun écart : même l’hétérogénéité qui peut les distinguer est une modalité de leur relation intime, infime et infinie tout à la fois.
Dans une telle poésie en effet, le signe n’est pas coupure creusant les distances irrémédiablement, il est arc-en-ciel associant étroitement eau, lumière et air, mais aussi monde et regard, il est, comme chez Gamaleya dans sa parole basaltique, arche où se recueillent tous les souffles de vie. C’est pourquoi tu dis du signe qu’il est « ce qui aide à lire l’émotion au-delà du tumulte » : contrairement à la pensée du signe telle qu’elle est théorisée généralement, c’est-à-dire en opérant la séparation, déplorée en son temps par Roland Barthes, « entre l’affect et le signe », ta conception du signe fait de ce dernier l’alliance indéfectible entre la sensibilité et l’intellect. S’il « aide à lire », c’est qu’il aide à lier, à relier, même s’il n’est que « trace dans le flot continuel de l’histoire », et fût-ce avec les nuds paradoxaux de la distance et de la différence.
« Dynamiser les liens » entre l’esprit et la terre, telle est la fonction du signe selon toi, et dès lors on peut se dire que même fragile, une ode peut toutefois sourdre des souterrains, émergeant peu à peu du silence obscurément bruissant de la méditation, ou du brouhaha conquérant et monde et conscience à coup de déflagrations aveuglantes. Le signe accomplit ce que vise toute légende, la transformation du tumulte en murmure, seule opération qui permette qu’on ne soit point condamné à mourir, pour faire variation sur la formule de Patrice de la Tour du Pin, de froid, de colère, de peine, de dégoût.
Tu peux dès lors à bon droit affirmer : « Un initié est à l’image du protéiforme : simple, multiple, solaire, lunaire. » Ta poésie a de fait la force d’un faisceau : elle assemble le haut et le bas, comme dans les vieilles traditions inspirées par Hermès Trismégiste et sa Tabula Smaragdina, le proche et le lointain, le grain de sable et le bloc pierreux, le simple et le multiple, le solaire et le lunaire, l’Afrique et l’Europe, Ampili et Pampou, et ainsi de suite à l’infini. C’est ce faisceau qui a rendu possible la danse que tu as pu vivre avec Pessoa au Monastère de Belém, lorsque tu méditais aux abords de sa tombe. Cette danse, permets-moi d’y voir l’alliance emblématique entre le représentant le plus virtuose de l’intranquillité qu’engendre, incessant souci, la faille ontologique qui lézarde l’Occident, et l’ambassadeur d’une Afrique fondamentale, elle aussi malmenée par tant d’idéologies plaquées, mais irriguée en profondeur par ses méditations les plus universelles.
Tu formules le vu oblatif que ce livre fasse en sorte que chacun de ses lecteurs soit plus intensément « à l’écoute du rythme des bruits de son cur », c’est-à-dire, précises-tu,
tout autant des battements du cur d’un homme et, par résonance, du cur des hommes, que
« des bruits de ce laborieux monde qui nous entoure. » De la sorte, tu te demandes à toi-même et tu demandes à chaque lecteur de « veiller scrupuleusement à ces battements », ceux des curs et ceux du monde, afin de maintenir vives la symphonie de toutes les respirations, la mélopée de toutes les vibrations, l’ode de tous les murmures.
J’aurais aimé que l’ode qu’ainsi tu m’invites à susurrer soit audible non seulement dans le silence dense de l’amitié, mais encore entre ces lignes qui viennent retentir une dernière fois, comme on s’efface au passage de l’ami porteur du « rêve fertile de la terre« , sur les points de suspension de la vie continuée
Avec nos remerciements aux éditions Fédérop et à Patrick Quillier qui ont permis la publication de ce texte.///Article N° : 8431