La 76ème édition du Festival de Cannes a déroulé ses tapis rouges, cette année largement ouverts aux films d’Afrique et du monde arabe. Notre titre, qui reprend un vieux slogan féministe ironisant la désignation patriarcale des humains par « hommes » comme si c’était naturel, annonce notre approche dans ce premier article : les regards féminins ou sur les femmes. A lire notre deuxième article : le temps de l’incertitude.
La cérémonie d’ouverture était un sans-faute, bien orchestré par Chiara Mastroianni qui cita George Cukor : « Le cinéma, c’est comme l’amour. Quand c’est bien, c’est formidable, quand c’est pas bien, c’est pas mal quand même ! » C’est à sa mère Catherine Deneuve que le festival a consacré son affiche. Elle était là pour déclarer avec Michael Douglas le festival ouvert, non sans évoquer auparavant la guerre en Ukraine en citant quelques lignes touchantes de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka.
On a déjà beaucoup parlé du film d’ouverture, Jeanne du Bary de Maïwenn, et je ne vais pas trop en rajouter. Juste un mot pour dire mon étonnement devant les nombreuses réactions qui reprochent à Maïwenn un « ego-trip ». Je ne désire pas participer à cette curée. Elle réalise et tient le rôle principal. Ce n’est pas rare au cinéma. Certes, Jeanne du Bary réduit le libertinage à la liberté sexuelle et la cour de Louis XV à des fanfreluches, n’offrant qu’une pâle idée des enjeux humains et politiques à l’œuvre. Il se concentre sur l’ascension d’une femme de faible condition qui use de son corps pour gravir les échelons.
C’est clairement ce qui intéresse Maïwenn Le Besco, qui déclarait à TMC : « comme moi c’est une transfuge, comme moi, elle s’est sentie rejetée, et comme moi, elle serait prête à tout pour un bijou, un sac, tout ce qui brille ! » Avec Jeanne du Bary, elle ose, comme elle ose un contenu d’inspiration autobiographique dans Pardonnez-moi ou ADN. L’autobiographie n’est-elle pas l’arme des femmes à qui l’on conteste une existence, une façon d’avoir la chambre à soi que demandait Virginia Woolf ? Pourquoi cette actrice et réalisatrice franco-kabyle par sa mère est-elle soupçonnée d’autocélébration ? Est-ce seulement en raison de la superficialité et du classicisme du film ? Ou bien parce qu’insolente et irrévérente, Maïwenn dérange ? Elle est indocile, ce que Boniface Mongo-Mboussa donne pour caractéristique des littératures africaines. Elle a fait partie du collectif 50/50 mais s’est démarquée des positions d’Adèle Haenel. Ouvrir le festival par ce film sonnait comme une réponse aux attaques régulières sur le faible nombre de réalisatrices en sélection. Cannes revendique l’absence de parité, privilégiant la qualité des films, ce qui n’a pas empêché de voir cette année sept réalisatrices en compétition officielle sur 21, soit un tiers – une première : elles étaient cinq en 2022.
Il est vrai que le choix de Johnny Depp dans le rôle du roi renforce à la fois l’attrait du film et la confusion, celui-ci ayant été accusé de violences conjugales par son ex-épouse, l’actrice américaine Amber Heard. Le tribunal saisi pour diffamation a condamné son ex-épouse à lui payer dix millions de dollars tout en le condamnant à reverser 2 millions à l’actrice, en raison de paroles de son avocat. Cela n’a pas empêché une tribune dans Libération de 123 actrices et acteurs pour dénoncer les choix politiques du Festival de Cannes, accusé de « soutenir les agresseurs ».
L’excellent acteur qu’est Johnny Depp campe un roi frivole avec un certain humour. Il s’est réjoui du rôle, lui « le péquenaud du Kentucky », a-t-il signalé sur France info le 19 mai. Il n’est doté que de peu de dialogues, et se tire de son rôle en français avec fort peu d’accent. Cela favorise à la fois une crédibilité dans l’intensité mais participe aussi de la superficialité du film. C’est sans doute l’effet recherché puisque cet opus ne s’intéresse qu’à l’ascension de Jeanne du Bary comme courtisane favorite du roi.
Enfin, rappelons que l’agression physique le 22 février de Maïwenn envers le directeur de Médiapart, Edwy Plenel, est parfaitement inadmissible et s’inscrit dans une dévalorisation généralisée du métier de journaliste. Il a porté plainte le 7 mars, soit 5 semaines avant le festival, lequel ne recule donc devant rien pour occuper le devant des médias.
Six films africains en sélection officielle, trois réalisés par des femmes, dont deux en lice pour la Palme d’or : tout le monde a insisté sur cette nouvelle et féminine visibilité. La sélection de Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy en compétition officielle faisait espérer au Sénégal la même consécration que le Grand prix de Mati Diop avec Atlantique en 2019, d’autant plus qu’il s’agit d’un des premiers films africains à aborder directement la question du réchauffement climatique. Comme elle l’explique dans notre entretien, son projet était de faire de Banel un personnage mythique. Cela donne à la fois l’odyssée d’une femme complexe en quête d’autonomie dans un environnement villageois et une fable écologique, ce qui n’est pas léger à lier, d’autant que la fin se veut paroxystique. La barre était placée très haut, et à voir le peu d’enthousiasme de la critique, le pari est loin d’être gagné. Cela tient aux contradictions de son récit et à sa volonté d’asséner un message ambigu et rétrograde : à la différence d’Ada dans Atlantique, Banel choisit certes son chemin mais le film s’enferme dans une vision passéiste. « Nous étions maîtres du monde, libres. Que sommes-nous aujourd’hui ? » : c’est justement parce que les humains se sont crus les maîtres du monde qu’ils l’ont détruit, et s’il s’agit d’une liberté précoloniale, elle est parfaitement illusoire, tant les humains sont et furent de tous temps dominateurs et guerriers (cf. notre critique).
L’autre film d’Afrique en compétition officielle, Les Filles d’Olfa de la Tunisienne Kaouther Ben Hania est par contre une réussite, sans doute grâce à la transparence et l’audace du dispositif documentaire qu’elle adopte. Dès le départ, un clap annonçant un tournage. Olfa a quatre filles. Les deux aînées, Rahma et Ghofrane, ont disparu et sont donc jouées par des comédiennes, tandis que les deux plus jeunes, Eya et Tayssir, jouent leur propre rôle. Elle-même joue sa part mais est aussi doublée par la grande Hend Sabry lorsque le traumatisme ressort. Olfa lui indique comment jouer en fonction de ses souvenirs tandis que Hend l’interroge sur ses motivations. Car il s’agit de raconter pour Olfa comment ses deux aînées ont été captées par l’Etat islamique en Libye et comment toutes ont réagi. Le film se construit en réel sous nos yeux, dans une sorte de thérapie féminine introspective. Il vit de la circulation des paroles et des émotions, si bien que l’intime et le collectif se mêlent pour atteindre une lecture sociale de l’aliénation. Car Olfa restreignait rudement ses filles par crainte de leur émancipation sexuelle, et les battait plus qu’il n’en faut pour les « protéger », rendant ainsi possible leurs extrêmes réactions. Elle le rejoue dans d’impressionnantes agressions verbales, en écho à ses propres traumas face aux hommes que Majd Mastoura a pour charge d’incarner. C’est cependant dans leur complicité et leur sororité que, malgré les obstacles, la douleur est assumée et la haine sublimée, et que le film, enrichi de l’intensité de la musique d’Amine Bouhafa, atteint sa joyeuse vitalité. Absent du palmarès, Les Filles d’Olfa a cependant reçu une série de prix parallèles : prix de la Citoyenneté, Oeil d’or ex-aequo, prix du Cinéma positif.
 Comment ne pas relier cette exploration de l’ambivalence au beau La Mère de tous les mensonges (Kadib Abyad) de la Marocaine Asmae El Moudir, auréolé du prix de la mise en scène de la section Un certain regard, mais aussi du prix ex-aequo de l’Oeil d’or ? Ici aussi, un dispositif original qui s’avère riche de sens. Ici aussi, une mère, et une grand-mère terrorisante qui a imposé le silence et interdit les photographies, ne laissant que ce qu’elle ne pouvait restreindre : les souvenirs. En l’absence d’images, le père reconstruit le quartier de Casablanca et la famille en miniatures. Ce dispositif visuel couplé à la voix intime de la réalisatrice rebondit à travers des archives sur le drame que fut pour la famille la violente répression des émeutes de la faim de juin 1981 qui fit 600 morts. Un secret émerge peu à peu, une mémoire interdite se construit, à la fois personnelle, familiale et historique face au mur du silence.
Comment ne pas relier cette exploration de l’ambivalence au beau La Mère de tous les mensonges (Kadib Abyad) de la Marocaine Asmae El Moudir, auréolé du prix de la mise en scène de la section Un certain regard, mais aussi du prix ex-aequo de l’Oeil d’or ? Ici aussi, un dispositif original qui s’avère riche de sens. Ici aussi, une mère, et une grand-mère terrorisante qui a imposé le silence et interdit les photographies, ne laissant que ce qu’elle ne pouvait restreindre : les souvenirs. En l’absence d’images, le père reconstruit le quartier de Casablanca et la famille en miniatures. Ce dispositif visuel couplé à la voix intime de la réalisatrice rebondit à travers des archives sur le drame que fut pour la famille la violente répression des émeutes de la faim de juin 1981 qui fit 600 morts. Un secret émerge peu à peu, une mémoire interdite se construit, à la fois personnelle, familiale et historique face au mur du silence.
 Dans ces deux films, le récit est à la première personne, car le « je » a été bafoué. Pourtant, dans ces deux films, il ne s’agit pas de diaboliser les femmes de l’ancienne génération mais de comprendre ce qui les a amenées à de tels comportements. C’est ainsi que la grande Histoire se mêle à l’histoire familiale car c’est bien elle qui a fait le lit des violences et des préjugés. Et que pour exprimer l’intime, le documentaire se fait fiction.
Dans ces deux films, le récit est à la première personne, car le « je » a été bafoué. Pourtant, dans ces deux films, il ne s’agit pas de diaboliser les femmes de l’ancienne génération mais de comprendre ce qui les a amenées à de tels comportements. C’est ainsi que la grande Histoire se mêle à l’histoire familiale car c’est bien elle qui a fait le lit des violences et des préjugés. Et que pour exprimer l’intime, le documentaire se fait fiction.
 Dans ces deux films, le spectateur est, comme dans le théâtre épique de Brecht, confronté à un dispositif d’un film en train de se faire plutôt que plongé dans un récit. Cette artificialité construit la distance qui permet de penser et débattre car rien n’est asséné. Chaque comédienne peut remettre en cause son personnage pour en ouvrir les contradictions. Cette distanciation ne permet dès lors plus seulement de prendre la parole mais de faire en sorte que cette parole soit entendue et ressentie. D’où les libertés que les deux films prennent avec la temporalité dans de signifiants allers-retours.
Dans ces deux films, le spectateur est, comme dans le théâtre épique de Brecht, confronté à un dispositif d’un film en train de se faire plutôt que plongé dans un récit. Cette artificialité construit la distance qui permet de penser et débattre car rien n’est asséné. Chaque comédienne peut remettre en cause son personnage pour en ouvrir les contradictions. Cette distanciation ne permet dès lors plus seulement de prendre la parole mais de faire en sorte que cette parole soit entendue et ressentie. D’où les libertés que les deux films prennent avec la temporalité dans de signifiants allers-retours.
Dans ces deux films, le dispositif est polyphonique, l’irrationnel ou l’illogique sont bienvenus, les points de vue varient, les certitudes vacillent. Ces recherches formelles forgent un décalage qui recadre, une nouvelle esthétique documentaire apte à rendre compte d’un vécu complexe sans tomber dans les pièges du discours sûr de lui.
En démarrant en 2005 Goodbye Julia (Prix de la liberté à Un certain regard), Mohamed Kordofani choisit le moment où la mort dans un accident d’hélicoptère de John Garang, leader Sud-Soudanais également vice-président dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale, provoque des émeutes dans les rues de Khartoum où vivent près de deux millions de « Sudistes » (Noirs et chrétiens) exerçant des travaux subalternes. Cette histoire intime entre deux femmes sur la durée, l’une Noire et l’autre Arabe, prend sa source dans la division radicale du Soudan entre ces deux cultures, qui se concrétisera par une déferlante de votes pour la séparation au référendum de janvier 2011 : les préjugés et la méfiance conduisent au racisme et à la peur. Suite de mini-suspenses tenant en haleine, le scénario entremêle habilement le politique et l’humain tout en posant la question de la réconciliation que l’actuelle perpétuation de la violence rend malheureusement encore plus illusoire que dans ce film déjà largement pessimiste. L’image de Pierre de Villiers (L’Indomptable feu du printemps, Mthunzi) trouve les bons angles et les bonnes lumières et le film a été piloté par Amjad Abu Alala (Tu mourras à 20 ans). Il est au palmarès de la sélection Un certain regard avec le Prix de la Liberté.
Alors que son mari Akram trouve de bonnes raisons de ne pas se sentir responsable, Mona est dévorée par la culpabilité et agit mais s’enferme dans l’engrenage du mensonge. Ce tissu de contradictions la conduit paradoxalement vers l’autonomie, si bien que nous percevons combien il est aussi délicat pour une femme de prendre sa place que pour un pays de construire le vivre ensemble. Il manque pourtant à ce film la verdeur dont parlait Dora Bouchoucha dans sa passionnante masterclass à la Fabrique des cinémas du monde : l’histoire se déroule comme un fruit qu’on épluche, sans pas de côté, sans les failles qui font que la vie est là. Avec un récit linéaire et une forme classique, sans accrocs, ce genre de film coche toutes les cases qui font qu’il va marcher à l’international et recueillir les prix du public. Les mini-suspenses scotchent un moment, entrecoupés de détentes tendres ou poétiques pour ne pas plomber le film. Bref, il informe, intéresse, mais ne bouscule pas grand chose.
Il correspond en fait à ce que font souvent les hommes quand ils mettent généreusement en scène le courage des femmes : une approche plus sociale que sensible, une empathie renforcée par des hommes veules ou bornés, une description minutieuse des contradictions découlant des logiques de domination. On est loin des films évoqués plus haut où les femmes se coltinent leur part sombre et la complexité de leurs relations avec leurs mères, où leurs réactions ne sont pas naturelles et où la politique détermine intimement leur devenir.
Le choix des actrices n’est pas neutre : Mohamed Kornofani a sélectionné Miss Sud-Soudan 2014 pour le rôle de Julia (Siran Riyak), de même que la femme du fossoyeur était jouée par la top modèle canadienne Yasmin Warsame dans le film du Finnois né en Somalie Khadar Ayderus Ahmed (Semaine de la critique 2021). Il est clair qu’un casting est difficile dans des pays sans industrie du cinéma mais on n’échappe pas au critère de beauté qui réduit la femme à son corps.
Inchallah un fils du Jordanien Amjad Al Rasheed (Semaine de la critique) n’est pas en reste dans sa recherche d’efficacité scénaristique. Après la mort soudaine de son mari, Nawal doit se battre pour sa part d’héritage afin de sauver sa fille et sa maison. Tout changerait si elle avait un fils et l’on retrouve ici le coeur d’une histoire à même de dénoncer les logiques patriarcales autant que le piège tendu à une femme seule face à l’adversité. Le scénario est truffé de ficelles qui garantissent que le film pourra être compris et apprécié par un public international, ce type de clins d’oeil qu’affectionnent les laboratoires de développement qui ont fleuri un peu partout comme l’évoque Dora Bouchoucha dans sa masterclass. C’est par exemple le premier plan du film où Nawal tente de décrocher avec un balais un soutien-gorge tombé sur un câble électrique et s’arrête gênée car un passant s’en aperçoit. L’humour le dispute à l’évocation psychosociologique. La souris dans la cuisine remplira le même rôle ou la découverte des préservatifs. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des signes de reconnaissance universelle, que l’on retrouve dans la scène finale.
Loin de moi l’idée d’une malhonnêteté : il s’agit de conscientiser en démontant les infernales logiques à l’oeuvre. Mais tout y est calculé pour éliminer toute incertitude si bien qu’on a l’impression que ce scénario pourrait être transposé sans grande altération dans différentes régions du monde. Bien que venant d’une Jordanie où le cinéma est émergent, une logique est à l’oeuvre, qui sait ce qui plaît pour vendre. Le distributeur, Pyramide Films, a obtenu le Prix Fondation Gan à la Diffusion.
Ceci étant posé, ce type d’histoires reste porteur de ferments de remises en cause de l’ordre social. L’intime n’y est pas le seul horizon. Les conditions de travail y sont posées comme déterminantes, ce qui politise les questions féminines et rappelle l’intersection des oppressions des femmes : elles y sont employées par des femmes mieux placées dans l’échelle sociale. Quant aux artefacts de la domination patriarcale, ils procèdent de traditions obsolètes ou d’arguments religieux dont les hommes se saisissent pour arriver à leurs fins. Par leur lutte, leurs ruses et leur dignité, les femmes y sont des figures en qui s’identifier.
 Filles du feu, le superbe court métrage de 8 minutes du Portugais Pedro Costa – dont l’oeuvre est concentrée sur l’immigration cap-verdienne – était présenté en séance spéciale. Composé à partir d’essais pour son prochain long-métrage, l’écran divisé en triptyque a pour fond les laves incandescentes de l’éruption volcanique du Pico do Fogo en 1951. En surimpression sur ces couleurs flamboyantes, trois femmes vêtues de noir interrogent en chantant sur une musique symphonique leur fatigue et leur solitude, la répétition des souffrances vécues et le sens de la vie. « On oubliera nos visages » : le constat est terrible – qui annonce le projet cinématographique de leur donner vie à l’écran – comme ces archives montrées ensuite de la misère des paysans près de leur demeure à flanc de montagne dans les années 40.
Filles du feu, le superbe court métrage de 8 minutes du Portugais Pedro Costa – dont l’oeuvre est concentrée sur l’immigration cap-verdienne – était présenté en séance spéciale. Composé à partir d’essais pour son prochain long-métrage, l’écran divisé en triptyque a pour fond les laves incandescentes de l’éruption volcanique du Pico do Fogo en 1951. En surimpression sur ces couleurs flamboyantes, trois femmes vêtues de noir interrogent en chantant sur une musique symphonique leur fatigue et leur solitude, la répétition des souffrances vécues et le sens de la vie. « On oubliera nos visages » : le constat est terrible – qui annonce le projet cinématographique de leur donner vie à l’écran – comme ces archives montrées ensuite de la misère des paysans près de leur demeure à flanc de montagne dans les années 40.

Philippe Faucon, Hamedine Kane et Valérie Osouf encadrent Souleymane Cissé pour sa masterclass.
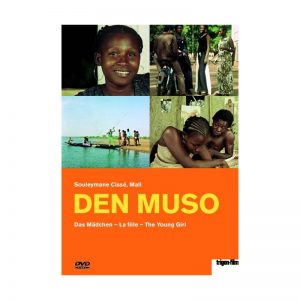 La remise du Carosse d’or attribué par la Quinzaine des cinéastes au Malien Souleymane Cissé était précédée d’une masterclass basée sur la projection de Den Muso (La jeune fille), son premier film sur une jeune muette « car dans les relations familiales, on ne s’adresse pas aux femmes », indiquait Cissé. La jeune fille, Ténin, est violée et ainsi engrossée par Sekou, puis confrontée à sa famille et à la lâcheté de Sekou qui refusera de reconnaître l’enfant. « La féodalité masculine est toujours vraie », ajoutait Cissé, « valable pour le Mali et tous les pays du monde ». De fait, il ne réduit pas son cinéma à l’origine : « Je fais des films non en tant que Noir mais en tant qu’être humain » alors que « le cinéma est un moyen très efficace de rapprochement entre les hommes ».
La remise du Carosse d’or attribué par la Quinzaine des cinéastes au Malien Souleymane Cissé était précédée d’une masterclass basée sur la projection de Den Muso (La jeune fille), son premier film sur une jeune muette « car dans les relations familiales, on ne s’adresse pas aux femmes », indiquait Cissé. La jeune fille, Ténin, est violée et ainsi engrossée par Sekou, puis confrontée à sa famille et à la lâcheté de Sekou qui refusera de reconnaître l’enfant. « La féodalité masculine est toujours vraie », ajoutait Cissé, « valable pour le Mali et tous les pays du monde ». De fait, il ne réduit pas son cinéma à l’origine : « Je fais des films non en tant que Noir mais en tant qu’être humain » alors que « le cinéma est un moyen très efficace de rapprochement entre les hommes ».
 La Quinzaine des cinéastes a également sélectionné Mambar Pierrette, de la Camerounaise Rosine Mbakam. A la différence de ses documentaires(Les Deux Visages d’une femme bamiléké, Chez Jolie Coiffure, Les Prières de Delphine) mais avec le même désir de donner la parole à la personne filmée, Rosine Mbakam construit son film comme une fiction. Comme elle l’explique dans notre entretien, elle a reconstitué des scènes que les protagonistes ont jouées comme dans la réalité. Son esthétique n’est cependant pas fixée d’avance mais découle du comportement de chacun. Tout tourne autour de l’exigu atelier de couture de Pierrette Aboheu qui se démène avec ses difficultés pour élever ses enfants alors qu’on lui vole son argent ou qu’elle est inondée. La verve des échanges autant que la solidarité innervant les relations rendent passionnant autant qu’émouvant ce film de proximité (Pierrette est la cousine de Rosine et une bonne partie des personnes filmées font partie de sa famille). La personnalité de Pierrette, aussi battante que lucide, est magnifiée par la sincérité de la démarche de Rosine si bien que ce film tourné dans des situations dramatiques respire l’humour et la beauté.
La Quinzaine des cinéastes a également sélectionné Mambar Pierrette, de la Camerounaise Rosine Mbakam. A la différence de ses documentaires(Les Deux Visages d’une femme bamiléké, Chez Jolie Coiffure, Les Prières de Delphine) mais avec le même désir de donner la parole à la personne filmée, Rosine Mbakam construit son film comme une fiction. Comme elle l’explique dans notre entretien, elle a reconstitué des scènes que les protagonistes ont jouées comme dans la réalité. Son esthétique n’est cependant pas fixée d’avance mais découle du comportement de chacun. Tout tourne autour de l’exigu atelier de couture de Pierrette Aboheu qui se démène avec ses difficultés pour élever ses enfants alors qu’on lui vole son argent ou qu’elle est inondée. La verve des échanges autant que la solidarité innervant les relations rendent passionnant autant qu’émouvant ce film de proximité (Pierrette est la cousine de Rosine et une bonne partie des personnes filmées font partie de sa famille). La personnalité de Pierrette, aussi battante que lucide, est magnifiée par la sincérité de la démarche de Rosine si bien que ce film tourné dans des situations dramatiques respire l’humour et la beauté.
Pierrette n’a pas seulement du coeur, elle est sagace. Nous percevons à travers elle toute la complexité sociale d’un quartier, de cette constellation de nécessités et de survies, mais aussi combien la précarité économique a fragilisé les hommes et encouragé les femmes à gagner en autonomie. A travers le mannequin blanc qui regarde et se revêt de différents rôles, s’impose aussi la colonialité comme une donnée toujours présente, qui se marie aux affres de la politique pour perpétuer les obstacles.
 Si Mambar Pierrette fait ainsi surgir les questions politiques sans les nommer, on retrouve dans Machtat de la Tunisienne Sonia Ben Slama (section ACID) la démarche documentaire d’une intimité basée sur le partage au quotidien des aléas de la vie, permis ici par le choix du cinéma direct et d’une caméra participante d’inspiration rouchienne . On découvrait les Machtat, ces chanteuses musiciennes qui animent les fêtes de mariages traditionnels dans la région de Mahdia, port de pêche situé entre Sousse et Sfax, à la fin de Tout est écrit, le premier film de Sonia Ben Slama. Leurs incantations invoquent les poissons pour contrer le mauvais oeil. L’enjeu est ici de permettre à chacune de ces femmes très soudées d’exister dans sa complexité : Fatma, la mère, et ses deux filles – Najeh, mère divorcée qui pour échapper à ses frères désespère de se remarier avec un homme connu sur un site de rencontre et qui tout le temps se dérobe, et Waffeh, qui quitte avec ses enfants son mari violent pour se réfugier chez sa soeur.
Si Mambar Pierrette fait ainsi surgir les questions politiques sans les nommer, on retrouve dans Machtat de la Tunisienne Sonia Ben Slama (section ACID) la démarche documentaire d’une intimité basée sur le partage au quotidien des aléas de la vie, permis ici par le choix du cinéma direct et d’une caméra participante d’inspiration rouchienne . On découvrait les Machtat, ces chanteuses musiciennes qui animent les fêtes de mariages traditionnels dans la région de Mahdia, port de pêche situé entre Sousse et Sfax, à la fin de Tout est écrit, le premier film de Sonia Ben Slama. Leurs incantations invoquent les poissons pour contrer le mauvais oeil. L’enjeu est ici de permettre à chacune de ces femmes très soudées d’exister dans sa complexité : Fatma, la mère, et ses deux filles – Najeh, mère divorcée qui pour échapper à ses frères désespère de se remarier avec un homme connu sur un site de rencontre et qui tout le temps se dérobe, et Waffeh, qui quitte avec ses enfants son mari violent pour se réfugier chez sa soeur.
Leurs chansons parlent d’amour mais dans leur vie, c’est la désillusion. Les hommes sont absents de l’écran mais omniprésents dans les conversations et les romances vues à la télé. En dehors du mariage, pas de salut… Sonia Ben Slama se garde bien de porter un jugement. Si la réalisatrice n’envahit pas l’écran, sa présence est sensible car le film est construit sur la rencontre. De la salle de mariage à l’étroit appartement, la caméra n’observe pas : elle partage. Elle est souvent incertaine ou décadrée mais qu’importe : elle participe. Elle n’occupe pas le terrain, elle cherche sa place, elle prend part.
C’est ainsi que se construit pour nous la voie royale d’une relation. Il était frappant de voir à Cannes que toute l’équipe est féminine. Ce film de femmes sur les femmes est bâti sur la proximité et le contact. Il prend le temps de l’écoute et capte ainsi la complexité du sensible. La transe finale de Najeh débouche sur l’épuisement : rien n’est simple, tout est toujours à recommencer.
Mona Achache, réalisatrice et scénariste franco-marocaine, est née en 1981. Sa mère, Carole Achache, écrivaine et photographe de plateau, s’est suicidée en 2016. Elle a notamment écrit Fille de, un livre sur sa propre mère, Monique Lange, elle aussi écrivaine, qui travaillant chez Gallimard a côtoyé le milieu littéraire de l’après-guerre : Albert Camus, Marguerite Duras, Jorge Semprun et surtout Jean Genet. « Ma mère m’a laissé une énigme, l’histoire de notre relation », écrivait Carole Achache. Mona suit la même démarche : partant des boites de photos et lettres qui rassemblent la vie de sa mère, elle réalise Little Girl Blue (séance spéciale), du nom d’un standard des années 30 notamment repris par Nina Simone et Janis Joplin. Ces documents et des extraits de radio, des lectures, etc. ressuscitent magnifiquement cette mère qui sera incarnée par la grande actrice qu’est Marion Cotillard. Sa transformation en Carole Achache est un des grands moments du film, lequel fourmille de surprises et d’idées, dans un rapport brûlant avec la mosaïque d’affects et de douleurs qu’il révèle peu à peu.
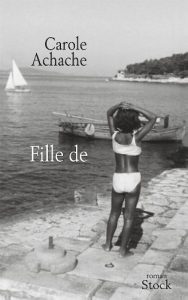 Car ici aussi, être une femme est dangereux, à la merci des ogres. « On n’écrit pas sur le bonheur », dit Marguerite Duras. « Me dire la vérité, c’est déclarer ses failles », écrit Carole. Là est le programme du film, à la recherche de l’énigme de cette vie que les excès et les soumissions mèneront au désespoir. Car une fille se demande, comme sa mère avant elle, ce que celle-ci lui transmet, en dehors des agressions subies en cascades, de génération en génération. Il fallait pour cela un film et celui-ci est marquant.
Car ici aussi, être une femme est dangereux, à la merci des ogres. « On n’écrit pas sur le bonheur », dit Marguerite Duras. « Me dire la vérité, c’est déclarer ses failles », écrit Carole. Là est le programme du film, à la recherche de l’énigme de cette vie que les excès et les soumissions mèneront au désespoir. Car une fille se demande, comme sa mère avant elle, ce que celle-ci lui transmet, en dehors des agressions subies en cascades, de génération en génération. Il fallait pour cela un film et celui-ci est marquant.
« Je rêve d’un monde où plus personne n’aura honte d’avouer ce qu’il est ou ce qu’il a été », écrivait encore Carole Achache. Ce sera notre conclusion.









