La fin de Mame Baby est le premier roman de la dramaturge Gaël Octavia. Sorti le 31 août chez Gallimard, ce livre nous plonge dans la vie d’un groupe de femmes vivant dans un quartier périphérique de Paris. Mystérieux, profond, intriguant et tenant les lecteurs dans une constante et légère tension, l’ouvrage dont fait l’objet cet entretien vise à mettre en valeur l’amitié féminine et les stratégies de survie dans un contexte patriarcal. Gaël Octavia nous a éclairés à ce propos.
Africultures. La fin de Mame Baby est un roman avec principalement des personnages féminins. On y retrouve le mythe de la femme forte, qui supporte tout, qui est debout, dans l’oubli d’elle-même, pour ses enfants… C’est la même femme qui n’aime pas celles qui pleurent sur leur sort, qui se montrent faibles. Pourquoi avoir campé cette figure de femme, dont une des protagonistes, Mariette, est le contre-exemple ?
Gaël Octavia. Cette figure est très forte en Martinique, d’où je viens. Le poto-mitan, c’est-à-dire, la femme comme pilier du foyer, y est survalorisé et vénéré. La Martinique est une société patriarcale mais matrifocale, dans le sens où beaucoup de femmes élèvent seules leurs enfants. Parfois ce sont des enfants de pères différents, souvent absents. Ça m’a toujours fascinée, même si ce n’est absolument pas mon vécu. Mais j’en ai vues des femmes, qui justement n’étaient pas des poto-mitan ! Et je pense que très tôt, j’ai été profondément énervée par la glorification de la femme poto-mitan, surtout par les hommes. Il y a toujours ce cliché du chanteur, qui va parler de sa maman, qui l’a élevé, qui a tout sacrifié pour lui et ses frères – « tu étais tellement super, maman je t’aime ». Il a vu la souffrance de cette mère qui est aussi une femme, et que fait-il dans sa vie ? La même chose que son père ! Persiste cette idée que les femmes savent tout faire et qu’elles se débrouillent très bien toutes seules, qu’il ne faut surtout pas assumer son rôle de père. Le poto-mitan c’est ça : une femme qui assume tout; le père des enfants peut s’en aller, elle va s’en sortir toute seule, elle va se démerder, élever ses enfants. Et les aimer. Or, moi ce que j’ai vu toute ma vie, ce sont des femmes, qui, parce qu’elles étaient maltraitées par des hommes, étaient extrêmement maltraitantes avec leurs enfants. Elles n’étaient pas du tout poto-mitan. J’ai vu des femmes qui s’effondraient. Le dicton martiniquais dit : « la femme c’est une châtaigne, l’homme est un fruit à pain ». Le fruit à pain quand il tombe de l’arbre il s’écrase. Alors que la châtaigne repousse. On nous élève avec ce genre de conneries ! Ce n’est pas vrai que la femme va rebondir. Il y en a oui, mais il y en a plein qui s’effondrent. Et ne se relèvent pas, font des dépressions, se suicident.
Avec le personnage de Mariette, je voulais raconter l’histoire d’une anti poto-mitan. Son mari l’a quittée, elle n’a pas assumé son départ. Son fils est devenu une terreur et elle n’a pas su gérer, alors on l’a stigmatisée. Bien sûr c’est valorisant pour les femmes de se dire « on est fortes ». Et en tant que féministe c’est bien de le dire. Mais ça peut être un piège. Et au départ ce roman s’appelait « Stabat mater », « la mère debout ». Il était vraiment un clin d’œil au poto-mitan. Et l’histoire que je raconte est celle d’un contre-exemple justement. Mais ce titre était déjà pris par pas mal d’œuvres. Ce que je voulais mettre en lumière est qu’au-delà des poto-mitan il y a des Mariette, et des paquets !
Dans le rapport de votre personnage de Mariette aux hommes, c’est clairement elle qui paie en termes de prise en charge psychologique et émotionnelle. Qu’il s’agisse de la fin de l’histoire avec son premier amour, du départ de son mari ou de la mort de son fils. Malgré tout cela, elle refuse la main qui lui est tendue si c’est celle d’une femme. Est-ce qu’il y a un lien avec le trauma originel avec sa propre mère ?
Pour moi Mariette n’est pas féministe. Ce n’est pas quelqu’un qui est dans une prise en charge active de sa vie, comme les autres personnages de Mame Baby peuvent l’être d’une certaine façon. Quelque part Suzanne pourrait sembler sur la même pente que Mariette concernant la fascination vis-à-vis des hommes, sa dépendance à leurs égards, mais après ça a changé… Il a fallu le choc salutaire de la mort de son homme, pour qu’elle essaie de faire autre chose de sa vie. C’est un peu bizarre, un peu brumeux : on n’est pas sûr qu’elle y arrive bien et que tout ce qu’elle raconte soit vrai, mais elle est dans une forme de reprise en main de sa vie, ce que Mariette n’a jamais fait. Tout en reconnaissant que c’est une erreur pour les femmes de se reposer à ce point sur les hommes, Mariette en effet n’arrive pas à faire autrement. C’est trop fortement constitué en elle. Je pense que ça ne vient pas que de sa relation à sa mère, mais ça trouve aussi son origine dans sa relation à son frère, qui a été une figure très écrasante. Evidemment elle reproduit la même chose : elle survalorise son fils, comme sa mère a survalorisé son frère. Elle le fait faute d’explorer d’autres possibilités… Quelque part elle ne remet pas tellement en question les règles de la société patriarcale. Elle s’en est libérée pendant sa jeunesse, elle est tombée amoureuse d’un garçon qui n’était pas de sa communauté, elle l’a payé assez cher. Après elle a fait ce qu’on attendait d’elle, c’est-à-dire prendre un homme de la communauté, en se disant « Je suis les règles », mais même en suivant les règles, ça n’a pas marché. Elle n’a pas cette idée qu’il faut tout simplement réinventer d’autres règles, se réinventer. Elle a du mal à faire ça.
Tout le roman se passe « au quartier », dans une périphérie de Paris. On lit : « On a tenté d’inventer de nouvelles règles de vie. Mais quelque chose d’ancien demeurait. L’impression d’une menace en haut, en bas et tout autour. On s’est aidé des religions, des maximes connues, des légendes et des chants ». Quelle est cette violence sourde mentionnée à propos du « quartier » ?
C’est difficile à exprimer de manière réaliste. Justement dans le roman je choisi de le dire de manière un petit peu poétique, ou en tout cas avec une certaine distance… Ce passage me vient du fait que quand on parle « des quartiers difficiles », on décrit les gens qui y vivent comme s’ils étaient à part, des sauvages, des gens foncièrement violents et qui ne sont pas comme « nous » – celles et ceux qui ne viennent pas de ces endroits-là. Le discours extérieur, même quand il essaie d’être bienveillant, véhicule tout de même l’idée qu’on parle de gens « autres ». Alors que ces gens-là n’ont pas toujours choisi de vivre là : ils y naissent et cette violence est là. Ils ne sont pas plus violents que vous et moi, mais ils sont plongés, dès le départ, dans un univers. Ce n’est pas très juste de rendre tous les habitants d’un quartier dit « difficile » responsables de l’endroit où ils sont, car souvent ils le subissent.
Moi j’ai grandi dans un quartier populaire « gentil » en Martinique. Je dirais semi-populaire : un mélange de classe populaire et de classe moyenne. Dans la dénomination de ce quartier il y a « cité ». Et quand je remplissais mes dossiers pour faire une classe préparatoire à Paris, une voisine m’avait dit de ne jamais mettre « cité » dans les adresses pour le courrier retour. Parce que pour les gens « cité » c’est une catastrophe, ça fait de toi un individu complètement « autre », un alien.
Toujours par rapport au quartier : il y a certaines règles. Par exemple le fait d’être contre l’exogamie. Il y a aussi de l’hostilité pour les femmes qui sont larmoyantes vis-à-vis de leur propre sort, et une méfiance vis-à-vis de qui est considéré individualiste. En voyant comme tout cela influence la vie des protagonistes, est-il possible d’abandonner réellement le quartier en le quittant physiquement?
Je pense que de manière générale, pour les gens qui arrivent à s’extraire d’un milieu quel qu’il soit, même bourgeois, c’est difficile de décider d’être autre chose. Oui je pense qu’on est rappelé par ses origines. Que ce soit sa famille ou son milieu proche. Et je pense que c’est encore plus difficile pour les femmes. Il y a cette idée que les femmes appartiennent quelque part, beaucoup plus, à leur communauté. La société exerce de manière générale un contrôle sur les gens, et davantage sur les femmes.
Mame Baby part du quartier pour étudier à Paris. Mais elle revient dans le quartier pour dispenser son savoir…
Chez elle c’est volontaire. Quelque part Mame baby aurait pu s’en aller, et ne plus remettre les pieds dans le quartier, puisqu’on estime qu’elle a vécu une forme d’ascension sociale, de réussite. Elle a échappé à la fatalité de l’échec, de la pauvreté ou de choses comme ça. Mais elle se sent une responsabilité, et je pense que ça aussi c’est quelque chose qui est très fort quand on vient d’un milieu ouvrier ou d’un milieu plus au moins défavorisé. Ça se voit d’ailleurs dans toute sorte de rapport au milieu d’origine. Les immigrés qui viennent en Occident travailler, qui envoient des parts incroyables de leur salaire à leur village ou à leur communauté d’origine… Les gens qui ne vivent pas ça ne seraient pas prêts à donner à leur famille un tel pourcentage de ce qu’ils gagnent. Donc je pense qu’il y a quelque chose de très fort dans l’attachement qu’on peut avoir à son milieu, surtout quand celui-ci est si fragile.
Pourtant dans votre roman, à l’image de Mariette, il y a une sorte de méconnaissance de la part des personnes des quartiers vis-à-vis de celles qui reviennent des années plus tard…
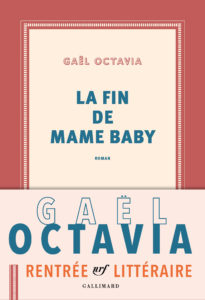
Je pense que l’oubli est toujours une forme de choix. Après, c’est au lecteur de décider si l’amnésie de Mariette est volontaire ou feinte. C’est comme quand on croise sur le trottoir quelqu’un avec qui on n’a pas envie de parler ou avec qui on s’est un peu brouillé. On espère que la personne ne va pas nous voir. Si on se reconnait on est obligé de se dire bonjour et éventuellement être un peu hypocrites, donc on croise les doigts pour que la personne ne lève pas la tête de ses chaussures, et sans doute la personne en face nous a vu aussi et s’est dit exactement la même chose. Donc moi je pense que ce genre d’oubli est toujours plus ou moins volontaire.
Les relations, quand elles échouent, on peut soit couper les ponts, soit les réinventer. Beaucoup de gens essaient de faire des mises au point sur le passé, de le décortiquer, de rejouer les passages où ça n’a pas marché, se faire des excuses etc. Je pense que ça ne marche pas. A un moment il faut savoir passer l’éponge, oublier. Chacun a sa vision de la chose passée et il faut juste l’admettre et accepter de réinventer la relation différemment.
Par exemple Suzanne et Mariette sont l’emblème de ça : elles ont été ennemies, rivales, et puis à un moment donné, il n’est pas question pour Suzanne d’arriver avec des récriminations, des envies de pardon. Elle accepte d’être autre, mais ce n’est pas elle qui le choisit, c’est Mariette qui ne la reconnait pas. Au départ Suzanne lui dit « c’est moi Suzanne », mais ça ne sert à rien. Donc elle accepte que leur relation se transforme. Qu’elles soient désormais amies. Elle va mettre ce déguisement d’infirmière, va être celle qui va soigner et s’occuper de Mariette.
Dans les relations, parfois, il faut endosser d’autres rôles, oublier le vieux rapport et construire quelque chose de nouveau. Surtout avec les gens qui nous sont très proches, où la nature de la relation est soi-disant pré-déterminée. Dans la relation mère/ fille, parfois il faut accepter d’être la mère de sa mère. De se dire : « Ok, comme mère elle a raté, elle a foiré, sans doute elle ne sait pas faire ça, elle ne saura jamais, ce n’est pas la peine de lui remettre ça sur le tapis, on va être autre chose, peut-être des copines, ou peut-être c’est moi qui vais être sa mère ».
Est-ce que cela fait référence à vos propres expériences ?
J’ai vécu quelque chose de semblable avec ma sœur, je l’ai raconté dans une nouvelle. Je pense, d’ailleurs, que cette fascination que j’ai pour les amitiés féminines me vient de ma sœur. Nous avons deux ans et demi de différence, je suis l’aînée. Je n’ai jamais vraiment écrit sur des sœurs, mais je traite l’idée du double grâce auquel on se construit, du double qui est aussi un miroir déformant, opposé. Avec ma soeur, on s’est chamaillées pendant vingt ans, on s’est tapées dessus, griffées, ça a été très violent… Et puis du jour au lendemain, on s’est adorées. Je peux, aujourd’hui, passer des jours et des jours avec elle, sans que nous nous engueulions. Nous avons réinventé la relation. Moi j’ai accepté qu’elle soit la grande sœur. La chronologie voulait que ça soit moi, mais je pense que j’ai été une très mauvaise grande sœur, et le jour où j’ai accepté que c’était elle, ça a marché entre nous.
Que représente pour vous Mame Baby, la seule qui voit des libellules sur le visage de Mariette ?
C’est ça aussi le mystère de l’amitié. Parfois des gens sont liés, sans qu’on comprenne vraiment pourquoi tellement ils sont différents ils sont différentes. Par exemple pourquoi Elena, dans le roman L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante, est folle de Nino ? C’est ça : Elena voit des libellules d’or sur Nino que nous ne voyons pas, manifestement ! Il s’agit du mystère de l’attachement et de l’amour qu’on a pour quelqu’un. Du fait qu’une personne est absolument unique pour nous, elle nous fait un bien fou, et on ne sait pas pourquoi.
Et dans ce cas c’est Mame Baby qui ressent les bienfaits de Mariette sur elle ?
C’est vrai que dans leur relation, finalement, Mame Baby est un peu parfaite, il y a rien à dire sur elle, on ne l’imagine pas se mettre en colère ou faire un caprice, alors que Mariette on sent que c’est quelqu’un qui a pu être, par moments, difficile. En tout cas c’est facile de comprendre pourquoi Mariette trouve formidable Mame Baby, et c’est peut-être plus difficile de comprendre pourquoi Mame Baby trouve Mariette formidable. En fait c’est ce mystère qui fait que Mariette est si précieuse pour Mame Baby, au-delà de quelque chose d’humain.
Que voulez-vous dire à propos des choix de prénoms des personnages de votre roman ?
Mariette c’est un prénom un peu désuet. Mame Baby c’est plutôt africain, Peul pour la précision. Mame Baby c’est l’éternelle enfant. L’enfant prodige. Certaines personnes lisent baby à l’anglaise… Ça a l’avantage aussi d’être assez androgyne. Mame peut être féminin comme masculin, et le personnage aussi a quelque chose de presque asexué. Et Mame, dit rapidement, peut être aussi maman. Certaines personnes m’ont reproché le fait de n’avoir pas décidé si Mariette et Aline sont africaines, antillaises, que je n’aie pas marqué les origines de façon claire.
C’est peut-être comme dans le théâtre, où on pose certaines informations et c’est au metteur en scène, voire aux spectateurs, d’en décider ?
Moi j’aime bien en tant que lectrice, quand un auteur me laisse des choix. Ça m’arrive de lire des romans que j’aime et puis de me dire que c’est trop expliqué, trop appuyé… J’ai lu il n’y a pas longtemps un excellent roman, qui a eu plein de prix, et ça m’a profondément agacée que l’auteur explique tout, détaille tout… s’il vous parle de la table, à la fin de sa description on sera ébénistes ! Si on me dit « un homme élégant est rentré dans la pièce », ça me va, je n’ai pas besoin qu’on me dise qu’il avait une veste bleu marine, une cravate Armani. Laissez-moi décider ce qu’est un homme élégant. Toutes les infos que l’auteur ne me donne pas, je les crée. J’aime beaucoup ça. J’aime donc prendre et laisser cette liberté. Si on décide que Mariette est une belle femme, chacun pourra l’imaginer avec ses propres critères de ce qu’est une belle femme.
Vous avez porté une certaine attention aux descriptions sur le décor, les gestes des personnages, certaines détails poétiques comme les mouchoirs qui deviennent des camélias… Avez- vous écrit ce roman en pensant l’adapter pour une pièce de théâtre ?
Non, pour moi ce n’est qu’un roman. Au départ ça devait être une pièce de théâtre. Un monologue. Une comédienne m’avait demandé de lui écrire un texte et finalement la collaboration ne s’est pas faite. Et je n’avais pas envie d’abandonner ce personnage. A partir du moment où j’ai décidé d’en faire un roman, ça l’est devenu. J’ai dû garder seulement quelques phrases, très peu, du texte de théâtre. J’ai lu une ou deux critiques qui disaient que c’était un roman écrit de manière théâtrale. Je n’en ai pas du tout l’impression. Mon écriture romanesque est antérieure à mon écriture théâtrale. Mon seul critère quand j’écris un roman est de créer quelque chose que j’aimerais lire si je n’en étais pas l’auteure.
Dans votre roman il y a certaines phrases marquantes qui reviennent : « Nommer c’est aimer », « Le droit à attraper un peu d’autre chose », « Une de ces femmes qui ne se remettent pas d’un divorce ». S’agit-il d’une façon de parsemer le roman de symboles ?
Je pense que c’est un roman dans lequel il y a des symboles. Ces phrases-là par contre sont plus des choses que les personnages se transmettent. Comme des passages de témoins. La citation à propos des femmes qui ne se remettent pas d’un divorce, c’est ce que l’assemblée des femmes dit de Mariette et qu’Aline, la voix off, récupère en le questionnant pour dire qu’il y a plein de femmes dans la même condition qu’elle. Vu que mes personnages sont beaucoup liées les unes les autres par la parole –ce sont des femmes qui parlent l’une de l’autre par la plupart – il s’agit d’une forme de transmission.









