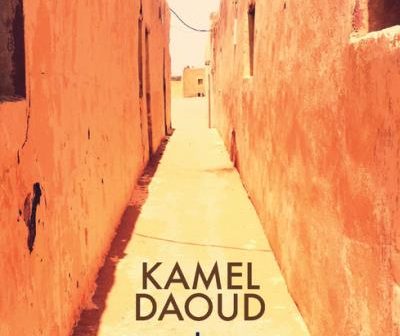Avec son second roman, Zabor ou Les psaumes (Actes Sud), l’écrivain algérien Kamel Daoud livre une fable puissante sur le pouvoir rédempteur du récit.
Le deuxième roman est un exercice délicat. Il l’est d’autant plus si l’auteur, tout jeune romancier qu’il soit, est déjà une figure publique. Parce que son Meursault, contre-enquête avait été encensé, et parce que ses chroniques et prises de positions, regroupées pour certaines dans le recueil Mes indépendances, ont souvent fait l’objet de polémiques virulentes, le deuxième roman de Kamel Daoud, Zabor ou Les psaumes, était attendu par ses adeptes comme par ses détracteurs.
Il devrait enchanter les premiers et décevoir les seconds. Comme dans Meursault, et peut-être même plus encore, Kamel Daoud fait, avec Zabor, œuvre de conteur. Ses romans ne sont pas le travail d’un éditorialiste qui verrait dans la fiction un medium alternatif pour développer ses thèses, mais celui d’un authentique écrivain. À la chronique de l’époque, se substitue une ambition à la fois plus intime et plus universelle. Politique et sociologie sont délaissées au profit d’une question qu’elles dépassent largement – la vie d’un homme – et d’une autre qui les dépasse – le pouvoir émancipateur de la langue, des mots et du récit.
Après une variation sur L’Étranger d’Albert Camus, Kamel Daoud s’attaque ici aux Mille et Une Nuits, dont il garde le postulat central : le récit raconté est la seule arme viable contre la mort. Alors que Shéhérazade repoussait son exécution en tenant en haleine le sultan par des contes, Zabor éloigne le décès des habitants de son village en écrivant leurs histoires dans des cahiers. Appelé au chevet des agonisants, il noircit des pages entières à leurs côtés, conduisant souvent la mort à passer son chemin. Aboukir est peuplée de centenaires qui doivent leur longévité aux gribouillages indéchiffrables d’un orphelin solitaire.
Mais le jour où vient à s’écrouler le père qui l’a abandonné, Zabor est soudain confronté à la faillibilité de son don. Dans sa lutte contre l’agonie du patriarche, il tente de remonter le cours du temps et de sa propre histoire, biographie qui se décline comme la découverte progressive de l’épaisseur du monde à travers l’appropriation des langues et des mots.
Il y a d’abord l’idiome du village et de sa tante Hadjer, celui qui sert à nommer le quotidien mais dont l’alphabet qu’il apprend à l’école n’offre pas de transcription. Il y a ensuite l’arabe du Livre Sacré, qu’il lit de droite à gauche, en classe puis chez les récitateurs, dont il entreprend de suivre l’enseignement. Dans un dernier temps, vient le français de vieux romans oubliés dans les caves, langue profane déchiffrée à tâtons et minutieusement reconstituée, jusqu’à la découverte fondamentale de la possibilité de la métaphore et de l’écriture. De ce savoir découle pour Zabor une urgence et une nécessité, celles de consigner les existences des villageois pour les arracher à l’oubli.
Le récit de l’initiation de Zabor se déploie dans une mélancolie profonde. Pour l’extase d’une phrase à la portée universelle, combien de sentiments incommunicables, de vérités dissimulées et de rancœurs non dites ? La solitude est lourde pour le narrateur, qui pressent que les mots ne se substituent pas totalement aux corps, et l’écrivain décrit son monde avec une lucidité qui confine au cruel. Mais l’ouvrage n’en reste pas moins une profession de foi dans la littérature, et le lecteur conclue avec le narrateur : « le salut est dans le conte ; la noce finale est un livre ; le livre sauve le palais, le roi et la conteuse ».