Outre une réflexion sur les marronnages, le reportage de Dénètem Touam Bona donne à voir une Guyane méconnue et souvent méprisée, la Guyane des Marrons Businenge (les « Africains de Guyane », pour reprendre l’expression de l’ethnologue Hurault). Il aborde en outre dans la 3ème partie, la question de la maltraitance scolaire (dont il a été témoin en tant qu’enseignant sur le Maroni) et celle de la « couleur ».
» Les Antillais éprouvent de la crainte et de la honte pour leur passé. Ils ont entendu parler de Christophe et de Louverture en Haïti et des Marrons de la Jamaïque ; mais ils pensent qu’ailleurs l’esclavage était une condition établie, acceptée passivement pendant plus de deux siècles. Peu de gens savent qu’au XVIIIe siècle les révoltes d’esclaves aux Caraïbes étaient aussi fréquentes et violentes que les ouragans, et que beaucoup ne furent vaincus que grâce à la trahison d’esclaves » fidèles » (1)
Il aura Fallu aux Ndyuka et Saramaka, des groupes d’Africains déportés, près d’un siècle de guérilla contre les troupes esclavagistes pour arracher définitivement leur liberté aux planteurs de Guyane hollandaise (actuel Surinam). En 1760, face à la menace d’un embrasement général de la colonie, les Hollandais furent contraints en effet de ratifier des traités de paix avec les » Nègres marrons » (esclaves rebelles). Ces accords officiels consacraient l’indépendance des territoires Ndyuka et Saramaka : de vastes étendues de forêt amazonienne, sillonnées de fleuves et de cours d’eau.
Quelques années plus tard, vers 1768, une nouvelle guerre de libération, plus radicale que les précédentes, fut lancée par un autre groupe de Nègres marrons, les rebelles de la Cottica : leur chef, Boni (qui donna son nom à son peuple), était décidé non seulement à obtenir l’indépendance mais aussi à chasser du Surinam le » Maître Blanc « . Cette fois-ci, la Hollande mit sur pied un véritable corps expéditionnaire qui, par sa supériorité numérique et son armement, l’emporta : les Boni se replièrent sur les rives françaises des fleuves Maroni, Sparouine et Lawa.
Depuis lors le destin des Boni est intimement lié à celui de la Guyane française où, au fil du temps, d’autres groupes de Marrons les ont rejoints (2). Aluku (nom que préfèrent se donner les Boni), Paramaka, Ndyuka et Saramaka représentent aujourd’hui plus de 20 % de la population guyanaise. Pourtant il existe très peu d’ouvrages, en France, relatant leur existence et leur histoire. Rien de surprenant à cela : la plupart des livres traitant de l’esclavage présentent en effet le marronnage comme un phénomène secondaire. Le mythe de l’esclave docile, le mythe du philanthrope européen libérant les Noirs reste tenace
Parce que je voyais dans cette méconnaissance du marronnage une nouvelle injustice commise à l’égard des Africains déportés et de leurs descendants, je décidai de partir quelques temps en Guyane, sur le fleuve Maroni, dans l’espoir d’en apprendre un peu plus sur l’histoire occultée des » Nègres rebelles « .
Le » marron » n’est pas une couleur
D’une certaine façon, mon séjour en Guyane débuta à Montreuil, dans les locaux de la Parole errante (3), un soir de printemps où des amis me firent visionner les rushes d’un entretien qu’ils venaient de réaliser avec Daniel Maximin (4). Dans cet entretien, répondant à des questions de lycéens, l’écrivain guadeloupéen exposait les différentes formes de résistance à l’esclavage que connurent la Caraïbe et les Amériques : les sabotages, les » suicides » (un retour au pays des ancêtres), les empoisonnements, les révoltes, les créations culturelles (le créole, la capoeïra, le blues, la santeria
). Quand il en vint au marronnage, au phénomène général de la fuite des esclaves, il en décrivit les deux formes majeures : le » petit marronnage » et le » grand marronnage « . Le premier était surtout le fait de » Nègres créoles » (nés sur place) fuguant soit pour des motifs immédiats (retrouver dans une autre plantation ses parents, sa bien aimée
) soit pour échapper définitivement à leur servitude en se mêlant aux esclaves affranchis des villes. Le second, fruit d’une action collective au sein d’un atelier voire d’une plantation entière, était avant tout le fait de » Nègres bossales » (Africains fraîchement débarqués) dont les meneurs étaient souvent d’anciens chefs politiques ou religieux. Seuls les grands marronnages ont laissé des traces durables car ils donnèrent naissance à de véritables sociétés marronnes : Quilombos du Brésil, Palenques et Cumbes de l’Amérique hispanique, Businenge des Guyanes, Maroons de Jamaïque.
Certes, j’avais déjà entendu parler des » Nègres marrons « , mais je ne me les représentais que comme de pauvres fugitifs contraints au maraudage, vivant au jour le jour, dans la hantise des » chasseurs de Nègres « . Jamais je ne me serais douté qu’ils avaient pu former, en certains lieux, en certains temps, d’importantes et durables communautés. La première recherche que j’entrepris sur leur compte concerna l’origine et le sens de leur dénomination. » Marron » n’a bien sûr rien avoir avec la couleur, ce mot vient de l’espagnol cimarron, un terme dont la racine est Taïno (peuple amérindien exterminé). A l’origine, dans l’île de Saint-Domingue, il était employé pour désigner les animaux domestiques fugitifs. Dès 1540, l’usage du terme » marron » s’étend à l’ensemble des colonies esclavagistes des Amériques où il désigne désormais les esclaves en fuite.
Pour les planteurs, un Nègre qui s’échappait c’était d’abord un animal ingrat et paresseux, un animal mal dressé
Le déplacement de sens opéré à travers le terme cimarron n’est pas anodin, il révèle l’animalisation systématique à laquelle étaient soumis les Noirs. Pour les esclaves, reconquérir leur humanité, cela passait donc soit par la révolte soit par la fuite (fuite et révolte pouvant s’entremêler) : dans les mornes, les forêts, les espaces vierges, le plus loin possible des plantations, des » habitations » antillaises, des mines colombiennes, des senzala brésiliennes, des multiples espaces d’asservissement radical. Dans les petites îles, du fait de l’exiguïté du territoire, les esclaves fugitifs étaient souvent repris par les planteurs qui, à l’occasion de grandes battues, lançaient hommes et chiens à leurs trousses. Mais sur le continent américain et dans les grandes îles de la Caraïbe (Jamaïque, Haïti, Cuba
), l’étendue des espaces offrant une multitude de refuges, de véritables communautés de Noirs marrons ont pu voir le jour.
Les colons n’ont jamais réussi à dissuader les candidats au marronnage. Leur pédagogie de la cruauté eut même parfois des effets inverses à ceux recherchés : » En 1730, on fit une exécution barbare sur onze malheureux nègres captifs, afin d’épouvanter leurs compagnons, et les porter à se soumettre. Un homme fut suspendu vivant à un gibet par un croc de fer, qui lui traversait les côtes ; deux autres furent enchaînés à des pieux, et brûlés à petit feu ; six femmes furent rompues vives, et deux filles décapitées. (
) Cette atrocité produisit un effet contraire à celui qu’on avait attendu. Les rebelles Saramacas (Marrons du Surinam) en furent si furieux que, pendant plusieurs années, ils devinrent les plus redoutables aux colons » (5).
L’art de la fugue
Quoi de commun entre l’évasion aléatoire d’un esclave isolé et le devenir d’un groupe de fugitifs capables de reconstituer une communauté durable ?… Qu’ils prennent la forme de fugues éphémères ou celle de guerres d’indépendance, les marronnages introduisent nécessairement une rupture dans l’ordre esclavagiste. En cela, qu’ils soient » petits » ou » grands « , ils supposent toujours une prise de liberté dont la fuite ne représente que le premier moment. Ce qui relie entre eux les différents types de marronnage, c’est donc moins la fuite, avec sa connotation de lâcheté, que le retrait stratégique : un saut hors de l’espace de la plantation qui ouvre la possibilité d’une vie sociale » dé-animalisée » et d’une offensive ultérieure. Comme le souligne le philosophe Louis Sala-Molins, » c’est en » marronnant » que les Noirs ébranleront de la façon la plus efficace les bases de la société coloniale, qu’ils accèderont à la conscience de leur capacité d’opposition systématique et de révolte » (6).
Il n’y a pas de meilleur témoignage du caractère subversif des marronnages que le récit (7) du capitaine Stedman, un officier Anglais qui participa à la campagne militaire des hollandais contre les » Nègres Boni » : » le colonel Fourgeoud (chef de l’expédition) leur promit la vie, la liberté, des victuailles, des boissons, tout ce qu’ils désiraient. Les rebelles répliquèrent par des éclats de rire sonores, qu’ils ne voulaient rien de lui, le caractérisèrent comme un Français demi-affamé ayant fui son propre pays. Ils l’assurèrent que s’il voulait leur rendre visite, il reviendrait sauf et pas avec le ventre vide. Ils nous dirent que nous étions plus à plaindre qu’eux ; que nous étions des esclaves blancs, payés quatre pences par jour pour être tués et affamés ; qu’il était indigne d’eux de gaspiller davantage de poudre sur de tels épouvantails ; mais que si jamais les planteurs et les propriétaires osaient pénétrer dans les bois, pas un seul d’entre eux n’en reviendra, pas plus d’ailleurs que les Black rangers (soldats noirs) perfides dont beaucoup seront massacrés cette nuit ou le lendemain. Ils conclurent en nous annonçant que Boni serait sous peu le gouverneur du pays. »
Face aux expéditions militaires que les esclavagistes portugais, français, hollandais, britanniques ou espagnols lançaient régulièrement contre eux, les » peuples marrons » ont su développer un subtil art de la guerre mêlant diverses techniques : le camouflage, le subterfuge, les fortifications, les pièges, la disparition. Dans Les Premiers Temps, l’ethnologue Richard Price décrit une ruse de guerre qui témoigne de la sophistication des tactiques marronnes : » Il arriva fréquemment que les Saramakas envoient des espions chargés de se faire capturer par les Blancs afin de leur livrer de fausses informations lors » d’interrogatoires « , souvent peu de temps avant d’être exécutés « . L’historien Gérard Police montre dans son dernier livre que les Marrons du Brésil, en l’occurrence ceux de la région des Palmares, excellaient eux aussi dans la maîtrise de la guérilla : » (
) les Quilombolas (Marrons) se sont très rarement engagés dans des combats de longue durée, se contentant dans les meilleurs des cas de résister quelques heures avant de rompre et de se disperser dans la forêt. En ce sens, ils pratiquaient ce qui sera caractérisé plus tard comme guerre d’usure ou guérilla, en adéquation avec le milieu naturel et leurs moyens militaires. Ils s’efforçaient souvent de harceler et de décimer les troupes envoyées contre eux très en avant de leurs principales places fortes, de telle sorte qu’en arrivant au pied des sites fortifiés elles n’aient plus les forces nécessaires pour des attaques véritablement dangereuses ou décisives » (8).
Marronner en état de guerre
: être capable de disparaître à tout moment pour refaire surface, et attaquer, là où on ne vous attend pas ; savoir se fondre dans les milieux naturels les plus divers, et mettre à profit leurs accidents. Le marronnage devient alors un véritable art de la fugue, un art de la variation : des présences, des apparences, des actions. Le lieu de vie, campement (9) bien plus que village, ne représente qu’une des variables d’un grand cache-cache qui se joue à l’échelle de vastes régions : des forêts touffues, des terres marécageuses, des mornes escarpés. Le marronnage suppose toujours une forme de nomadisme. Même quand une communauté marronne demeure longtemps en un même lieu, elle reste nomade et fugitive par sa capacité à échapper aux regards, aux prises des forces extérieures. A l’instar du légendaire peuple amérindien des » Invisibles « , la maîtrise du camouflage fait des Marrons des êtres qui peuvent être » là » sans y être (pour des étrangers). D’où, qui sait, leur réputation de » grands sorciers «
Cultiver l’invisibilité, c’est une question de vie ou de mort face à des ennemis bien plus nombreux et bien mieux armés. Protégée par d’inextricables marécages semés de pièges mortels, » Buku « , la place forte de Boni, était accessible uniquement par deux chemins immergés sous les eaux. Ce fut la trahison d’un Marron qui permit aux Hollandais, après un an de vaines tentatives, d’en prendre possession. Durant la guerre civile du Surinam (1985-1992), les Marrons des » Jungle commando » prenaient parfois des bains de plantes pour devenir invisibles
Que reste-t-il aujourd’hui de ces » peuples marrons » ? A l’exception des Businenge ( » Bouchinengué » : nom que se donnent aujourd’hui les Marrons de Guyane et du Surinam), la plupart d’entre eux ont été soit détruits, soit en grande partie » assimilés » (10). D’où l’intérêt exceptionnel des sociétés Businenge qui, au-delà de la chronique des guerres, peuvent nous apporter un éclairage précieux sur la vie intime (rites religieux, mode de vie
) des grandes communautés marronnes. Et cela d’autant plus que les principaux documents historiques relatifs aux Marrons nous viennent des textes partiaux, imprégnés de préjugés, de ceux qui les ont combattus : les soldats, les colons, les gouverneurs. Comme le souligne avec justesse Gérard Police (à propos des Quilombolas), les esclavagistes » ne les ont perçus que comme ennemis sauvages, qu’à travers la guerre, et les historiens ont eu du mal à faire autrement. Mais c’est une société qui a vécu de longues périodes de paix, qui cultivait, chassait, fabriquait, jouait et dansait, honorait ses divinités, racontait ses histoires et ses mythes, créait, enrichissait, transmettait son savoir et ses valeurs » (11).
» Dans la forêt, le Noir de la brousse (12) réorganisa sa vie sur le modèle africain ; des tribus furent formées, des territoires tribaux furent délimités. Le Noir de la brousse ne se mariait jamais hors de sa tribu ou de sa race et était fier de ses ascendances africaines sans mélange : elles faisaient de lui le descendant d’hommes libres. Isolé du reste du monde, il se rappela ses talents africains de sculpteur, de chanteur et de danseur ; il se rappela ses religions africaines. Il développa sa langue ; dans les territoires situés le plus à l’intérieur, elle s’africanisa. Et, il y a cinquante ans de cela, il inventa une écriture. » (13) Bien qu’il emploie dans ce texte des termes douteux (race, tribu
), Naipaul rend bien compte de la richesse et de la vitalité exceptionnelle des cultures businenge. Le Tembe, art de la variation, des entrelacs, du rébus, et l’écriture Afaka, une écriture symbolique et secrète apparue tardivement chez les Ndjuka, en constituent des manifestations remarquables. Cependant, en présentant les talents des Marrons comme la simple remémoration d’un héritage Africain, Naipaul minore leur créativité et leur singularité. Les sociétés marronnes ne sont pas des reproductions miniatures de l’Afrique mais, à l’instar des sociétés créoles, des cultures composites : la résultante imprévisible de la rencontre de cultures hétérogènes. » Migrants nus » (14), les ancêtres communs des Marrons et des Créoles ont su puiser à partir d’éléments culturels européens et amérindiens, et surtout à partir de leur propre mémoire (des traces de leurs dieux, de leurs coutumes, de leurs langages
), de quoi réinventer une culture. Certes, les Businenge ne sont pas des Créoles, mais la genèse de leur culture témoigne de ce que le penseur martiniquais Edouard Glissant appelle un processus de » créolisation » (15). Si chez les Businenge, l’héritage culturel » inter-africain » (l’imbricatication de cultures africaines distinctes : Ashanti, Kongo, Yoruba…) est bien plus important et bien mieux conservé que chez les Créoles, c’est parce qu’ils ont longtemps vécu dans un parfait isolement, limitant les relations avec les autres communautés au strict nécessaire.
Dans ses formes premières, ses formes élémentaires (fugues individuelles, petites bandes de fugitifs
), le marronnage constitue avant tout une réaction à l’encontre du système esclavagiste ; réaction qui en tant que telle demeure, dans une large mesure, une production de ce même système. Le dépassement de ce stade de » réaction » ne peut s’opérer que si les groupements d’esclaves fugitifs forment une population suffisante : celle requise par la reproduction sociale d’une communauté. La masse critique atteinte, il faut encore que, sous l’action du temps, l’organisation des Marrons se complexifie et se consolide. C’est seulement parvenu à ce stade de » cristallisation » que le marronnage des Africains fugitifs devient source de création : de valeurs, de mythologies, de techniques, d’institutions sociales et politiques. Il y a dans les épopées collectives des » peuples marrons « , une force affirmative qui survient en rupture de toute » dialectique du maître et de l’esclave « . Sous sa forme ultime, illustrée par la complexité et la créativité des cultures businenge, le marronnage est matrice de formes de vie nouvelles.
L’une des choses qui m’a le plus marqué durant mon séjour en Guyane, c’est l’ignorance, l’indifférence voire le mépris qu’affecte la majorité des Créoles à l’égard de l’histoire et de la culture des Businenge. Il faut dire qu’il existe une véritable frontière (linguistique, sociale, politique
) entre ces deux populations. Ce qui distingue les Créoles des Marrons, c’est moins l’apparence physique que le rapport qu’ils entretiennent respectivement à leur histoire. Maints écrivains des Caraïbes (Naipaul, Fanon, Chamoiseau, Damas
) l’ont souligné : les Créoles (16), marqués par l’esclavage et le mépris de soi qu’inculque cette institution, ont du mal à se rapporter à leur passé sans honte ni rancur ; quand ils ne le refoulent pas tout simplement. Leur métissage (je suis moi-même un » métis «
), ce ton » caramel » dont la beauté est célébrée par les agences de voyages et les crèmes desserts » Créola « , recouvre un différend (17) : le viol de la » Négresse » par le » Blanc « . Un thème récurrent dans la littérature antillaise : » Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un jour de 16** alors que le navire faisait voile pour la Barbade. C’est de cette agression que je suis née. De cet acte de haine et de mépris » (18). Aussi le contraste est-il frappant avec les Businenge : une communauté fière de son histoire, même si, comme toute histoire, elle est faite également de trahisons, de lâchetés, de compromissions (19).
Il ne s’agit pas de juger, de savoir qui des Créoles et des Businenge a tort ou raison ; mais de comprendre qu’il en résulte, de part et d’autre, des » consciences historiques » divergentes. Ainsi, en tant que descendants d’esclaves, les Créoles auront tendance à se sentir lésés par l' » Histoire « , à se considérer comme des victimes, à exiger réparation. L’histoire » Créole » est blessure, traumatisme, viol. Les Businenge quant à eux, en tant que descendants de » Nègres rebelles « , auront tendance à se considérer comme acteurs de leur propre histoire. S’ils ont des luttes à mener ce sera dans la continuité de luttes plus anciennes. De sorte que l’histoire sera pour eux une réserve de forces et non une source de complexes. Leur mémoire des combats passés est en effet toujours prête à être réactivée comme l’illustra la guerre civile du Surinam : » Cette guerre, qui a duré jusqu’en 1992, a fait revivre la mémoire des ancêtres marrons qui avaient tant risqué pour conquérir leur liberté au temps de l’esclavage. Les grands obias (pouvoirs magiques) de guerre, mis en sommeil à la fin des conflits du XVIIIe siècle, ont été déterrés et ranimés pour les combats. Hommes et garçons ndyuka et saramaka, armés de fusils de chasse, ont fait face aux armes automatiques, aux chars et aux hélicoptères de combat qui larguaient du napalm » (20).
En dépit des apparences, les ancêtres des Créoles ont fait preuve d’autant de combativité que leurs contemporains Marrons, mais leurs résistances plus souterraines ont été peu à peu gommées par une histoire officielle reposant, implicitement, sur le mythe de l’esclave docile. Le » grand récit » des abolitions est l’instrument privilégié d’une histoire » française » qui exclut les Créoles de leur propre » libération « . Chaque rue, chaque place, chaque établissement scolaire, chaque monument qui, dans les anciennes colonies esclavagistes françaises (Antilles, Réunion, Guyane
), célèbre la mémoire de Schoelcher (21) rejette, simultanément, dans le silence et dans l’ombre chacun des affranchis, chacun des esclaves, chacun des marrons qui contribuèrent activement à la fin de l’esclavage.
Les esclaves n’ont jamais attendu qu’on daigne les libérer, voilà ce que manifeste clairement le phénomène général et constant du marronnage. Fruit de l’action conjointe des affranchis, des » mulâtres « , des esclaves insurgés et des marrons, la Révolution haïtienne de 1804 atteste, elle aussi, le rôle déterminant que jouèrent les » Nègres » dans leur propre libération. Des » Nègres » qui surent s’approprier les idéaux de la Révolution française et les retourner contre leurs propres auteurs, ce qu’Aimé Césaire analyse admirablement dans son essai sur Toussaint Louverture : » Attendre l’abolition de l’esclavage d’un geste spontané de la bourgeoisie française, sous prétexte que cette abolition était dans la logique de la Révolution et plus précisément de la Déclaration des Droits de l’Homme, c’était, à tout prendre, méconnaître que sa propre tâche historique, la révolution bourgeoise elle-même, la bourgeoisie ne l’avait accomplie que harcelée par le peuple et comme poussée l’épée dans les reins. L’étonnant est que les masses nègres aient si vite compris qu’il n’y avait rien à attendre de Paris et qu’ils n’auraient en définitive que ce qu’ils auraient le courage de conquérir » (22).
Pour les » Afro-américains » (l’ensemble des descendants d’Africains déportés), la reconstruction d’une » estime de soi » passe forcément par la mise en valeur des modes de résistance (marronnages, insurrections, sabotages, luttes politiques…) de leurs ancêtres : un moyen de se réapproprier une histoire écrite, dans une large mesure, du point de vue des » vainqueurs » (23)
Comment mettre en valeur les résistances » noires » sans pour autant tomber dans le » folklore » ou dans le » mythologique » ? Le recours aux recherches historiques paraît indispensable ; le problème c’est qu’aujourd’hui encore elles se focalisent sur les conditions de vie des esclaves, sur les rouages du » commerce triangulaire « , sur les » abolitions « , bref sur la surface émergée de l’histoire de l’esclavage, mais explorent rarement pour lui-même le domaine obscur des » résistances « . Il faut avouer que les résistances multiples, locales, ponctuelles, le plus souvent anonymes – des manifestations diffuses et hétérogènes – que suscita l’esclavage n’ont bénéficié d’aucuns chroniqueurs officiels. Elles ont donc laissé peu de traces écrites et d’archives, la principale matière première des historiens.
» En faisant l’histoire des femmes, on retrouve les femmes, on découvre les mécanismes de leur domination, on comprend leur oppression, leur silence, leur révolte, leur force d’obstruction. L’idée que les femmes auraient toujours été passives est complètement fausse, elles ont toujours essayé de s’en sortir. Faire l’histoire des femmes c’est retrouver des formes de domination mais aussi d’expression culturelle et de résistance » (24). Les travaux récents sur l’histoire des femmes, cette autre zone d’oubli, peuvent servir de modèle à une histoire des résistances » noires » : ils montrent en effet qu’en l’absence de traces écrites, il faut savoir s’appuyer sur les mémoires orale et matérielle (ustensiles, vêtements, uvres d’art
), et combiner des disciplines complémentaires (histoire, sociologie, ethnologie
), si l’on veut dissiper l’ombre qui entoure les actions, les » micro-actions « , les comportements, toute la palette des modes d’expression et de résistance des » dominés « . On comprend donc l’intérêt exceptionnel que présentent les communautés Businenge chez qui la résistance à l’esclavage a modelé non seulement la mémoire collective, mais aussi les relations interpersonnelles, le mode de vie, la culture entière. Les » Premiers Temps » (25), le vaste corpus historiographique marron, constituent à eux seuls une » contre-histoire » : une histoire qui inverse les points de vue, une histoire dont les premiers historiens sont les acteurs eux-mêmes, une histoire dont le thème principal est la lutte pour la liberté.
Traiter les résistances » noires » comme un domaine historique à part entière, enquêter à partir des traditions orales afro-américaines (au sens large), prêter l’oreille à ce qui dans les cultures marronnes transparaît des luttes passées : autant de pistes pour une autre lecture de l’histoire de l’esclavage, une lecture qui rende enfin justice aux » acteurs de l’ombre » (esclaves, affranchis, marrons) et à leurs descendants
En septembre 2003, peu après mon arrivée à Cayenne, je parvins à obtenir un poste d’enseignant sur le Maroni, à Apatou. Environ deux heures de pirogue séparent cette commune isolée de Saint-Laurent, la seconde ville de Guyane. Tout au long du trajet, je pris des notes dans un vieux carnet : premières impressions…
Sur un parking en terre battue, à proximité de » Chicago « , l’un des quartiers » chauds » de Cayenne ; des minibus en stand by. C’est l’unique » gare routière » de la Préfecture de Guyane… Pour effectuer les 250 km de macadam qui séparent Cayenne de Saint-Laurent du Maroni, l’ancienne capitale du bagne, il faut compter 30 euros. Inutile d’essayer de se procurer un horaire, les » Taxicos » ne prennent la route qu’une fois pleins, ce qui rend l’heure du départ aléatoire
Un peu après Iracoubo, sur la route qui relie Cayenne à Saint-Laurent, le paysage change sensiblement. La forêt se fait plus pressante, les arbres gagnent en hauteur, on quitte progressivement le plat du littoral, ses savanes, ses zones de culture et d’élevage, pour s’enfoncer dans l’intérieur des terres. Le ruban d’asphalte de la Nationale 1 sinue entre de modestes vallonnements qui offrent au regard un subtil dégradé de verts, dont le spectre varie en fonction des essences végétales et de l’animation du ciel. Les communes créoles laissent place à de petits villages businenge et amérindiens : une succession de carbets et de petites maisons, des constructions simples faites de planches de bois brut, de feuilles de palmier tressées, de toits de tôle. Une femme noire portant sur le plat de la tête une bassine remplie de maniocs et d’ignames, de petits Amérindiens poussant une brouette dans un abattis (cultures sur brûlis), un jeune Saramaka armant son lance-pierre en direction de la cime des arbres : à l’approche de Saint-Laurent, une autre Guyane se profile, très différente de celle des régions côtières de Cayenne, Kourou ou Sinnamary.
A Saint-Laurent, le Maroni forme un grand lac allongé dont les eaux brunes ou dorées, suivant l’angle des rayons solaires et la densité des nuages, baignent de grandes étendues de terre ; des îles couvertes d’une végétation touffue. Nous sommes dans l’estuaire du plus grand fleuve de Guyane, les courants et marées y sont puissants, les vents y font frémir les frondaisons ciselées des palmiers. C’est du lieu-dit » La Glacière « , tout près du quartier de la Charbonnière, le quartier » Marron » de Saint-Laurent, que partent les pirogues-taxis d’Apatou.
L’embarcadère de » La Glacière » consiste en une simple plage au sable foncé, humide et lourd ; une plage semée de grosses pierres, de tessons de bouteilles, de sacs plastiques et d’autres détritus. Chaque matin, entre neuf et onze heures (l’heure de l’unique départ quotidien), une demi-douzaine de pirogues y stationnent, échouées à même le sable, prêtes à charger passagers et marchandises. Pour convaincre les voyageurs de choisir leur « Compagnie » et empocher les douze euros de la course Saint-Laurent Apatou (50 km à vol d’oiseau), chaque piroguier prétend avoir la meilleure embarcation et le moteur le plus puissant. Le choix est difficile, les taxis du Maroni sont tous aussi flamboyants les uns que les autres : leurs flancs et leurs banquettes sont couverts de couleurs vives, les uns sont ornés de Tembe (motifs traditionnels), les autres de symboles ou de personnages Rastafari (Bob Marley, le lion de Jamaïque
). Ces magnifiques pirogues, au profil bien effilé, faites à la fois pour la vitesse et pour le transport du fret dans des eaux peu profondes, ponctuées de rapides, ces pirogues sont sûrement les meilleures embarcations légères d’Amazonie.
Une fois l’heure du départ venue, le pilote arrache les premiers toussotements à son moteur (en général des 75 Ch.). Alors, légèrement déséquilibrée vers l’arrière, la pirogue s’élance vers l’autre rive du Maroni, vers Albina, la voisine surinamienne de Saint-Laurent. C’est un petit port de fortune où les canotiers viennent systématiquement s’approvisionner en carburant et en marchandises diverses. De loin, on aperçoit, à la verticale de trois grosses citernes en fer-blanc, le célèbre coquillage de la compagnie Shell. L’embarcadère d’Albina est tout aussi rudimentaire que celui de la Glacière, mais la berge est mieux aménagée et beaucoup plus animée. Sur toute sa longueur et dans les allées qui la jouxtent, on trouve une série de grosses épiceries où l’on vend de tout : des sacs de pomme de terre, de riz, d’oignons, des cartouches de Morello (cigarettes surinamiennes), des packs de Parbo Bier (la bière locale), des boîtes de conserve, des aliments pour bébé, de la quincaillerie
Les pubs sont peintes à même les murs, la plupart d’entre elles représentent des verres, des bouteilles d’alcool et des paquets de cigarettes. Un peu en retrait, des minibus stationnent près d’un kiosque à musique délabré. Les chauffeurs discutent entre eux ou hèlent les clients potentiels, en attendant de reprendre la route, une piste défoncée, en direction de la capitale Paramaribo. La halte au Surinam peut durer plus d’une heure
Quand enfin la pirogue quitte Albina et le couple d’Indiens, taillé dans la pierre, qui en garde silencieusement les berges, il reste encore une heure trente à deux heures de navigation jusqu’à Apatou. Les piroguiers marrons empruntent des routes invisibles, ils longent par moments la rive surinamienne, reviennent ensuite du côté guyanais, s’engagent finalement au milieu du fleuve ; ils ne cessent d’explorer de nouveaux chemins d’eau. Ces louvoiements ne sont jamais fortuits : les eaux du Maroni sont peu profondes (surtout à marée basse et durant la saison sèche), les courants sont très forts à certains endroits, et bancs de sable et rochers sont toujours à craindre. Il faut donc suivre des itinéraires bien précis pour profiter le mieux possible des courants et éviter les chavirements. Officiellement le Maroni n’est pas navigable, de sorte qu’aucune loi n’y régit la navigation
Une fois Albina et Saint-Laurent laissées derrière, le vert sombre de la forêt amazonienne s’étend à perte de vue. Seules les rives du fleuve manifestent de temps à autre, tous les 5 ou 10 km, une présence humaine. Bastien, New Campo, Sparouine, La Forestière, Patience, Maïman, les Kampu (petits villages businenge) se succèdent, rythment et égayent les berges du Maroni. Tous les déplacements s’effectuant en pirogue, les villages marrons se situent toujours en bordure d’un fleuve ou d’une rivière. Ils occupent des terrains plats, suffisamment élevés au-dessus de l’eau pour échapper aux inondations. Chaque village s’ouvre sur le fleuve par un dégrad (sorte de débarcadère), un point de la rive où une pente douce permet l’accostage quel que soit le niveau de l’eau. A chaque fois que l’on passe devant un kampu, de la pirogue on aperçoit des enfants qui s’amusent dans l’eau, des femmes lavant leur linge, des hommes nettoyant leurs filets de pêche
La vie des Businenge du Maroni s’organise encore, en grande partie, autour du fleuve.
La première chose que l’on voit d’Apatou, c’est le triangle de sa Gendarmerie Nationale (depuis, elle a été détruite). Inspiré des maisons traditionnelles businenge, caractérisées par des toits pentus qui descendent jusqu’au ras du sol, ce bâtiment domine le dégrad principal de la commune. Au-delà de la gendarmerie, une promenade en ciment longe les bords du fleuve sur une centaine de mètres ; elle dessert une école maternelle, un dispensaire sur pilotis, et un marché aux poissons. De cette promenade, on peut gagner les » hauteurs » (la pente est très douce) du village par une multitude de petits chemins de terre qui passent à travers les parcelles des habitants. Le centre de la commune s’organise autour du Faka Tiki (lieu de culte pour les Ancêtres), de la mairie et de l’église : l’habitat y est très dense, la disposition des maisons, pour la plupart assez petites, plutôt anarchique.
En dehors du » bourg » proprement dit, Apatou s’étend à travers des quartiers récents aux noms évocateurs : Colombia, China, Jamaica
Les maisons en parpaings et tôles ondulées y prennent le pas sur celles, traditionnelles, en bois d’angélique et toits de waï (feuilles de palmier tressées). Apatou comporte aussi de nombreux vergers et abatis, de sorte qu’on passe insensiblement du village à la forêt.
En se promenant, on croise souvent des bulldozers, des camions, des pelleteuses, des foreuses, toute une série d’engins mécaniques ; on découvre aussi des panneaux annonçant l’aménagement d’une place publique, la mise en place d’une station d’épuration, l’extension du réseau électrique, et d’autres chantiers encore. Apatou n’est plus un petit village traditionnel mais une commune en devenir
Apatou, c’est un gigantesque établissement scolaire : pour seulement trois mille habitants, elle compte en effet quatre écoles et un collège en voie d’extension
Le matin, à travers la brume et les flots, des pirogues affluent de tous les Kampu. On discerne à peine, engoncées dans des gilets de sauvetage jaunes et oranges, les têtes des écoliers et des collégiens. Quand les enfants des Kampu descendent à terre et se mêlent à ceux du bourg d’Apatou, les chemins et les routes de terre battue se parent de jaune, de vert, de bleu et de blanc, les couleurs des différents uniformes scolaires (chaque couleur renvoie à un établissement). Dans ces moments là, juste avant le début des cours ou après leur fin, Apatou appartient aux enfants
Dès le lendemain de mon arrivée, je me rendis au Collège d’Apatou où, tout au long de l’année, je devais faire office de documentaliste. A l’exception d’une élève Wayana (une amérindienne), l’ensemble des collégiens étaient Businenge. Pour la plupart d’entre nous, une majorité d’enseignants fraîchement débarqués du littoral guyanais, de France métropolitaine ou des Antilles, c’était une situation inédite : sans aucune formation préalable, nous nous retrouvions brusquement face à des élèves qui non seulement parlaient, pour la plupart, à peine le français, mais en outre avaient une culture et un mode de vie complètement différents des nôtres. Nous étions en terre marronne, au sein d’une société qui récemment encore (27) fonctionnait de manière entièrement coutumière (clans matrilinéaires, conseils d’Anciens, » capitaines » et » granmans «
). Plus de la moitié de nos élèves vivaient dans des kampu, dans de petites maisons en bois sans eau courante ni électricité ; beaucoup d’entre eux, en dehors de l’école, allaient à l’abattis, à la pêche ou à la chasse pour compléter les ressources de leurs familles ou, tout simplement, pour retrouver la complicité du Maroni et de la forêt. Bien sûr, c’est aux filles que revenaient l’essentiel des corvées domestiques : le ménage à l’intérieur, la lessive et la vaisselle au fleuve. Et puis, régulièrement, la longue et fastidieuse préparation du couac, la farine de manioc, la base de l’alimentation locale. A ces contraintes, s’ajoutait pour certaines, la responsabilité d’un enfant
Vu du Maroni, les méthodes pédagogiques et les programmes scolaires français avaient quelque chose d’irréel, de » décalé « … Au collège, à chaque fin de cours, une question lancinante revenait : qu’est-ce que les élèves avaient retenu, qu’est-ce qu’ils avaient compris de nos mimiques et gesticulations ? Pour beaucoup d’enfants, venir à l’école c’était comme participer à un grand jeu collectif. » Métier « , » travail « , » avenir professionnel « , rare étaient ceux qui saisissaient la signification de ces termes. Il faut dire que la majorité des parents n’avaient jamais eu ce que nous appelons un » emploi salarié » ; ils vivaient de leurs cultures, de petits commerces ou de trafics divers, et, pour ceux qui avaient la nationalité française, des aides sociales.
La principale difficulté de l’enseignement sur le Maroni, que ce soit chez les Marrons ou chez les Amérindiens, ce n’est pas la » faiblesse extrême du niveau scolaire » – une expression qui n’a pas de sens dans le contexte d’une communauté traditionnelle non francophone – mais la différence culturelle qui existe entre enseignants (qu’ils soient créoles ou » métros « ) et élèves. Tant que notre Education Nationale ne prendra pas en compte cette différence, les écoles et collèges établis dans ces communautés produiront acculturation et échec scolaire de masse. Le problème ne réside pas tant dans le fait que la scolarisation se substitue à la transmission par les » Anciens » des savoirs et des pratiques traditionnels, mais surtout dans le fait que cette scolarisation s’opère sur la base d’une négation de la culture Businenge (interdiction fréquente de l’usage des langues marronnes, inexistence des Businenge et autres peuples marrons dans les manuels d’histoire
). Cela conduit donc forcément à la dévalorisation des élèves marrons qui, évalués à l’aune de critères scolaires restrictifs, ne peuvent apparaître aux enseignants que comme des » nuls « .
Cela fait très peu de temps que les Businenge sont soumis à notre scolarisation » républicaine «
La première école publique d’Apatou n’a que dix ans, et le collège lui-même n’a ouvert ses portes qu’à la rentrée 2001. Comment s’étonner alors que les élèves marrons aient tant de mal à se soumettre à la » discipline » scolaire ? Tout au long de l’année, il faut se battre pour qu’ils gardent leurs chaussures aux pieds, pour qu’ils restent assis sur leur chaise, pour qu’ils ne se mettent pas d’un seul coup à chanter, pour qu’ils restent concentrés plus de dix minutes
Tout cela n’a rien d’évident, cela requiert normalement un long dressage qui commence chez nous dès le plus jeune âge, et se transmet de générations en générations.
On comprend donc le désarroi de bien des professeurs (souvent des jeunes sans expérience ou des contractuels) affectés sur le Maroni qui se retrouvent dans des communes isolées (parfois à plusieurs heures voire plusieurs jours de pirogue de Saint-Laurent), sans le soutien des institutions, livrés à eux-mêmes, avec une formation et des méthodes pédagogiques inadaptées à leur nouvelle situation. Au manque de moyens, aux difficultés de déplacement et de communication s’ajoute souvent le manque de personnel. Pour prendre le cas du Collège d’Apatou, nous n’avons pu disposé d’une infirmière scolaire et d’une assistante sociale qu’à raison d’une fois par mois. Quant au médecin scolaire et au conseiller d’orientation, il n’y en a jamais eu. Comment faire face au baklu (phénomène de possession) d’une collégienne ? Comment instaurer un dialogue avec des parents qui ne comprennent ni votre langue, ni le fonctionnement de votre système scolaire ? Sachant qu’on a affaire à des familles matrilinéaires, qui contacter en cas de problème avec un élève ? En général, ce n’est pas à l’IUFM (lieu de formation des enseignants) qu’on apprend à faire face à ce genre de situation
Les enfants Businenge sont riches en connaissances et compétences variées. Toute la difficulté c’est de réussir à mobiliser celles-ci et à les faire fructifier dans le cadre d’un établissement scolaire français. Hors de l’enceinte du collège, ce sont les élèves les véritables professeurs. Personnellement, ils m’ont appris les bases de leur langue, ils m’ont initié à la pêche à la nivrée, ils m’ont dit des matos (contes marrons), ils m’ont montré les usages de certaines plantes, et bien d’autres choses encore. Ce poste de documentaliste à Apatou a été pour moi l’expérience la plus riche qu’il m’ait été donné de faire. Aussi aurais-je aimé ne parler que de ma relation privilégiée avec les élèves et des projets menés à bien avec des associations ou des collègues : exposition sur le Capitaine Apatou (fondateur du village), journal du collège, accueil d’une écrivaine haïtienne (salon du livre de Cayenne)
Mais au cours de cette année scolaire riche en événements, découvertes et rencontres, des élèves m’ont rapporté des faits relevant de la maltraitance scolaire. Moi-même j’ai été témoin de sévices psychiques et physiques infligés à des élèves par des membres du corps enseignant. Mon propos, en faisant allusion à ces faits dans Drôle d’époque, n’est pas d’instruire un procès (une enquête judiciaire est en cours), mais d’interroger l’impensé d’une éducation dite » créole » dont les auteurs de ces sévices se prévalaient pour justifier leurs actes.
» Tant de choses, je commence juste à le voir, parlent de l’esclavage dans les territoires antillais. (…) Esclavage dans l’absence de vie de famille, dans le rire au cinéma devant les images des camps de concentration allemands, dans le goût pour les insultes raciales, dans la brutalité dont usent les forts à l’encontre des faibles : nulle part au monde les enfants ne sont plus sauvagement battus qu’aux Antilles » (28). A travers ces comportements » anodins « , à travers ces aspects de la vie sociale créole qu’il croque en quelques mots, Naipaul repère l’écho lointain des temps de l’esclavage. Si le traumatisme – la déportation, le viol, la condition de bétail humain
– qui inaugure le devenir créole n’en finit pas de durer, c’est que le fer de l’esclavage était conçu non seulement pour marquer des esprits et des corps, mais aussi une » couleur » et une » race » : le » Noir « . Tocqueville analyse bien cette spécificité de l’esclavage » moderne » : » (
) chez les modernes le fait immatériel et fugace de l’esclavage se combine de la manière la plus funeste avec le fait matériel et permanent de la différence de race. Le souvenir de l’esclavage déshonore la race, et la race perpétue le souvenir de l’esclavage (29). » Dès le départ, dans les Amériques, l’entreprise esclavagiste eut pour instrument privilégié le dé-nigrement (latin denigrare : noircir (30)) tautologique du » noir « . En témoigne la théorisation par l’Eglise de la malédiction de Cham (fils maudit de Noé), source de la corruption, de l’infériorité morale des Nègres : »
cette nation porte sur le visage une malédiction temporelle, et est héritière de Cham, dont elle est descendue ; ainsi elle est née à l’esclavage de père en fils, et à la servitude éternelle
» (31). On retrouvera le même schéma dans la théorisation » scientifique » (biologie, théorie des climats
) de l’infériorité raciale du Nègre. L’humiliation, l’infériorisation était la technique de dressage et de légitimation privilégiée d’un système visant à produire des esclaves » humbles « . Cette humiliation résonne toujours dans les termes utilisés aujourd’hui encore pour désigner les différents degrés d’hybridation » noir-blanc » : »
chabin, en vieux normand, désigne une variété de moutons à poil roux. Mulâtre vient de mulet. Capre ou capresse est dérivé de chèvre. Les maîtres blancs voulaient animaliser leurs rejetons pour qu’ils n’aient pas l’outrecuidance de réclamer des droits sur les richesses de leurs pères » (32).
Ce qui m’a le plus frappé dans les actes de maltraitance dont j’ai été témoin ou que l’on m’a rapportés, ce n’est pas la violence » physique » qu’ils pouvaient revêtir mais précisément le caractère d’humiliation qui s’en dégageait. Je ne citerai que trois cas, les plus révélateurs et les moins contestables, sans entrer dans les détails pour des raisons évidentes :
– la » mise à nu » dans un bureau, à huis-clos, de deux élèves (ce fait a été avoué publiquement, y compris devant les gendarmes, par la personne qui s’en est rendue coupable).
– la » mise à genoux » durant environ une demi-heure d’un élève (fait dont j’ai été témoin et dont j’ai rendu compte par écrit à l’Inspection Académique de Guyane et par déposition orale à la gendarmerie d’Apatou).
– la » mise au soleil » : régulièrement, un membre de l’équipe éducative punissait des élèves en les plaçant debout, en plein soleil, selon une durée variable allant de trente minutes à une heure (cela se passait dans la cour donc nous étions tous témoins
).
Vu de France métropolitaine, cela paraît bien sûr incroyable. Mais sur place, quand il nous arrivaient, à moi et à d’autres collègues, d’exprimer notre opposition à ce type de mesure disciplinaire, les auteurs de ces mesures et leurs défenseurs nous rétorquaient que c’était » comme ça » dans l’éducation créole et qu’en tant que » Métros » nous n’avions rien à dire. Le Principal, lui-même Créole, cautionnait implicitement ces pratiques, ce qui explique la difficulté que nous avions à les contester. Le fait de me mêler de ce qui, selon le Principal, ne me regardait pas – les » pratiques pédagogiques » de mes collègues – me valut d’ailleurs un rapport de sa part à la hiérarchie. Rapport qui se traduisit par un » sévère avertissement » de l’Inspecteur Académique : » Si de tels événements devaient m’être à nouveau signalés, je ne manquerais pas de mettre en uvre une procédure de licenciement «
Si je m’attarde sur ces détails, c’est pour que l’on comprenne bien que certains enseignants se sont opposés à la maltraitance dans le collège, mais qu’en tant que » Métros » et nouveaux venus notre marge de manuvre était limitée
L’éducation des enfants chez les Marrons est souvent très dure mais elle ne comporte pas cette dimension de haine de soi (de mépris du » Nègre » qui est en soi) que l’on retrouve encore souvent chez les Créoles. Il m’est arrivé d’entendre des mères créoles traiter leurs propres enfants de » sales nègres « , ce à quoi fait allusion Naipaul quand il parle de » goût pour les insultes raciales « . Je n’ai jamais entendu une » noire » africaine traiter son enfant de » sale nègre « , ni une » blanche » européenne traiter le sien de » sale blanc « . Frantz Fanon analyse très bien l’espèce de schizophrénie qui aujourd’hui encore travaille les descendants d’esclaves. Les siècles d’esclavage et les représentations racistes du Nègre marquent encore les esprits et les corps créoles ; ce qui se traduit par des stratégies de » lactification « , de » blanchiment » : » Car enfin il faut blanchir la race ; cela toutes les Martiniquaises le savent, le disent, le répètent. (
) Le nombre de phrases, de proverbes, de petites lignes de conduite qui régissent le choix d’un amoureux est extraordinaire aux Antilles. Il s’agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et toute Antillaise s’efforcera, dans ses flirts ou dans ses liaisons, de choisir le moins noir » (33). Cette » épidermisation » de l’infériorité raciale, que diagnostiquait Fanon au début des années 1950, est toujours d’actualité si l’on en croît Biringanine Ndagano qui écrivait en 2000 : On entend » I gen lapo clè » (il a la peau claire), » I gen bon chivé » (il a les cheveux lisses), » Lapo chapé » (une peau sauvée du Noir). (
) Non, la mentalité n’a pas disparu. Elle est peut-être plus diffuse, comme la domination qui l’a engendrée. (
) Un Nègre à peau noire et aux cheveux crépus fait l’objet de mépris. Des expressions comme » Nègre-gros-sirop » (noir comme le sirop de canne), » nèg nwè » (Nègre noir), » nèg Kongo « , » ti samaka » (petit saramaca) ou » ti boni » (petit boni) sonnent parfois comme des injures (
) » (34).
Récemment encore, en Louisiane, on appliquait la » règle de la goutte » ( » The one-drop rule « ) : » Une goutte de sang noir vous ramène au rang des noirs « . Si on découvrait parmi vos lointains aïeuls la moindre ascendance noire, aussi blanc que vous puissiez être, on modifiait votre état civil, on vous rétrogradait dans la case » noire « . C’est ainsi qu’au début des années 1980, l’administration louisianaise apprit à une respectable dame, jusqu’ici » blonde et blanche « , qu’elle serait désormais recensée comme » African-American » parce qu’on avait découvert dans son arbre généalogique une lointaine arrière-arrière-
-grand-mère Noire (35)
Le Noir est indélébile ! Difficile donc, dans les Amériques, de ne pas se sentir » sali » quand du » sang noir » coule dans nos veines. Comment se déprendre de la honte d’être » noir » et du mépris des plus » noirs » que soi sans pour autant se laissait enfermer dans cette même couleur que, depuis des siècles, on nous colle à la peau : el negro !… Je n’ai pas de solution, moi-même » afro-européen » ou » euro-africain « , Créole en quelque sorte, j’éprouve quotidiennement le différend de mes » origines » : une micro-guerre en » noir et blanc « . Et cela d’autant plus, que je ne me reconnais ni dans le Blanc ni dans le Noir, ni dans aucune autre couleur ou zoo-chromie (mulâtre, chabin, cafre, moricaud
)… Etrange paradoxe que d’appeler » homme de couleur » ( » colored people « ) le dit » homme noir » quand l’optique moderne définit le noir comme absence, comme absorption des couleurs, comme » trou noir » (36). Aussi le petit Richard a-t-il bien raison de s’étonner des » couleurs » :
» – Qu’est-ce qu’il a en lui, papa ? demandais-je ? – (sa mère) Un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de noir. – Indien, blanc et nègre ? – Oui. – Alors qu’est-ce que je suis ? – Quand tu seras grand, on dira de toi que tu es un homme de couleur
» (37)
1. V.S. Naipaul (Nobel de littérature), La traversée du milieu, Plon, Paris, 1994, p. 213.
2. Les autres Marrons ont migré et se sont implantés en Guyane pour des motifs divers, variant selon les époques : quête de nouvelles terres, rush aurifères des XIXe et XXe siècles (les orpailleurs avaient recours aux pirogues marronnes), guerre civile du Surinam (afflux de réfugiés marrons)
3. Centre de création dédié à l’uvre d’Armand Gatti.
4. Auteur, entre autres, de L’Isolé soleil (Seuil), un roman qui retrace l’histoire antillaise depuis les cruautés de l’esclavage et les révoltes imposant l’abolition jusqu’aux bouillonnements contemporains.
5. G. Stedman, Narrative of Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam, J. Hopkins University Press (Capitaine au Suriname : » Récit d’une campagne de cinq ans contre les Nègres Rebelles « ), Baltimore, 1992.
6. Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, PUF, coll. Quadrige, 1987, p. 169.
7. G. Stedman, op.cit.
8. G. Police, Quilombos dos Palmares : » Lectures sur un marronnage brésilien « , Ibis rouge, Cayenne, 2003, p. 50.
9. Aujourd’hui encore, les Businenge du Maroni utilisent le terme » Kampu « , une altération de l’anglais » camp « , pour désigner leurs villages
10. Les descendants des Quilombos du Bésil, des Cumbes du Venezuela, des Palenques de Colombie ont été amenés, de gré ou de force, à adopter la langue et la culture de leurs compatriotes. Des temps du marronnage, il ne leur reste que des bribes : des » parlers « , des mythes, des rythmes musicaux, des commémorations…
11. G. Police : op.cit.
12. Le terme » Businenge » provient de l’altération des mots néerlandais » bos » (forêt) et » negers » (de l’espagnol » negro » : la couleur noire et la peau noire). Dans la langue commune des Ndyuka, Paramaka et Aluku, le busitongo, » nenge « a davantage le sens d’homme » noir » (non étranger). Une traduction fidèle donnerait plutôt : » homme de la forêt « .
13. La traversée du milieu, Plon, Paris, 1994, p. 215.
14. , »
les Africains, eux, arrivent dépouillés de tout, de toutes les possibilités, et même dépouillés de leur langue. Car l’antre du bateau négrier est l’endroit et le moment où les langues africaines disparaissent (
) « . E. Glissant, Introduction à une Poétique du Divers, Gallimard, 1996, p.16.
15. » La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments « , Traité du Tout-monde, Gallimard, 1997, p. 37.
16. L’étymologie même de ce terme dénote la servitude : 1643 ; en espagnol. criollo, du portugais. crioulo » serviteur nourri dans la maison « , Le Robert.
17. Métissage culturel, différend et disparition, Alain Brossat, Revue Lignes n°.
18. Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière
, Folio, 1988, p. 13.
19. Les traités signés avec les Hollandais prévoyaient, en échange d’un tribut annuel (armes, outils, biens divers
), que les Marrons cessent leurs attaques contre les plantations, mais aussi qu’ils ramènent à leur propriétaire tout nouvel esclave fugitif. Les Ndyuka, alliés des Hollandais, tuèrent le chef de guerre Boni et maintinrent longtemps sa communauté (les actuels Aluku) sous leur tutelle. Les Aluku passèrent eux aussi des accords profitables avec la France : ils devaient ramener à l’Administration Pénitentiaire les évadés du agne
20. Richard et Sally Price, Les Marrons, Vents d’ailleurs, Châteauneuf-le-Rouge, 2003, p.71.
21. L’un des plus grands défenseurs européens de la » cause des Noirs » et le principal artisan du décret d’abolition de l’esclavage de 1848.
22. Toussaint Louverture : » La Révolution française et le problème colonial « , Présence Africaine, Paris, 1981, p. 171.
23. Le cas des manuels scolaires français est exemplaire. Ainsi le supplément Histoire » Antilles Guyane » à destination des Collèges (éd. Hatier) consacre un grand dossier aux abolitions (vues sous l’angle des combats des philanthropes » Blancs « ) mais n’offre qu’une allusion sommaire aux marronnages : une citation de Candide et la reproduction d’un tableau du XVIIIe siècle accompagnée de la légende suivante : » Nègres marrons «
On y apprend également que la victoire de Toussaint Louverture, à Haïti, sur les armées napoléoniennes est avant tout due au mauvais état de santé des soldats français
24. Extrait d’un entretien avec Michelle Perrot : Faire exister les acteurs de l’ombre, www.interdits.net/2002fev/perrot.htm. Voir aussi : Les femmes ou les silences de l’histoire, éd. Flammarion, Paris, 1998
25. Ensemble hétérogène fait de proverbes et maximes, de chants, de paroles tambourinés (tambours apinti), de prières, de récits relatifs aux temps des » ancêtres fondateurs » et des luttes contre les esclavagistes. Cf. Richard Price, Les Premiers Temps : » la conception de l’histoire des Marrons saramaka « , Seuil, Paris, 1994.
26. Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon, Points Seuil, p. 38, Paris, 1971.
27. Avant l’imposition, en 1969, du système communal et des politiques de développement et d' » intégration » qu’il suppose : aides sociales, médicalisation, contrôles administratifs, scolarisation
28. Dans le chapitre » Surinam » de La traversée du milieu, p. 212.
29. De la démocratie en Amérique, éd. Gallimard, coll. Folio histoire, p. 500
30. Dénigrer : » S’efforcer de noircir, de faire mépriser (qqun, qqch.) en attaquant, en niant les qualités. « , Le nouveau Petit Robert, éd. 1993
31. M. de St-Michel, Voyages des îles Camercanes, 1652 ; cité par Sala-Molins, Le Code Noir, p. 22
32. Interview de l’écrivain martiniquais Raphaël Confiant, Télérama n°2273, 4 août 1993, p. 7
33. Peau noire, masques blancs, Points Seuil, p. 38, Paris, 1971.
34. Nègre tricolore : » Littérature et domination en pays créole « , Maisonneuve & Larose, Paris, 2000.
35. « …the one-drop rule, which defines as black a person with as little as a single drop of « black blood ». (
) It still is, according to a United States Supreme Court decision as late as 1986, which refused to review a lower court’s ruling that a Louisiana woman whose great-great-great-great-grandmother had been the mistress of a French planter was black
», in « One Drop of Blood », Laurence Wright, The New Yorker, 24 juillet 1994
36. » Il est donc démontré que la couleur de tous les rayons réunis est la blancheur. Le noir par conséquent sera le corps qui ne réfléchira pas de rayons « , Isaac Newton, cité par M. Déribéré, La couleur, Que sais-je, 1964, p. 24
37. Black boy, Richard Wright, éd. Gallimard, coll. Folio, 2000, p. 87
revue Drôle d’époque.///Article N° : 3276









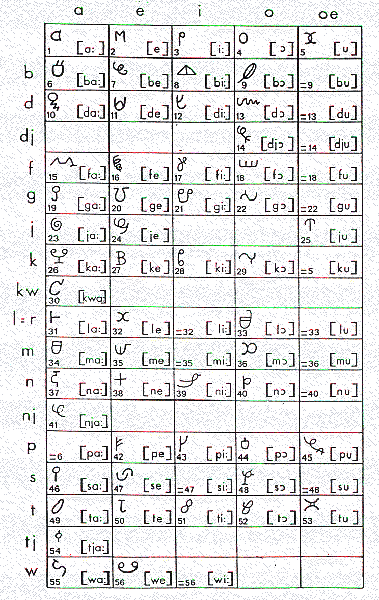










2 commentaires
Quelle est l’origine exacte de Maroni cela vient -il de Marron? Merci à vous
Maroni: Oui effectivement le terme viens de marons, Le Maroni etant le grand fleuve à l’ouest de la Guyane faisant frontiére avec le Suriname il a connu tous les aspects du maronage d’où il tiens son nom. au Suriname les Hollandais ont appelés Marowijne la région (distict) qui s’étend du fleuve Maroni à la riviére Cottica car elle était l’épicentre des révolte marones Ndjuka et Boni? où vie d’ailleur toujours la pluspart de leurs descendants.