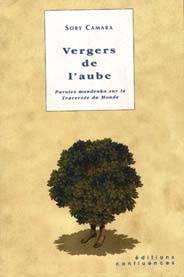L’universitaire est décédé le 27 août 2016. Nous republions ici son entretien avec Africultures en 2009.
Créée en 1999 à Bordeaux par l’éditeur Éric Audinet et le linguiste et historien de la littérature Alain Ricard, la collection Traversées de l’Afrique explore un pan méconnu de la littérature africaine, à travers des textes contemporains ou plus « datés » dont l’anachronisme un peu décalé peu dérouter ou surprendre le lecteur. Rencontre avec Alain Ricard qui analyse le propos de cette collection hors norme.
Qu’est-ce qui a motivé la création de la collection Traversées de l’Afrique ?
En 1997, le Centre régional des lettres (ancien Arpel, Agence régionale pour l’écrit et pour les livres en Aquitaine) publiait une revue intitulée Cahier du centre régional des lettres pour laquelle il m’avait demandé de faire un numéro sur l’Afrique. J’ai réuni à cette occasion des textes anciens peu connus, comme ceux de François Le Vaillant sur les Hottentots plutôt centrés sur les voyages et des textes d’auteurs contemporains comme Kangni Alem. J’ai eu envie de poursuivre ces recherches et cela m’a donné l’idée d’une collection. L’éditeur bordelais Éric Audinet qui avait créé sa maison d’édition en 1994 était intéressé par une collection sur l’Afrique. Je lui ai donc proposé la collection Traversées de l’Afrique qui envisage la traversée dans le voyage, mais aussi la traversée des textes, des langues et des genres. Nous voulions faire quelque chose qui ne soit pas dans le formatage francophone ni dans le formatage politiquement correct en présentant des traductions inédites ou des textes appartenant à des genres difficiles.
Qu’entendez-vous par « formatage francophone » et « politiquement correct » ?
À l’époque je voyais émerger plusieurs collections dites « africaines » chez divers éditeurs comme celle de Bernard Magnier chez Actes Sud, celle de Jean-Noël Schifano chez Gallimard (Continent Noir) ou encore les éditions Dapper où j’étais consultant. Le propos de ces collections était intéressant mais je trouvais que tout un pan de l’expérience du rapport à l’Afrique n’était pas pris en compte et que cette dimension historique qui avait beaucoup contribué à former les relations avec ce continent devait être mise en avant.
Avec Éric, nous avons pensé qu’il y avait peut-être place dans cette dynamique pour faire des choses un peu plus expérimentales avec des auteurs quand même connus mais inscrits dans le contemporain avec une démarche un peu distanciée.
Éric Audinet, par ailleurs poète et romancier, avait une exigence de qualité d’écriture et nous nous étions fixés pour règle de ne publier que des textes qui pouvaient fonctionner directement pour un lectorat nourri de littérature contemporaine.
Comment avez-vous choisi les premiers ouvrages publiés ?
J’avais, au fil de mon parcours, réuni des textes traduits de langues africaines, des textes difficiles et étonnants tout à fait aptes à répondre à notre exigence de qualité. On a commencé par Au temps des cannibales, réunissant les traductions de deux romans traduits du sesotho par Victor Ellenberger, futur traducteur de Chaka, publié chez Gallimard en 1940. Ces textes, issus de la tradition orale, appartiennent au corpus de la littérature sotho connue des écoliers et du public lettré sotho.
Nous avons ensuite publié Vergers de l’aube (2001), regroupant des textes de Sory Camara, professeur d’anthropologie à Bordeaux, par ailleurs Grand prix littéraire de l’Afrique noire en 1976 pour Gens de la parole, ouvrage de référence sur les griots. Ces textes qui sont une fascinante immersion dans la parole des griots mandingues ont la particularité d’avoir été écrits par un anthropologue sous le prisme de la fiction. Dernier maillon de la chaîne de tradition mandingue, Camara l’enseigne à l’université et en même temps la met par écrit sous forme de fiction en la re-créant en français. Il a un exceptionnel talent de conteur et aussi d’écriture. Ses textes sont un troublant mélange des genres, entre l’anthropologie et la fiction et ce statut double et fascinant pose une interrogation sur l’écriture en français d’aujourd’hui car il les aborde à partir d’une position d’anthropologue.
C’est une forme de transposition subjective de l’héritage mandingue
Oui. Cette approche pose des questions épistémologiques dans lesquelles Sory ne veut pas rentrer tout en étant parfaitement conscient de la transgression majeure. Et c’est cette transgression qui fonde peut-être la littérature francophone. Quand ils sont lus à voix haute, ses textes plaisent beaucoup parce qu’ils ont une sorte de musique et un langage qui crée quelque chose d’assez surprenant.
On pourrait dire que c’est de l’anthropologie post-moderne mais le fait qu’un anthropologue écrive des romans et considère qu’au fond cela relève aussi de son travail d’anthropologie, pose une grande question théorique à laquelle Sory Camara répond en partie par la transgression. Amadou Hampâté Bâ est dans le même cas de figure : où se situe le texte original peul dans ses textes que nous lisons en français ?
C’est toute la question posée par la transposition de l’oralité à l’écriture
Oui ça la pose exactement. Mais Hampâté Bâ comme Camara, se situent dans la discipline ethnologique tout en faisant une transgression fondamentale des frontières de cette discipline.
Nous avons publié le texte de Thomas Mofolo, considéré comme le premier roman d’Afrique subsaharienne. Intitulé Moéti oa Bochabela – dont le titre signifie littéralement l’homme qui marche et qui va vers l’endroit où se trouve le soleil – il a été traduit-très mal- en anglais, puis en français avec comme premier titre Le pèlerin de l’Orient.
J’ai rencontré Paul Ellenberger, le fils du traducteur Victor Ellenberger, et nous avons longuement discuté du titre avant de revenir à sa traduction littérale : l’homme qui marchait vers le soleil levant. Le terme pèlerin évoque à mon sens trop directement la littérature protestante de piété et le texte de John Bunyan, Le voyage du pèlerin, traduit dans toutes les langues africaines, qui définit le calvinisme des puritains.
Chez Mofolo, il est question de voyage, d’Orient, de Sion et de christianisme mais jamais de façon explicite. Il revendique à sa manière une africanisation du christianisme. Il y a chez lui une pensée du rapport de l’Afrique au christianisme qui est l’un des grands enjeux des 20e et 21e siècles. En Afrique du Sud, le parcours de Desmond Tutu, la commission Vérité et réconciliation, ne peuvent se comprendre que par rapport à cette appropriation du Christianisme par les Africains, dont l’uvre de Mofolo est un premier témoignage. Le problème c’est qu’on ne pas voulait pas reconnaître la pertinence de ce texte pour diverses raisons : sous l’apartheid, Mofolo ne pouvait être compris et son texte était initialement diffusé par des gens qui représentaient les églises installées et qui ne voulaient pas en faire des lectures sécessionnistes ou africanistes. Ce n’est que tardivement qu’il a fini par être reconnu comme le plus grand écrivain de l’Afrique Australe. Il y a d’ailleurs un prix littéraire à son nom en Afrique du Sud.
Traversée de l’Afrique rassemble des textes très différents qui font appel à des auteurs africains comme Thomas Mofolo ou Sory Camara ainsi qu’à des auteurs européens comme Michèle Laforest sur les traces du romancier nigérien Tutuola ou de vous-même un carnet de route littéraire sur l’Afrique. Si vous deviez définir la ligne éditoriale de la collection, sur quel axe la placeriez-vous ?
Elle est d’une part basée sur la qualité d’écriture, l’effort d’une écriture engagée et personnelle mais aussi sur une approche littéraire qui consiste à ne pas sacraliser la littérature, à ne pas la réifier mais au contraire à la montrer en train de se faire. J’assume ce choix de présenter des textes hors norme, peut-être un peu difficiles d’accès, mais qui à mon sens complètent un portrait de l’Afrique trop souvent schématique ou manichéen. Nous voulons montrer que les Africains peuvent rire des histoires de cannibales, qu’il y a des anthropologues africains qui font des romans, des écrivains africains qui peuvent être une source importante pour des auteurs français, comme Soyinka l’a été pour moi ou Tutuola pour une romancière comme Michèle Laforest auteur de Tutuola, mon bon maître (2007). Michèle Laforest, qui a sa propre uvre romanesque et poétique, s’est prise de passion pour l’uvre de Tutuola, auteur de L’ivrogne dans la brousse, traduit en 1953 par Raymond Queneau. Elle l’a rencontré, traduit et adapté à la scène. Elle raconte dans ce livre le voyage de Tutuola en France, en l’écrivant à la façon de Tutuola. Ce n’est pas un pastiche, mais une re-création de l’intérieur par une femme, européenne, qui se met dans la peau d’un écrivain africain. C’est là encore une traversée, une transgression qui dit beaucoup de la capacité de Tutuola à mobiliser un imaginaire sans cesse renouvelé. Cette collection a pour ambition de redistribuer les rôles autrement, d’être dans des croisements, certes peut-être improbables, mais toujours pertinents.
Cette ambition peut expliquer en partie la difficulté de visibilité de la collection dont la démarche s’inscrit un peu à contre-courant de certaines idées reçues et tendances. Avec un titre comme Au temps de cannibales, qui peut avoir dans l’inconscient collectif des connotations négatives, vous prenez le risque d’être en porte à faux avec votre lectorat
Oui, mais sur ces questions du rapport à l’Afrique il y a souvent des idées toutes faites, une sorte de paresse intellectuelle souvent réductrice qui ajoute des barrières aux barrières. L’histoire de l’Afrique reste très mal connue. Elle n’est pas beaucoup enseignée en France et il en est de même pour l’histoire de la littérature en Afrique. Ici, on a tendance à tout réduire aux questions de la francophonie et à Senghor. Avec cette collection, qui remet en cause certains schémas, j’essaye de montrer que la littérature africaine est beaucoup plus riche que ce qu’on veut bien nous en montrer, qu’il y a une grande variété d’auteurs et de textes mais que cela demande un petit effort de curiosité. Il me semble important de montrer que les questions africaines sont quand même plus larges que ce que la mémoire établie veut nous en dire.
Il me semblait qu’il y avait place pour des choses un peu plus difficiles qui ont cette vocation de ramener à l’histoire de l’Afrique, aux historiens de l’Afrique, à la tradition orale, aux textes écrits par des Basotho qui racontent des histoires qu’ils ont entendues et qu’ils rapportent avec une certaine distance et de l’humour. On peut se laisser interroger par toutes ces formes d’expression et c’est un peu dommage de ne pas être capable d’être surpris par tout cela.
Il y a désormais un grand intérêt pour l’Afrique, pour ses musiques, ses arts plastiques, et c’est très bien mais d’un autre côté, ce n’est pas pour cela que l’histoire et ce qui pourrait être dérangeant est mieux comprise et plus connue.
Parce qu’ils abordent des thèmes comme le cannibalisme qui ont frappé l’inconscient collectif, ou le Christianisme en Afrique, certains de ces textes peuvent faire écho à des malentendus liés aux imageries véhiculées par la colonisation. Leur publication aujourd’hui peut apparaître un peu saugrenue aux yeux par exemple de quelques auteurs et intellectuels africains. D’où peut-être une certaine réserve quant à leur perception
Oui, nous en avons conscience. Mais c’est aussi une façon de respecter les autres que de penser qu’ils ne sont pas réductibles à nos propres catégories, qu’ils peuvent nous déranger et nous surprendre.
C’est d’ailleurs ce qui a motivé la publication de La formule Bardey (2005), dont je suis l’auteur et où j’ai réuni des textes pour expliciter la démarche de la collection. Ils racontent un certain nombre de voyages que j’ai effectués en Afrique, en lien avec des écrivains. Chaque étape de ces voyages est liée à des uvres. Celle de Tombouctou est en lien avec les travaux de Christiane Seydoux qui a transcrit et traduit des poésies peules du Macina, celle de Dar es Salam au poète Ebrahim Hussein. Ce livre est aussi placé sous le signe de Wole Soyinka auquel il accorde une large part car il reste pour moi quelqu’un qui est toujours dérangeant, stimulant et drôle. J’observe que, pour beaucoup d’écrivains « francophones », curieusement l’uvre de Soyinka est en dehors de ce qu’ils lisent alors qu’il pose des questions constamment renouvelées sur la pratique littéraire, la politique, sur les rapports Nord/Sud. Qui plus est, il ne s’enferme pas dans un genre. Je trouve dommage que les auteurs francophones ne dialoguent pas plus avec lui, d’autant que son dernier livre Il faut partir à l’aube, (1) contient une grande partie consacrée à ce qui se passe en France ou en français.
Le titre de votre collection contient d’ailleurs cette idée de la transversalité qui entend abattre les barrières linguistiques, géographies ou géopolitiques
Oui ! Je me suis longtemps battu pour une vision transversale de l’Afrique, La transversalité c’est ce qui nous invite à sortir du pré carré francophone ou anglophone.
D’où que l’on soit, c’est une chance de connaître l’Afrique à travers Soyinka parce que je trouve qu’il a une intelligence, un humour et une juste distance face aux problèmes du continent.
Que ce soit Mofolo, Tutuola, Camara ou Soyinka, chacun laisse à sa façon un héritage qui concerne toute l’Afrique. Ils nous offrent une pensée, une énergie, des créations qui sont de grands apports de l’Afrique au monde. Soyinka offre une pensée qui réfléchit sur la situation de l’Afrique au 20ème et au 21 ème siècle. De même, Tutuola dans une démarche qui relèverait peut être pour ce dernier de la catégorie de l’art brut. Traversées de l’Afrique donne ainsi quelques pistes sur des pensées de l’Afrique. L’Afrique pense, mais penser, c’est un peu dérangeant pour les formatages. Soyinka comme Mofolo et Tutuola interrogent le rapport au pouvoir, à l’Autre, à la paix, à leur manière et souvent dans leur langue.
Quel sera le prochain ouvrage publié par la collection ?
Nous allonscontinuer avec la traduction – par Xavier Garnier – de deux romans du grand écrivain swahili contemporain, Kezilahabi. Ses romans, Nagona et Mzingile sont très connus en Tanzanie et au Kenya mais pas en Occident où ils sont ne sont pas traduits.
La traduction est l’un des enjeux majeurs de la collection. Pour beaucoup d’auteurs africains, même s’ils maîtrisent parfaitement ces langues, il n’est pas aussi évident que cela d’écrire des textes en français ou anglais. Bien que ça le soit un peu plus pour les nouvelles générations, cela passe aussi par certains renoncements et il me semble important d’exposer ces difficultés justement à travers les traductions. La littérature « dite africaine » est francophone ou anglophone. La démarche de cette collection est de montrer qu’il y a d’autres pans de cette littérature qui ne se limite pas aux registres anglophone et francophone et que nombre d’auteurs préfèrent s’exprimer dans leur langue. Notre objectif est de montrer dans un cas comme dans l’autre que ces langues sont des instruments adéquats pour la fiction. Traversée pour moi signifie aussi traduction.
Les questions africaines ne sont pas réductibles à la question de la diaspora et en France on connaît très mal les penseurs africains qui ne sont pas traduits. Le principal philosophe congolais, Valentin Mudimbe, écrit ses ouvrages théoriques en anglais (préférant le français pour sa fiction et son autobiographie) qui ne sont pas traduits en français. Cette non-accessibilité à des textes importants entretient les clichés de l’Afrique qui ne pense pas.
Le problème, c’est que la pensée de l’Afrique s’exprime majoritairement dans les langues de ses anciens dominateurs
C’est pourquoi, il est important de valoriser le travail d’élaboration original qui s’est fait dans des langues africaines. La question de la traduction est sous-jacente à la collection : elle est même à son origine car j’ai eu accès à des textes traduits avec une très grande rigueur. Les traductions d’Ellenberger reposent sur une écriture précise, concrète qui rend tout à fait ce qu’est le sesotho. Sory Camara est aussi un traducteur prodigieux. L’anthropologie est d’abord affaire de traduction. En France, ces questions sont un peu voilées par la francophonie qui ne se pose pas assez la question pourtant essentielle de la traduction. Mais cela suppose de très bons traducteurs. Beaucoup de gens ont traduit des textes africains, par volontarisme bienveillant, voire tiers-mondiste, mais il faut bien admettre que les résultats sont parfois catastrophiques. Il est difficile de trouver de bons traducteurs kiswahili / français ou sesotho / français. Il faut quand même vivre un certain temps avec les gens, partager suffisamment leur vie pour ressentir les choses au-delà de la langue. Rares sont aujourd’hui les chercheurs – comme Ellenberger qui a passé 40 ans au Lesotho – à demeurer longtemps en Afrique. Pour « habiter » une langue, il faut avoir traduit une multitude de textes allant de la littérature aux chansons, lire ce qu’écrivent les intellectuels qui s’expriment dans cette langue, interroger leur pensée. Or, c’est de moins en moins le cas aujourd’hui par rapport aux langues africaines. En France, on fait comme si on avait tout compris ! Il y a une sorte d’aplatissement colossal de la réalité africaine qui fait que l’on passe à côté de choses essentielles. J’ai rencontré récemment lors d’une mission à Lubumbashi, une jeune collègue tchèque, Alena Rettova, formée à Prague et enseignant le swahili à l’université de Londres. Elle avait beau avoir fait des études de swahili, l’enseigner à l’université, c’était son premier séjour en Afrique ! Voilà bien une dimension nouvelle du rapport à l’Afrique !
1. Il te faut partir à l’aube, Wole Soyinka, Actes Sud, 2007///Article N° : 8759