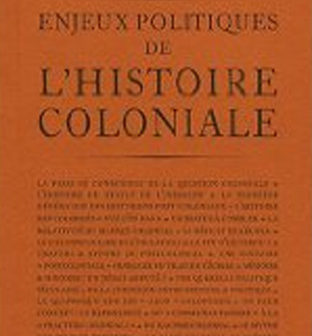Dans ses mémoires, Charles de Gaulle exprime un dilemme profond en consignant les atermoiements qui ont présidé au triomphe du cartiérisme en France, c’est-à-dire cette volte-face qui en l’espace de quelques années troque un discours (« l’homme blanc est en Afrique pour y rester parce que son intérêt lui commande d’y être et d’y rester ») pour son contraire (« la Corrèze avant le Zambèze »). De Gaulle, qui comme une grande partie de la classe politique française, a accompagné Raymond Cartier dans ce grand écart politique nous livre son désarroi dans une vision eschatologique de fin d’empire qui en dit long sur le destin de l’histoire coloniale en France : « Quelle épreuve morale ce serait donc pour moi de transmettre notre pouvoir, d’y replier nos drapeaux, d’y fermer un grand livre d’Histoire ! ». Catherine Coquery-Vidrovitch vient justement de rouvrir « ce grand livre d’Histoire » en faisant paraître un petit livre (Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Marseille, Agone, 2009) riche en grandes leçons d’histoire et d’humanité.
Je suis généralement avare de compliments à l’égard des africanistes français pour plusieurs raisons que j’ai analysées dans un essai sur la crise de l’africanisme en France (Africanisme : La crise d’une illusion, 2007). Mais il me paraît important de juger l’ouvrage de Catherine Coquery-Vidrovitch pour son mérite, celui de quitter les sentiers battus du déni, de la repentance et du révisionnisme pour parler de la colonisation sans ambages et sans tabous. Son mérite est aussi de remettre les pendules à l’heure à un moment où en France l’histoire coloniale refait surface alors que les Français s’interrogent sur leur identité à l’aune de la mondialisation, dans le cadre d’une Europe qui s’élargit et d’une France qui se diversifie. Il s’agit ici donc de l’histoire coloniale française vue de France. L’auteur présente de manière circonspecte tous les maux dont cette histoire a souffert, de l’émiettement au déni en passant par la surenchère mémorielle et la confusion entre savoir et mémoire. Parfois, son plaidoyer s’assimile davantage à une leçon d’histoire lorsque par exemple elle brosse un tableau érudit de la « traite négrière » pour expliquer ensuite l’oubli, ou plutôt le déni, dont le traitement de la traite a fait l’objet durant une décennie, 1980-1990, qui correspond étrangement à la montée de la gauche au pouvoir en France.
Enjeux politiques de l’histoire coloniale bat en brèche les dogmes aux relents racistes qui continuent à encadrer la prise en compte de l’histoire de la France en montrant qui ni « acte de repentance » ni « affaiblissement de la conscience nationale », restituer l’histoire coloniale dans le cadre de l’Hexagone est une obligation si l’on veut, sans tabous ni anachronismes, comprendre les enjeux de l’histoire en France. L’auteur fait preuve de ce que j’appelle une « vigilance sémantique » qui consiste à épingler les dérives sémantiques, les contresens et les termes qui véhiculent, sans souvent que ceux qui les utilisent s’en aperçoivent, des notions racialistes que l’on croirait d’un autre âge. Elle explique avec précision et pédagogie ces « gros mots » en vogue aujourd’hui en France dans les discours politiques, les conversations de table et les pamphlets publiés tous azimuts, de la droite souverainiste à la gauche jacobine, pour défendre la République. Ainsi sa croisade contre les expressions « arts premiers » et « arts nègres » qui continuent à qualifier le troisième musée le plus visité de France. Qu’entend-on par « communautarisme », « repentance », « postcolonialité », se demande t-elle. Pour elle ces mots tout faits sont devenus des poncifs commodes que l’on brandit comme autant d’épouvantails pour mobiliser les opinions dans des projets idéologiques et réduire au silence ceux qui disent non à la France intolérante. Elle les passe donc tous en revue en en soulignant les contresens partisans et les dévoiements. De même son explication de la « fracture coloniale » me paraît judicieuse. Pour elle cette notion demeure une construction contemporaine et non pas, comme on le fait accroire dans les médias et les cercles savants, un simple héritage du passé (page 165).
En formulant donc la question fondamentale de l’inclusion de l’histoire de la colonisation et de l’esclavage colonial dans le patrimoine historique « national » de la France, Catherine Coquery-Vidrovitch lève le voile sur un objet et un sujet passionnels. Elle explique bien qu’il existe sur ce champ une véritable joute politique entre deux courants irréductibles, celui qui se réclame du « postmoderne » ou du « postcolonial » et le courant nationaliste qui tend à observer « l’aventure coloniale » (terme que ce courant affectionne) du petit bout de la lorgnette, c’est-à-dire du point de vue hexagonal. Son but n’est pas de prendre parti ni de renvoyer ces courants dos à dos, mais de se cantonner à comprendre, pour pouvoir ensuite expliquer, travail que l’on attend de toute historienne digne de ce nom. Expliquer pour elle, c’est d’abord présenter l’historiographie coloniale en France, ensuite démontrer que l’histoire coloniale doit faire partie intégrante de l’histoire et du bagage mémoriels de la France.
Il est vrai que la récurrence de tropismes hégéliens dans le discours politique en France aura contribué, plus que tous les travaux africanistes, à banaliser l’intolérance vis-à-vis du domaine colonial. Les colonies n’étaient pas la France, nous rebat-on les oreilles, mais l’expansion du génie français. Mais ne sont-ce pas les mêmes qui nous assurent que Vichy n’était pas la France, mais la « négation de la République » ? Lors du procès Papon on a vu toute la classe politique française taire ses différences et présenter un front commun contre la repentance. Je me souviens encore de Jospin déclarant au Palais Bourbon le 21 octobre 1997 que le procès de Maurice Papon était celui d’un homme et non d’une époque. Devant un hémicycle acquis à la cause, il affirmait qu’il n’y a « pas de culpabilité de la France parce que Vichy était la négation de la France et en tout cas la négation de la République ». Ses propos seront relayés dès le lendemain par le chef de file de l’opposition, Philippe Séguin, revendiquant que l’on déparie une bonne fois pour toutes Vichy et France. Vichy n’était donc ni la France ni la République. L’historien américain Robert Paxton a pourtant démontré l’inanité d’une telle affirmation dans des ouvrages remarquables, notamment Vichy France : Old Guard and New Order (1972 ; paru l’année suivante aux éditions du Seuil sous le titre de La France de Vichy).
La répudiation de Vichy comme l’antithèse de la République opère dans un registre hagiographique où la République est couronnée de gloire et d’une sorte de sainteté laïque. Quand on tourne le chapitre de Vichy pour se retrouver en Algérie, c’est le même réflexe qui taraude le politique et l’historien en France. Comment la patrie des Droits de l’Homme s’est-elle métamorphosée en bourreau ? Comment est-elle passée étrangement du sympathique Docteur Jekyll au démoniaque Monsieur Hyde ? Et pourtant la République a fossoyé à Sétif (1945) comme elle l’a fait à Thiaroye (1945) et à Madagascar (1947), et ailleurs. Il y a donc, d’une part, cette détermination à passer par pertes et profits tous les errements de la République (puisque la République est toujours du côté de ceux qui revendiquent la liberté et l’égalité) et, d’une part, cette répugnance à traduire dans les lois et dans les faits les idéaux universalistes et égalitaires de la République. L’historienne américaine Élizabeth Ezra l’a articulé avec clarté en écrivant : « it is the atrocities of its colonial past that France represses, retaining only sanitized memories of the pomp and circumstance, the valor and the glory of France’s mission civilisatrice » (The Colonial Unconscious : Race and Culture in Interwar France, 2000).
La contribution la plus importante de l’ouvrage de Catherine Coquery-Vidrovitch est justement de montrer que la France a toujours été coloniale. Elle l’exprime d’ailleurs avec beaucoup plus d’emphase et de courage que je ne saurais le faire en écrivant que « l’âme de la France a toujours été métissée » (page 145, c’est moi qui souligne). Même si elle ne fait pas mention des concepts clés de « la plus grande France » et de « la France nouvelle » pour étayer son argument, elle épingle du moins la grande contradiction républicaine en démontrant que « l’universalisme à la française reste hostile à la différence » (page 167). Les mots, puisqu’elle met leur mésusage sur la sellette, ont leur importance et il est heureux qu’elle ne tombe pas elle-même dans ce travers. Dans la phrase citée ci-dessus, le réflexe hexagonal aurait pu la conduire à écrire « reste hostile à l’Autre » (c’est moi qui souligne). Il n’y a pas ici place pour « l’Autre » puisque la France par définition est plurielle (expression hélas émasculée pour avoir été galvaudée), et cela l’auteur l’explique avec conviction et grâce à une approche qui se veut aussi didactique. Autre preuve : le choix de retracer les racines de l’esclavage et du commerce négrier pour en dégager des décombres de l’histoire les faits essentiels qu’une certaine tradition révisionniste en France a souvent occultés. De même le recours, lui aussi didactique, au concept de « postcolonial » pour expliquer comment la « société et la culture françaises sont pétries d’héritages coloniaux multiples, à la fois totalement intégrés et, sinon niés, du moins ignorés par la quasi-totalité de nos concitoyens » (pages 100-101). Tout cela, Coquery-Vidrovitch le fait avec une grande dose de lucidité et de raison.
L’ouvrage n’est cependant pas sans défauts. Ayant établi à l’instar de Hannah Arendt que le colonialisme doit être rangé parmi les trois fléaux, les trois totalitarismes du XXe siècle (les deux autres étant le fascisme ou nazisme et le communisme), Coquery-Vidrovitch s’évertue paradoxalement à vouloir sauver le bébé en se débarrassant des eaux sales du racisme colonial. Son explication de ce que Pierre Tévanian a analysé avec beaucoup plus de perspicacité comme étant le « racisme républicain » n’est pas sans failles. C’est dans la création du « vouloir vivre en commun » à la Renan, du « nous » français (l’équivalent américain de « We the People »), sous la IIIe République, que naît le racisme. Elle a donc raison d’établir le racisme avant tout comme une logique coloniale dans le droit fil des idéaux prométhéens du « white man’s burden » de Kipling. Pourtant il est dommage de trouver dans l’ouvrage les débris d’une histoire qu’elle s’attelle à enterrer. Comment autrement interpréter la phrase suivante : « Bien sûr, tous les colons n’étaient pas racistes, tous les colonisateurs non plus » (page 152) ? Ce simple aveu prouve la difficulté pour l’historienne de se dégager totalement des enjeux de sa société. Le racisme, on le sait, n’a rien à voir avec les sentiments individuels, mais existe en tant qu’idéologie dominante qui se traduit par des lois, des discours, des pratiques, bref une culture raciste. La présence de Français de bonne volonté n’a pas empêché ni le Vel d’Hiv ni les lois anti-juives. Les résidents français anti-coloniaux, je concède qu’il en ait existé en Algérie, n’ont empêché ni les tortures ni les viols des femmes ni les meurtres d’enfants. L’histoire a connu très peu de John Brown, cet Américain blanc qui organisa une série d’insurrections contre les Blancs, allant même, dans son exécration de l’esclavage des Noirs, jusqu’à massacrer plusieurs planteurs blancs. Jugé et pendu en Virginie en 1859 (à l’âge de 59 ans) John Brown sera jugé encore plus sévèrement par l’histoire, non pas comme une anomalie mais comme un illuminé (madman). Il n’y pas eu de John Brown dans l’enfer colonial français. Tout au plus a t-il existé ici et là ce qu’Albert Memmi appelle un « colonisateur de bonne volonté », un personnage tragique, apathique, plongé fatalement dans l’aporie : « Lorsqu’il lui arrive de rêver à un demain, un état social tout neuf où le colonisé cesserait d’être un colonisé, il n’envisage guère, en revanche, une transformation profonde de sa propre situation et de sa propre personnalité. [ ] il espère continuer à être Européen de droit divin dans un pays qui ne serait plus la chose de l’Europe [ ] ». En fait, continue Memmi, « le colonisateur de bonne volonté est condamné au seul choix qui lui est permis, non pas entre le bien et le mal, mais entre le mal et le malaise ».
Je ne range pas Coquery-Vidrovitch du côté des promoteurs de la loi du 23 février 2005, notamment ceux qui y ont glissé le fameux article 4. Catherine Coquery-Vidrovitch ne fait pas l’apologie de la colonisation. Comment le ferait-elle, elle qui eu le courage dans l’un de ses plus importants travaux d’exposer les abus des compagnies concessionnaires françaises au Moyen-Congo en montrant qu’ils ne différaient en rien de ce qui se passait dans l’enfer léopoldien, sur l’autre rive du fleuve Congo ? Ce que je soutiens, en revanche, est cette tendance à vouloir à tout prix traiter le colonialisme comme s’il s’agissait d’une entreprise qui aurait mal tourné, d’en regretter les dérives sans souligner que c’est dans la nature de la colonisation de produire des tas de cadavres, les tortures, les mains coupées, les femmes violées et de réduire, selon le mot de Césaire, « l’humanité au monologue », en dévaluant l’homme et en surévaluant l’or.
Ce monologue fait qu’aujourd’hui l’africaniste français ou n’importe quel historien français qui s’aventure sur le domaine de la colonisation prend rarement la peine de consulter ce qui se produit ailleurs que dans l’Hexagone et certainement pas les travaux des chercheurs africains basés en Afrique. À trop vouloir faire de l’histoire coloniale une histoire francocentrique, on oublie hélas qu’il s’agit également de l’histoire de l’Afrique. Voilà pourquoi Enjeux politiques de l’histoire coloniale apparaît parfois comme un recueil de débats franco-français. L’auteur plaide bien pour une inclusion de la voix des vaincus en insistant qu’il faut « s’interroger sur la vision des vaincus » (page 36) et « faire parler le colonisé » (page 39), une posture ventriloquiste digne d’un Placide Tempels. Comment cela serait-il possible alors qu’il existe en France une consubstantialité telle entre histoire et politique que faire parler les vaincus reviendrait à réduire les dimensions de l’Hexagone ? Pour les Africains et leurs descendants en France cela ne serait qu’une supercherie de plus à un moment où, comme le préconisent d’éminents savants tels que Valentin Mudimbe et Paulin Hountondji, c’est une « prise de parole » qui est à l’ordre du jour. Libérer la parole africaine, selon l’historienne française Armelle Cressent, porte en soi un drame : le « drame que nous pressentons », écrit-elle, est que les Africains « se mettent à parler de nous, non pas pour faire une ethnologie du Larzac, comme ce fut à la mode dans les années 70, mais pour nous surprendre au cur des grands massacres ».
Catherine Coquery-Vidrovitch y fait d’ailleurs rapidement allusion en se demandant si « La France doit [ ] déterrer ses cadavres » (page 128). Le sous-entendu ici est qu’il s’agit de cadavres coloniaux dont les tombes aussi bien que la mémoire dispersés aux quatre vents ne sont plus que vagues souvenirs. À Madagascar, où la tranche de 0-25 ans constitue la grande majorité de la population, qui se souvient de Moramanga ? L’histoire de l’Afrique ayant été criminellement prise en otage en France, on ne s’étonnera pas du travail acharné qui a consisté à effacer la mémoire des victimes des massacres de la France à Moramanga. Mais les massacres ne se sont pas arrêtés là et c’est à ce tournant que j’attendais le plus l’ouvrage de Catherine Coquery-Vidrovitch qui, fidèle émule des Annales, sait que l’histoire est avant tout une « science » du présent. Pourtant, nulle allusion aux massacres perpétrés par la France au Rwanda (1994), au Congo (1997) et à Abidjan (2004) où en novembre l’armée française tire sur une foule pacifique qui manifeste contre les ingérences de la France et sa poursuite d’objectifs néocoloniaux dans un pays souverain.
Si la France ouvre avec peine et réticence le livre noir du colonialisme, comment saurait-elle même accepter l’idée que les indépendances n’ont pas tourné la page des abus, des complots et des massacres, que le pays des Droits de l’Homme continue au XXIe siècle à bafouer l’humain pour assurer son hégémonie culturelle et son accès aux matières premières dans ses anciennes colonies ? C’est sur ce terrain-là, et non pas celui de la colonisation, que les jeunes Africains et les jeunes Français Noirs veulent aujourd’hui engager ce débat sur notre histoire mutuelle et ses enjeux.