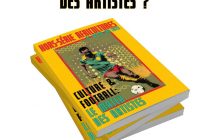Lancé en 2006, WikiAfrica est un projet d’encyclopédie libre qui africanise Wikipedia en apportant la voix de l’Afrique sub-saharienne à travers différents réseaux, recherches, publications et événements. Première partie d’un entretien avec Iolanda Pensa, directrice scientifique du projet. La deuxième partie de cet entretien est publié dans l’article n°8455 et la troisième dans l’article n°8484.
Pouvez-vous nous parler du projet WikiAfrica, le contexte dans lequel il a été engendré, la structure qui le porte ?
WikiAfrica est un projet conçu par lettera27, il a demarré en 2006 en collaboration avec Wikimedia Italie. WikiAfrica travaille sur l’Afrique sub-saharienne (l’aire géographique sur laquelle lettera27 a décidé, à présent, de se concentrer), les objectifs du projet coincident par ailleurs avec la mission de la fondation : soutenir l’accès aux savoirs, le partage des connaissances, l’alphabétisation et l’instruction. WikiAfrica africanise Wikipedia. Cela est le but et le leitmotiv du projet.
Que signifie, pour vous, l’idée d’africaniser Wikipedia ?
Cela peut effectivement signifier plusieurs choses. Pour lettera27, africaniser Wikipedia signifie avant tout mettre un focus sur l’Afrique. WikiAfrica encourage tout le monde à contribuer, car l’Afrique n’est pas seulement un territoire, une identité ou une idéologie, mais aussi des connexions, des interférences, et des déplacements. L’Afrique fait partie de la vie de tout un chacun.
Africaniser Wikipedia signifie aussi partager l’utopie de la plus célèbre encyclopédie libre en ligne. Wikipedia n’est pas un site parmi d’autres. C’est la plus grande organisation no profit existante au monde et un puissant canal de production et de distribution de savoir. Avec ses 265 versions linguistiques, plus de 2 683 000 articles pour l’édition anglaise, 746 000 pour la française et 527 000 pour italienne, c’est une plate-forme ouverte et internationale, capable de donner de la visibilité et d’héberger des contributions provenant de la planète entière. Wikipedia est le quatrième site le plus visité au monde car il est riche en contenu, dynamique et capable de mobiliser un nombre croissant de personnes. Elle se différencie des autres encyclopédies existantes car toute sa documentation est couverte par une libre licence. La libre licence est une forme de copyright où les droits et la paternité sont reconnus à l’auteur mais dont la distribution, la création d’uvres dérivées et l’usage commercial sont permis, c’est donc un outil éducatif accessible à tous et gratuit. Les savoirs diffusés dans Wikipedia produisent le plus grand impact sur le « mainstream » et WikiAfrica prend appui sur cette ressource surprenante parce qu’elle est gratuite, simple et économique.
Enfin, africaniser Wikipedia signifie participer. Wikipedia n’est pas seulement l’une des sources d’informations les plus utilisées et critiquées au monde, mais aussi l’un des plus importants espaces contemporains de production et de négociation des savoirs.
Mais il convient de faire un pas en arrière. Accès aux savoirs et partage des savoirs ne sont pas des objectifs universellement acceptés, bien au contraire. Historiquement, savoir coïncide avec pouvoir. Détenir des informations que d’autres ne possèdent pas est une façon d’imposer sa propre force pour gagner des positions sociales et économiques, et pour conquérir une place dans une hiérarchie. Bien des structures sociales se sont organisées et s’organisent en utilisant à son avantage les secrets et la parcellisation des informations. Ainsi, soutenir l’accès aux savoirs signifie croire au fait que le savoir est un droit. Considérer la connaissance comme étant partie de la richesse de tout le monde, signifie déclarer que chaque personne est importante, qu’elle a quelque chose à dire et qu’elle mérite un espace pour s’exprimer. Pour lettera27 alphabétisation et instruction sont profondément liées aux sources et aux canaux de production et distribution des savoirs. Le travail de la fondation se lie ainsi à Access To Knowledge (A2K), User-Generated Content (UGC), open access, libres licences, Creative Commons, social networking, web 2.0.
Lorsque l’on parle d’accès aux savoirs, de partage des connaissances et d’Afrique, la question suppose encore plus de nuances. Etablir la distinction entre cultures écrites et cultures orales a été une façon pour l’Histoire d’inventer les différences de cultures et d’affirmer la supériorité de certaines d’entre elles, condamnant le continent africain à un héritage et une contemporaineité essentiellement orales, cela indépendamment de son passé et présent réels. L’ethnicisation de l’Afrique a simplifié des situations complexes pour les organiser en chapitres et fournir des instruments de contrôle. La simplification du savoir par son ethnification a eu un impact si violent sur l’Histoire, qu’elle a été instrumentalisée par les protagonistes mêmes de cette histoire. Nier le droit à la connaissance et croire que des cultures ne soient pas en mesure d’utiliser certains langages a profondément limité l’expression des groupes sociaux et leur interaction avec le reste du monde. On parle souvent de l’image de l’Afrique, de comment elle est détournée et véhiculée indirectement par le soi-disant Occident. L’usage d’une plate-forme commune comme celle que peut représenter Wikimedia permet de re-négocier une histoire commune, racontée par plusieurs voix. La participation peut rendre fluides des structures de savoir désormais figées. Une fois qu’on est publié, à travers l’anonymat, la distinction entre les personnes, les races, le sexe et les classes sociales est neutralisée. Ce qui devient central c’est d’être là : pouvoir être en ligne non seulement en tant que consommateurs de contenus mais aussi en tant que producteurs. L’Afrique est un point d’observation sur le monde et ses changements. Parler de l’Afrique est une façon de parler du monde, pour parler de tout un chacun à tout le monde, en partant d’une perspective qui a été amplement isolée et sous-estimée depuis longtemps.
Dans sa version italienne, Wikipedia appelle les articles : « voci », « voix ». Donner sa voix à l’Afrique signifie donner la parole à tout le monde, en demandant à celui qui sait de partager son savoir et en rappelant à celui qui ne sait pas de savoir, qu’en réalité, il a une voix et beaucoup à dire.
A travers une approche historiographique, la participation enrichit tous les types de contenus et offre de nouvelles perspectives. Un passionné de Chicago peut contribuer aux articles sur les études post-coloniales et un étudiant de Bamako peut améliorer l’article sur Léonard de Vinci en insérant par exemple dans la bibliographie un texte écrit par un professeur de Karthoum. Rendre accessible de la documentation sur Wikipedia signifie rendre accessible à tout le monde des informations de référence qui ne sont pas forcément universellement connues. A la différence de Google, Wikipedia ne sélectionne pas les informations par un algorythme : elle présente des pages qui offrent des informations et des liens rédigés par une communauté. Cela signifie qu’il y a de la place pour des sites, des liens, des détails qui peuvent offrir un portrait articulé du savoir, sans faire converger le trafic d’Internet exclusivement dans les hub. Wikipedia est déjà dans son essence un « hub », son contenu peut ne pas l’être. On peut soutenir WikiAfrica en publiant n’importe quel contenu dans n’importe quelle langue, sur Wikipedia il n’y a pas de restrictions.
A travers ses financements, lettera27 a soutenu en particulier de nouvelles recherches et de nouveaux contenus qui enrichissent le portrait de l’Afrique disponible en ligne, en offrant notamment une image articulée et éloignée des stéréotypes. Biographies, revues, routes des migrants, artistes, auteurs, institutions culturelles, villes, musique, cinéma, littérature sont une partie des domaines sur lesquels les partenaires de la fondation ont travaillé.
Parmi les contenus sur lesquels vous avez travaillé, vous avez évoqué les biographies en premier lieu, pourquoi ?
Je parle avant tout de « biographies » car donner la juste place aux protagonistes est vraiment une question centrale. Wikipedia est anonyme mais l’Afrique ne l’est pas. La culture de l’Afrique a longtemps été associée à l’anonymat. La présence de prix Nobel sur Wikipedia n’est pas suffisante, ce n’est pas un prix suédois qui va enrayer l’anonymat des protagonistes du continent. Cela n’est pas suffisant : il faut plus de biographies, plus de personnes, plus d’admirateurs qui soutiennent les auteurs et les intellectuels dans lesquels ils croient. Car, enfin, derrière les savoirs il y a des personnes, et faire connaître au monde leur travail permet de « donner cela pour monnaie courante ». « Donner une chose pour monnaie courante » est l’une de mes expressions préférées. Je l’aime bien car c’est un objectif un peu trivial, qui n’a rien à voir avec l’approfondissement et la spéculation. J’ai rencontré lettera27 lorsque je travaillais sur ces questions : pourquoi chaque fois que l’on organise une exposition d’art contemporain africain l’on déclare que c’est la première et la plus importante ? Pourquoi dans la plus grande partie des introductions aux livres sur l’Afrique on peut lire qu’il est nécessaire de faire connaître la richesse du continent à un plus vaste public ? Pourquoi chaque fois que l’on organise quelque chose liée à l’Afrique, on se considère comme des pionniers ? J’ai coordonné un numéro de la revue « Africa e mediterraneo » sur l’histoire de l’art contemporain africain : l’idée était de documenter comment le concept d’art contemporain africain a été interprété à travers expositions, colloques, publications, revues. Ce n’est pas un concept nouveau et c’est précisément le fait que l’on n’est jamais les premiers qui m’intéressait. Ainsi la bibliographie de ce numéro de la revue a été faite sur Wikipedia, en italien, à la rubrique « arte contemporanea africana »(art contemporain africain). J’ai publié la documentation que j’avais recueillie et j’ai invité savants, chercheurs, commissaires, artistes, étudiants à y contribuer. Ainsi, si les traces des projets précédents sont même sur Wikipedia, peut-être que l’on arrêtera de répéter toujours les mêmes choses. Et l’on pourra enfin se concentrer sur autre chose, quelque chose de différent et qui va plus loin.
Mettre du matériel sur Wikipedia est un peu comme rendre obligatoire une étude de faisabilité sur ce que l’on est en train de faire, obliger tout le monde à se confronter avec ce qui existe : « donner pour monnaie courante » les informations de base et utiliser son propre travail pour aller de l’avant, sans s’embourber dans la vieille rengaine : « il faut faire connaître les informations de base à un plus vaste public ».
Cela a été ma façon d’utiliser Wikipedia, mais il en existe beaucoup d’autres. Au Cameroun, par exemple, il est difficile pour les étudiants d’avoir beaucoup de livres scolaires. A Douala le climat est si humide que le papier se détériore à chaque saison des pluies. En plus, les livres scolaires racontent plus l’histoire de la France que celle du Cameroun. Avoir une riche documentation sur Wikipedia peut être une façon de contourner l’obstacle. Si les téléphones portables pouvaient par exemple permettre de consulter les articles de Wikipedia gratuitement pour les lire à haute voix, enseignants et étudiants en tireraient un grand bénéfice. La diffusion de la téléphonie mobile est surprenante en Afrique et il vaut toujours mieux utiliser les outils existants pour accroître l’instruction, l’alphabétisation, le partage des connaissances et l’accès aux savoirs.
Arrêtons-nous un instant sur la réalisation concrète du projet : le choix et la qualité des contenus, et le système de validation des informations interactives. Comment tout cela fonctionne-t-il ?
Si lettera27 veut avoir un quelconque impact, ce n’est pas la fondation qui doit soutenir WikiAfrica, mais ce sont les usagers et les institutions qui participent à Wikipedia qui doivent la soutenir. lettera27 invite et encourage usagers et institutions à participer à Wikipedia en communiquant sur le projet, en facilitant le reversement des archives sur Wikipedia, en promouvant l’adoption de copy lefts qui permettent la diffusion et la migration de contenus, en demandant aux artistes de donner des oeuvres à Wikipedia, en soutenant la formation, et enfin en finançant des recherches qui rendent accessible une image articulée et dynamique des savoirs sur l’Afrique. Tout le monde peut contribuer librement : ni lettera27, ni WikiAfrica ne contrôlent les contenus, ni veulent les isoler ou les signer. Mais WikiAfrica facilite la participation. L’image que nombre de personnes ont de Wikipedia est un peu confuse. Il y a des personnes qui considèrent que ce n’est pas un outil fiable, d’autres qui critiquent le fait que n’importe qui puisse y participer, d’autres encore qui racontent qu’ils ont essayé d’y publier quelque chose mais on le leur a immédiatement retiré.
Wikipedia représente le savoir de celui qui l’utilise, mais attention ! : utiliser Wikipedia ne signifie pas la consulter, mais l’écrire. Le paradoxe est que les experts les plus pointus en art, histoire, anthropologie et Afrique se plaignent que les articles dans leurs domaines sont peu nombreux, de mauvaise qualité et lacunaires. Et bien, qui mieux qu’eux-mêmes pourrait les écrire ? En effet pour le moment, Wikipedia représente ses usagers les plus nombreux : informaticiens, physiciens, chimistes, mathématiciens lesquels, en plus de leurs compétences dans leurs domaines spécifiques, sont des fins connaisseurs de mangas, du Seigneur des anneaux et de séries télévisées. Pour cette raison Wikipedia est une ressource extraordinaire si l’on veut tout connaître sur les hobbits, mais demeure un misérable « hors d’uvre » si l’on veut savoir quelles institutions culturelles travaillent en Afrique. La seule façon de rendre Wikipedia un outil fiable c’est d’y participer. C’est alors qu’émerge la deuxième question centrale : participer à Wikipdia est tout sauf facile.
Comment rentre-t-on les informations sur Wikipedia ?
Wikipedia est un genre littéraire, avec son écriture, ses règles et sa communauté. On peut imaginer Wikipedia comme un grand édifice dont la construction est collective. Chacun peut partager sa brique de savoir en décidant le style, la couleur, la forme, la taille et la place. La majeur partie des personnes qui approchent Wikipedia abandonnent leur brique sur la pelouse. A ce moment-là, un administrateur-maçon passe et s’entrave, il regarde la brique et prend une décision : s’il lui semble que ce qu’il a devant est une belle brique bien luisante, avec une bibliographie et des notes de bas de page qui documentent tous les points de vue et garantissent la neutralité encyclopédique, il y a de fortes chances pour qu’il la traite avec soin : il la placera au bon endroit (en y ajoutant des liens, des catégories et peut-être un rappel dans un portail) et il lui donnera une bonne couche d’enduit en ajustant la structure du texte pour la conformer aux autres articles et en lui donnant le formatage adéquat. Les problèmes naissent lorsqu’il s’agit plus d’un galet que d’une brique (un brève ébauche) ou si l’objet en question a une couleur suspecte. En effet, la première tâche des administrateurs-maçons de Wikipedia est de se débarrasser le plus rapidement possible de briques volées (articles qui utilisent des matériaux couverts par le copyright) et d’identifier les personnes et les sociétés déguisées en briques (spam et publicité qui font leur auto-promotion). Ainsi, pour ne pas encourir le risque que ses efforts soient réduits à néant, il faut au préalable connaître Wikipedia, ses règles et surtout sa communauté. Il faut commencer par observer comment elle fonctionne, visiter les articles bien faits et comprendre comment ils sont structurées, consulter les portails et les projets, chercher les personnes qui s’intéressent aux mêmes sujets, et inviter amis et collègues à en faire autant. Pour avoir un réel impact sur Wikipedia, il faut être une masse critique et WikiAfrica a exactement pour objectif d’activer les usagers et les réseaux afin que l’on atteigne une masse critique capable de transformer Wikipedia en un outil le plus inclusif possible.
Contribuer à Wikipedia signifie devenir actifs sur Internet non pas seulement en tant que consommateurs, mais également en tant que producteurs, négociateurs et distributeurs de savoir. Cela signifie partager ses connaissances : sur Wikipedia mais pas seulement. Apprendre à travailler sur Wikipedia est une compétence qui peut être utilisée dans d’autres espaces ou qui peut permettre la création d’autres espaces. On apprend ainsi à justifier l’importance des contenus que l’on est en train de partager, à travailler avec une approche collaborative, à soutenir le travail d’autres personnes, pour enfin faire partie d’un projet commun où notre propre travail n’est qu’une pierre. On apprend aussi à « éditer » un texte en identifiant les différentes parties du discours (chapitres, sous-chapitres, paragraphes, titres, termes sur lesquels il convient de mettre l’accent, notes) et en formatant les contenus pour les rendre accessibles dans la façon sémantiquement la plus correcte et efficace. A travers Wikipedia on rencontre une communauté et l’on en devient partie prenante, on analyse de façon critique les articles pour en identifier les points de force, les lacunes, les erreurs; en ajoutant des liens, des articles, des catégories, on relie et harmonise son propre savoir avec ce qui existe déjà et avec ce qu’il deviendra par la suite.
Reste le fait que pour beaucoup, il n’est pas facile d’accepter le fonctionnement de Wikipedia. Embrasser l’anonymat, repenser son propre langage pour le mettre au service de tout le monde, distinguer information et opinion, faire place, à travers une approche historiographique, à divers points de vue, identifier et documenter les sources, construire un texte en suivant la structure partagée et partageable par d’autres signifie – même pour celui qui est parfaitement alphabétisé – repenser et re-négocier sa propre manière de s’exprimer.
Cette dernière question nous amène à réfléchir à la mobilisation du réseau des collaborateurs et des partenaires susceptibles d’apporter leurs propres compétences et contacts : comment agissez-vous sur cet axe indispensable au projet ? Un projet correspondant en français est prévu et une articulation avec la base de donnée d’Africultures est recherchée. Des initiatives similaires sont-elles prévues avec d’autres opérateurs italiens ? Et si oui, lesquels ?
Pour atteindre ses objectifs, la principale activité de WikiAfrica est exactement celle d’activer usagers et réseaux. Des soutiens potentiels existent sur Internet, en Afrique et en dehors du continent ; il y a des organisations qui s’occupent d’archives et de documentation numérique, des chercheurs, des structures spécialisées sur l’art, la littérature et le cinéma africain (secteurs qui intéressent particulièrement la fondation Lettera27) ; il y a des financeurs et réseaux d’associations qui opèrent déjà de la sorte et qui peuvent être intéressés à créer des synergies. Il est évident que c’est seulement à travers des collaborations individuelles et institutionnelles que WikiAfrica peut avoir un impact.
La première collaboration démarrée par lettera27 pour réaliser WikiAfrica a débuté avec Wikimedia Italie, en 2006. Wikimedia Italie est une association qui soutient Wikipedia en Italie. Il existe une vingtaine de Wikimedia dans les différentes aires géographiques. Leur objectif est d’activer les usagers du monde pour recueillir et développer des contenus éducatifs et les disséminer efficacement. Ces structures travaillent de façon indépendante sous l’égide de la Wikimedia Foundation, l’institution américaine qui a l’hosting des sites appelés « Wikimedia projects » et qui administre Wikipedia en suivant les indications du comité de direction, nommé par les adhérents de l’organisation. Ainsi, dès le début, WikiAfrica s’est structurée à travers la collaboration avec le partenaire qui représente Wikipedia en Italie, et où la Fondation lettera27 a son siège. Collaborer avec Wikimedia Italie signifie collaborer de façon institutionnelle avec Wikipedia et donc, commencer à construire un projet avec les personnes et le réseau le plus actif dans le domaine de l’encyclopédie libre en ligne.
Le deuxième pas a été l’appel à participation massif vers les passionnés de littérature. Wikipedia est un genre littéraire nouveau et celui qui est sensible à l’écriture, dans toutes ses formes, peut facilement saisir la portée d’un espace qui, depuis 2001, s’est tellement développé qu’il est devenu un point de rencontre pour plus de soixante millions de personnes qui le consultent et construisent tous les jours.
Ainsi, pour activer de nouveaux usagers et réseaux, nous avons commencé par construire des partenariats. Nous avons rencontré des personnes référentes dans les organisations, des personnes susceptibles d’être intéressées au projet, nous avons organisé des événements, distribué des informations sur WikiAfrica et financé des initiatives capables de produire de nouveaux contenus.
En particulier, en 2007 et 2008, nous avons soutenu le workshop Ars&Urbis (programme SUD) du centre d’art Doual’art de Douala, au Cameroun, la Chimurenga Library, promue par la revue « Chimurenga » de Cape Town en Afrique du Sud, le festival AfroPixel, organisé par l’association Kër Thiossane à Dakar pendant la Biennale de Dakar, l’organisation Roma Asinitas avec le projet Confini et nous sommes en train de mettre en route une collaboration avec ASA-African Studies Association, et en particulier avec ACASA-Art Council de l’African Studies Association. Durant ASA 2008, nous avons distribué une édition spéciale WikiAfrica Moleskine à plus de 2000 participants, l’idée était d’inviter professeurs, doctorants, chercheurs à contribuer à WikiAfrica en partageant leurs expériences et en informant leurs étudiants.
Nous avons aussi participé à la Biennale de Dakar de 2008 avec une édition WikiAfrica Moleskine qui avait fait appel à des artistes, au Festivaletteratura de Mantoua depuis 2006, aux rencontres organisées par LitCam à la Foire du Livre de Francfort en 2007 et à la Foire du Livre de Cape Town en 2008. Nous avons participé aux conférences CSCL-Computer Supported Collaborative Learning de la State University of New Jersey en 2007 et au meeting des wikipediens Wikimania 2008 à Alexandrie d’Egypt.
Ce qui nous intéresse c’est de construire et consolider des partenariats sur la longue période et créer des synergies avec des structures qui ont des archives riches en contenus et qui effectuent déjà un travail de diffusion d’informations, et avec des financeurs qui puissent partager le travail de WikiAfrica en planifiant des programmes conjoints ; et aussi avec des institution qui produisent déjà de la documentation et qui pourraient la reverser sur Wikipedia ou la rendre accessibles en adoptant une libre licence. C’est pour cela qu’une collaboration avec Africultures et son soutien à WikiAfrica serait très intéressante.