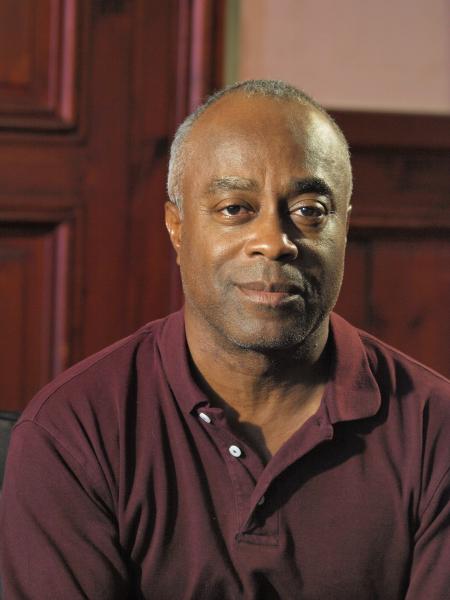Comment définir le cinéma noir ?
Il faut que le film parle de Noirs, bien sûr, et qu’il reflète leurs vécus qui sont multiples. Un film peut être plus ou moins noir, les acteurs peuvent être noirs sans que l’intrigue ne parle des questions noires alors que d’autres vont explorer la conscience noire et mettre les personnages dans une situation où leur ethnicité est un facteur clé de l’intrigue. Certains films vont avoir une vision plus juste de la vie des Noirs que d’autres. Au bout du compte, il faut que le film se suffise à lui-même.
Il est plus compliqué de savoir si un film peut être « noir » sans que le réalisateur le soit, par sa thématique par exemple. L’essentiel c’est que le film parle des Noirs, de questions qui les touchent. Le reste est sujet à caution. C’est un vieux problème que l’on ne va pas résoudre car il y a trop de points de désaccord.
Y a-t-il véritablement une différence entre le cinéma indépendant et le cinéma hollywoodien ? Quelle est la différence pour vos films ?
Oui. Il y a une différence énorme et en même temps, ils sont de plus en plus proches car les écoles de cinéma ont bien changé. Les jeunes diplômés veulent travailler à Hollywood. Ils vont au festival de Sundance pour se faire remarquer par les studios et font des films dans cette veine. Avant, quand c’était impossible, qu’on ne pensait pas pouvoir être accepté, on faisait les films qu’on voulait faire. C’est une autre mentalité. Les gens qui n’ont pas fait d’école de cinéma sont moins dans le compromis, ils font des films différents.
Vous attendiez-vous à ce que les portes s’ouvrent ainsi ?
Non, pas une seconde, ce n’était pas du tout évident. Même si les choses changeaient. Ça a commencé dans les années 60 quand les cinémas ont perdu leur public et pour ne pas fermer, ont voulu passer des films pornographiques. Il y a eu un conflit avec le syndicat des projectionnistes parce qu’on ne pouvait pas projeter un film non-syndiqué. Donc bizarrement, le porno a eu un impact positif, c’était le premier signe de changement, on pouvait faire projeter nos films. Si on remonte dans l’histoire, c’est ce que faisait Oscar Micheaux, il se débrouillait pour montrer ses films. Mais on a dû réinventer la roue, on avait oublié cette partie de notre histoire.
Maintenant les choses changent tellement vite, on dit que faire un film est à la portée de tous, qu’il n’y a qu’à s’y mettre. Mais c’est la distribution qui est très difficile. On peut y passer des années sans se mettre au film suivant. C’est ce qu’ont fait Haile Gerima et Julie Dash, ça les a usés. Parce qu’il faut être sur place pour être sûr que ça se fasse, personne ne le fera à ta place. Avec Internet il y a un nouveau public, la distribution est en train de changer, mais ce n’est pas la même chose. Au niveau des salles, ça n’a pas tellement changé, c’est toujours très difficile.
Pourquoi y a-t-il aussi peu de réalisatrices noires à Hollywood ?
À cause des préjugés, des phallocrates, du sexisme. Je connais une scénariste par exemple, une amie, qui a signé un script en ne mettant que son initiale. Ils ont pensé que c’était un homme. Le retour a été positif, ils appréciaient sa sensibilité. Après plusieurs allers-retours où elle avait retravaillé son scénario, il était temps de signer le contrat de production et comme ils n’avaient vu que son agent, il fallait la rencontrer. Elle raconte que dès qu’elle a passé la porte, dès qu’ils l’ont vue – elle est aussi noire – ils étaient sidérés. Elle a vu le rideau tomber. Ils étaient sciés, comme si un tremblement de terre avait ravagé la pièce. Elle leur dit de ne pas se préoccuper d’elle, que c’était le même scénario. Mais ils ne s’en sont pas remis, ils n’ont pas signé. Qu’est-ce que ça veut dire ? Si encore ils n’avaient pas aimé le scénario, alors qu’ils ne lui demandent pas de retouches, mais qu’ils le trouvent bien jusqu’à la rencontrer
Je ne sais pas si ça répond à la question. J’en ai parlé à Julie Dash et elle trouve ça difficile de trouver du travail. Ce sont les hommes qui ont le pouvoir.
Ce sont aussi les Blancs qui ont le pouvoir et pourtant les hommes noirs y arrivent.
Oui, ce qui est contradictoire car historiquement, les femmes noires ont moins de mal à trouver de travail que les hommes noirs. Cette inversion est déconcertante, je ne sais pas pourquoi c’est comme ça.
Est-ce que certains films vous ont ouvert des portes ?
Pas tellement pour moi mais pour d’autres cinéastes, oui. Les films de Spike Lee et de John Singleton ont très bien marché et les jeunes cinéastes les ont pris pour modèles et les ont imités. Donc ils ont ouvert des portes. Mais pour nous qui sommes connus pour des films différents, ça n’a pas changé grand-chose.
Est-ce que la reconnaissance de ce que l’on appelle votre chef-d’uvre, Killer of Sheep, vous a ouvert les portes que vous attendiez ?
Je ne m’attendais à rien et ça ne m’a pas ouvert de portes.
Étant donné le genre de films que fait Spike Lee, comment fait-il pour trouver des fonds ?
J’en ai discuté avec lui. Il trouve que c’est très difficile, la pente est dure, il doit se battre. Il pensait qu’après Inside Man, il pourrait faire d’autres films. Il a été très déçu car ça n’a pas été le cas au moment de produire son film suivant, bien que c’était un film très commercial et très bien reçu. Ça aurait été quelqu’un d’autre
il aurait pu signer pour trois ou quatre films.
Qui sont les cinéastes ou les artistes que vous admirez le plus ou auprès de qui vous avez le plus appris ?
J’admire beaucoup les acteurs avec lesquels j’ai travaillé, mais surtout Danny [Glover] qui est exceptionnel. C’est un ambassadeur des droits de l’Homme, il se donne à fond pour toutes sortes de causes du moment que ça informe les gens sur ce qui se passe dans le monde, en Afrique, et partout. Il est extrêmement sincère. Je l’admire beaucoup, il utilise sa notoriété pour des causes qui lui tiennent à cur. Les gens comme ça, c’est un vrai plaisir de travailler avec eux.
Je travaille souvent avec les mêmes gens parce que j’admire leur talent et parce que je leur dois bien ça. Par exemple John Demps à la caméra ou le compositeur Steve Taylor sont très doués, et puis ils sont là quand j’ai besoin d’eux. Et si je leur dis que je n’ai pas d’argent, ils ne prendront pas leur cachet habituel, car ils ont réussi. Ils me diront « que puis-je faire pour toi » ? Et c’est sympa de travailler avec eux.
Pourquoi vos premiers films sont-ils si difficiles à trouver ?
Pendant des années, Killer of Sheep n’est pas sorti à cause des droits des chansons que Milestone vient d’acquérir. Maintenant il est sur DVD. D’autres ne sont jamais sortis au cinéma et n’ont jamais été distribués. Pour To Sleep with Anger, c’est simplement que Goldwyn, le distributeur, a baissé les bras.
Que pensez-vous de vos films quand vous les voyez aujourd’hui ?
Je ne les regarde pas. Je les ai vus mille fois et chaque fois, je ne vois que les défauts, toujours plus gros, toujours aussi douloureux, on ne s’en remet pas, on ne peut pas ne pas y penser. J’ouvre les yeux pour certaines scènes et je les ferme pour d’autres. Certaines choses fonctionnent bien, mais je suis trop critique, c’est le problème de beaucoup d’artistes. Il y a des retours positifs et négatifs. Je suis ravi quand les gens en tirent quelque chose, quand ils se rendent mieux compte de certaines situations, on ne peut pas demander plus et si on touche ne serait-ce qu’une personne de manière positive, alors on a accompli quelque chose malgré les critiques. Changer la vie d’une personne pour toujours, ça n’a pas de prix.
J’étais frappée par la façon dont vos films parlent des gens, des hommes essentiellement, comme étant pauvres, mais pas malhonnêtes, car le film montre la classe ouvrière et non pas cette « sous-classe » (underclass) dont parlent les sociologues américains. Peu de films américains évoquent la classe ouvrière.
Les studios perpétuent certains mythes sur les Noirs. Ils pensent aussi que les films qui reposent sur la force des personnages ne marchent pas, ce qui est un autre problème. Et puis les cinéastes indépendants que j’ai connus ne pensaient jamais travailler pour eux donc ils n’adoptaient pas le style Hollywood. On s’est formé à une époque où les films étaient supposés avoir un impact positif et il y avait tout ce vécu qui n’avait jamais été exploité, qu’il fallait exploiter. Il y a tellement d’histoires à raconter. Les histoires de gangster qu’Hollywood adore, ça a été tellement fait, passons à autre chose. Et puis on parle de ce qu’on connaît. Moi je ne connais pas de gangsters, je ne veux pas en connaître et je ne veux pas les glorifier. La vie est plus intéressante que ça. Il y a des gens qui malgré tous les obstacles supportent leur sort et survivent, en essayant de maintenir une forme de dignité, de rester fidèle à soi-même, à des valeurs et à des principes dont ils doutent parfois et qui peuvent changer, mais ils s’y tiennent et cette bataille, pour moi, c’est une histoire qui mérite d’être racontée. La difficulté d’être, voilà ce qui m’intéresse.
Dans My Brother’s Wedding et To Sleep with Anger, les animosités de classes sont centrales. Est-ce toujours important dans la communauté noire aujourd’hui ?
Je crois que oui, en tout cas ça l’était quand j’étais jeune. Les tensions étaient fortes, entre ceux qui avaient la peau claire et ceux qui étaient plus foncés, c’était l’autre élément majeur. Avant le mouvement des droits civiques, on vivait tous ensemble donc on se croisait tout le temps et les plus bourgeois prenaient des airs, ils voulaient qu’on voie qu’ils étaient riches et sophistiqués. Il y avait le club « Jack and Jill » dont on ne pouvait faire partie que si on était suffisamment clair de peau. En même temps, on idéalisait aussi la pauvreté. Beaucoup d’entre nous se sont fait prendre à ce piège : chercher à s’éduquer, à réussir à l’école, c’était chercher à être blanc. Tous ces freins contribuaient à maintenir le statut quo et nous, on suivait. C’est ce que j’ai voulu montrer dans ces films, que Pierce est pris là-dedans, qu’il idéalise les pauvres et a une fausse image de la classe moyenne, au lieu de relativiser les choses. Je voulais critiquer cette mentalité.
À un moment un personnage dit « ce soir on va manger comme les Blancs ». Qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est une différence culturelle entre les Noirs et les Blancs : les Noirs mangent ce qu’on appelle la soul food, c’est-à-dire du poulet, des épinards, c’est assez gras dans l’ensemble, alors que les Blancs prennent de plus petites portions sans saveur. Pierce a mal au ventre donc ils lui disent « ne t’inquiète pas, on mange blanc ce soir », autrement dit de la nourriture fade.
Dans Killer of Sheep et My Brother’s Wedding, il y a beaucoup de scènes avec des enfants que l’on a plus vues dans les films suivants.
To Sleep With Anger parle d’une famille, d’une génération qui se tourne vers son passé, qui pense à l’importance du folklore, à son utilité, et se demande si le bien et le mal existent. Le petit garçon joue un rôle important : il ne ramasse pas ses billes sur lesquelles roule Harry qui décède, c’est le dénouement. Il joue donc un rôle clé dans une structure folklorique classique où le personnage principal est corrompu par un agent démoniaque dont il doit déjouer les tours. J’ai développé ces thèmes avec toute une histoire où l’enfant innocent intervient de manière assez conventionnelle, avec ses billes qui font tomber l’homme en question.
Inversement, The Glass Shield ne parle pas d’une communauté ou d’une famille mais de comment un individu peut se faire corrompre alors qu’au départ, il voulait servir la communauté. Il se retrouve à participer à une institution criminelle [la police]sans s’en rendre compte alors qu’il pensait bien faire. Il accepte de dire un tout petit mensonge, qui fera sa perte.
Serait-ce comme de travailler à Hollywood ?
Oui, en quelque sorte, même si je n’ai pas voulu dire ça, mais c’est vrai.
Dans Killer of Sheep, j’ai vu des adultes miniatures qui ne se mélangeaient pas entre filles et garçons. Ils ne s’entendent pas. La fille a beau être plus jeune, elle a souvent de corvées à faire, alors que les garçons jouent et font des bêtises.
Les enfants voient leurs parents et apprennent à survivre. Ils apprennent très jeunes que la différence entre le bien et le mal n’est pas toujours claire, mais que la famille passe avant tout. Les enfants sont toujours conscients de ce que font les adultes et en tirent des leçons. C’est de leur point de vue à eux, en quelque sorte. Et très jeunes, ils entrent en conflit, ils ne s’entendent pas, comme s’ils appartenaient à deux espèces différentes. Ce qu’on voit dans le film correspondait à la réalité : les deux enfants se chamaillaient tout le temps, il fallait les séparer.
Bizarrement, les filles s’entendaient avec des garçons plus grands et vice-versa. C’est étonnant. Et donc le film en parle : on se fait des idées sur les autres et rien n’est résolu parce qu’on a de fausses informations.
Je voulais aussi montrer que les enfants reproduisent les valeurs de leurs parents. Quand le petit garçon sort de la maison, il appelle sa mère « Mother dear », mais il le dit comme à la campagne, comme les gens peu éduqués, il raccourcit et dit « M’dear« , et son père le gronde parce qu’on n’est pas à la campagne. Les gens venus du Sud essayent de le cacher, ce qui est dommage parce qu’il y a de très bonnes choses à prendre. Je pense que trop souvent, les gens ont une fausse image de leur propre culture qu’ils dénigrent parce qu’elle vient du Sud et qu’ils veulent s’en débarrasser.
Pensez-vous que c’est la même chose pour la culture africaine ?
Oui. Ça va et ça vient. Il fut un temps, si on traitait un Noir d’Africain, c’était la bagarre assurée, et puis les gens se sont mis à en être fier. Maintenant ils recherchent leurs racines africaines et veulent voir l’Afrique. Moi je suis allé en Namibie.
///Article N° : 8078