Le romancier congolais (RDC), Joseph Mwantuali, publie aux éditions Cle un roman orphique, L’impair de la nation, qui pose l’enracinement de l’Africain comme la condition de sa participation au fameux « rendez-vous du donner et du recevoir » cher au poète. Ce faisant, il donne à lire un plaidoyer pour la Renaissance africaine ; une renaissance qui prend ici un visage de femme, puisqu’elle s’opère, grâce à l’avènement d’une femme à la tête d’un État africain. Écrit bien avant l’élection de Sir Hellen Johnson au Liberia, L’Impair de la nation confirme l’adage populaire selon laquelle, bien souvent dans nos vies, la fiction précède l’existence ; il montre surtout par la complexité de sa narration, nourrie aux sources de la culture Sengele, combien la tradition peut être moderne. Rencontre avec l’auteur.
Quelle est la genèse de ce livre. ? Une note de lecture consacrée à votre roman, parue dans le journal camerounais Repères (08 février 2008), souligne qu’il procède d’un recueil de nouvelles intitulé Septuagénaire, que je n’ai malheureusement pas lu.
La manière dont le critique en parle est assez ambiguë. En fait, le livre n’est pas une continuité de Septuagénaire. Mais la technique de narration, en revanche, a été expérimentée dans ce recueil de nouvelles. Il s’agit d’un recueil de quatre nouvelles et une bonne dizaine de poèmes. Tout le recueil forme un ensemble, qui pourrait se lire comme un roman. Je l’ai recomposé comme un puzzle. C’est ici que j’ai appliqué pour la première fois cette technique. Et comme ce critique, que vous évoquez, suit mon itinéraire, il a constaté que j’ai élaboré, approfondi cette technique dans mon roman.
Votre roman est axé sur le pouvoir, mais il va à contre-courant de nombreux romans de la dictature en Afrique qui sont des romans » urbains « . Le vôtre prône le retour aux sources
Là également, je pourrais vous dire que tout a commencé avec le recueil de nouvelles Septuagénaire. Dans l’une des nouvelles, un homme moderne rencontre une très belle femme. Il arrive dans l’immeuble, au lieu du rendez-vous. On le balade dans tout l’immeuble
Le mythe est mythifié. La nouvelle s’intitule Septuagénaire. L’immeuble a sept étages. Au fil des pages ; la personne, qui rentre au début au rez-de-chaussée, arrive au septième étage complètement transformée. Il y a là une démarche initiatique. Dans la nouvelle suivante, intitulée Saxo-vent le personnage central, part à la recherche d’une femme, mariée quelque part. Il part de son village jusqu’aux Etats-Unis pour la retrouver, en passant par Bruxelles, Paris et Londres. Saxophoniste, il joue devant les grands musées ethnographiques des villes traversées et dont il sera chassé. Voyant ainsi son voyage transformé en nomadisme de paria, ce personnage accomplit un voyage initiatique.
Et j’en reviens là à votre question. Les dictateurs on les décrit, on les dénonce. Qu’est-ce qui fait que l’on n’arrive pas à juguler ce fléau ? Le mal est peut-être à la source, et il faut savoir à quel moment il commence. Il est vrai que ma manière d’aborder cette question de la dictature est différente de celle de beaucoup de mes congénères. Évidemment en parlant de retour aux sources, les tenants du post-colonialisme – je veux parler de ceux qui en font une » religion « , car je ne suis pas contre, dans le principe – vont nous dire, que cette histoire d’identité est dépassée, et nous accuser de » nativisme « , » d’essentialisme « , de » nombrilisme « , etc. Mais la quête identitaire est-elle vraiment dépassée pour l’Africain ? Qui est mieux placé que le malade pour savoir s’il veut guérir ? Le roman propose une thèse : il faut peut-être revenir du côté de nos sources, sans tourner le dos à la modernité et à l’universalisme, dans un mouvement concomitant. Sembene Ousmane dirait : remettre ensemble les morceaux de culture africaine, qui ont été éparpillés, disloqués pour » créer une nouvelle culture africaine » ; Werewere Liking, parlera, de » lambeaux d’identités « , ou de » mémoire amputée » pour citer son dernier roman. On ne va pas recréer la tradition africaine. Mais on peut en re-créer une, à partir de ces lambeaux. C’est peut-être ce qu’essaye de dire mon roman.
Mais les traditions n’ont-elles pas une responsabilité dans le naufrage de l’Afrique ?
Certaines traditions africaines ont disparu ; d’autres se sont repliées sur elles-mêmes et sont devenues secrètes. Regardez Werewere Liking : elle est enracinée dans une vieille culture bassa. Tout le travail qu’elle abat du point de vue social, tous ses écrits, l’école de Kiyi-Mbock- qui, par ailleurs, signifie l’Ultime Savoir – sont nourris par la sève émanant de la société initiatique bassa du centre du Cameroun. C’est pourtant une uvre des plus modernes qui rencontre des résonances aussi bien avec les Italiens qu’avec les Japonais, les Français ou les Américains. C’est fascinant. C’est un peu comme les chasseurs ou la cérémonie du Donsomana chez Ahmadou Kourouma, ou encore le Kinginzila dont Sony Labou Tansi disait s’inspirer. Il faut savoir trouver les clefs pour décoder.
Dans ce roman, j’ai puisé dans ma culture sengele, dans le Maï-Ndombe (ancien lac Léopold II) au centre du Congo-Kinshasa, puisque je suis petit fils de chef coutumier. Cela m’a bien servi de connaître la tradition de mon village. Du reste, j’ai été fasciné par Michel Leiris, qui a travaillé sur les sociétés secrètes en Éthiopie. Comme nous le savons, dans ses uvres, notamment L’Afrique fantôme et, surtout, La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, l’expérience a fini par être plutôt une déception pour tout un tas de raisons, mais on oublie souvent que ce » plongeons dans les eaux du primitivisme » (1) a fait de Leiris le grand que nous connaissons aujourd’hui : l’homme universel par excellence. Il a su aller réellement voir l’Autre, je dirais mourir dans l’Autre. Lui-même appelait cette démarche, la réflexibilité. L’acte de se voir en l’Autre et vice-versa. La réflexivité disait-il, c’est » lorsque l’Autre apparaît en vous « . N’est-ce pas intéressant de voir un occidental s’attacher ainsi à nos valeurs traditionnelles lorsqu’on entend aujourd’hui certains artistes africains furieusement décidés à aller » briser tous les masques » de leurs ancêtres parce que, paraît-il, ils empêchent d’entrer dans la modernité ?
Ce roman sur la transmission ne va t-il pas à contre-courant de la littérature contemporaine.
Je partage votre avis. Je veux m’opposer à la littérature facile telle qu’on la pratique actuellement. C’est à peine, s’il ne faut pas mettre la date de péremption à la quatrième de couverture, comme on le fait avec les yaourts ! Vous savez ces romans que vous offrez en cadeau à un camarade une fois que vous en avez fini la lecture, tellement vous avez l’impression qu’une autre lecture ne vous apportera plus rien. À mon sens, le roman demande un travail de la part du lecteur de la même manière qu’il a demandé un travail à l’auteur. Un exemple : un moment dans le roman, le narrateur dit cette phrase toute banale » Creusons montons « . Il y a visiblement une contradiction ici. Mais en même temps cette phrase dit tout. Il y a un mouvement initiatique, orphique à effectuer. Il y a à la fois une volonté de chercher et le bénéfice d’acquérir. Si l’Afrique faisait ce mouvement, cet effort de creuser, eh bien peut-être
.
La présence de la femme est capitale dans votre dernier roman ; la femme du narrateur, son érotisme, la femme présidente
Cette image de la femme ne va t-elle pas à l’encontre de la tradition ?
Les femmes sont dit-on exclues dans nos traditions. Mais la femme c’est la vie. Cela a toujours été une valeur fondamentale dans nos traditions, contrairement à l’aliénation ou, pire, les violences de toutes sortes dont elle est victime dans nos sociétés modernes. Si l’on observe nos sociétés de manière superficielle, on dira évidemment que les femmes sont exclues. En fait, elle est au centre de tout. Bien des uvres littéraires ont pu rendre compte de ce fait. Regardez L’Enfant noir de Camara Laye. Au premier abord, c’est le père forgeron, qui est au centre du roman. En réalité, le pouvoir est dans les mains de la mère. Lisez L’aventure ambiguë de Cheick Hamidou Kane, c’est la Grande royale, qui règne. Voyez l’exorciste Ousmane Sembene s’évertuant d’une uvre à l’autre à donner du pouvoir à la femme, acte sans lequel, l’Afrique ne pourra s’en sortir. Dans ma culture sengele, c’est la même chose. Autrement dit, c’est plutôt la modernité, à partir de la colonisation, qui a marginalisé la femme. Et l’Afrique paye peut-être ce tribut aujourd’hui. Si mon roman peut se réduire à une thèse, elle sera la suivante : » On n’ira nulle part, tant qu’on n’aura pas compris que tout part de la femme. « . Ce roman est un hommage à la femme. C’est un roman dédié aux mamans Moziki 100kg, aux nanas Benz (2). Etc.
Le titre du roman joue sur l’impair qui évoque le chiffre, mais il peut aussi évoquer le contraire du père de la Nation
C’est exact. Un des personnages forts du roman s’appelle Ndenga. En Sengle, cela veut dire, en effet, chiffre impair. En observant son évolution le lecteur comprendra facilement pourquoi il porte ce nom. Le nom en Afrique, vous le savez, veut toujours dire quelque chose. Quant à l’aspect politique, ce qui ressort de ce roman, c’est que le pouvoir ne s’usurpe pas. Or, en Afrique on joue avec le pouvoir. Ici aussi, nous avons des leçons à prendre des bons modèles de nos traditions. Il faut être prêt à l’assumer, le pouvoir. Pour cela, il faut être préparé non seulement par la connaissance profonde et l’amour véritable de son pays son peuple, mais également et surtout à l’auto-exorcisme résultant d’une descente en soi, » d’un connais-toi toi-même « . Or, que voyons- nous aujourd’hui en Afrique, le premier aventurier venu, tout malade du fait colonial qu’il est, arrive l’arme au bout du bras et dit au peuple : » c’est moi le chef ici et tu la boucles « . Non préparé pour le siège pris par la force, il ne peut qu’enfoncer le pays dans plus de misère. Il s’est ajouté un autre fléau : les fils se sont mis en tête que ce siège, déjà mal occupé par leur père, sera le leur d’office. Et la maladie se répand, et l’Afrique va de mal en pis
La femme, qui devient présidente dans le roman, prête serment deux fois. D’abord dans un lieu tenu secret. Cela est très important pour notre Afrique qui est nue aujourd’hui ; dans notre Afrique qui n’a pas de secret, qui n’a même pas de mémoire. Même dans les sociétés occidentales, celui, qui détient le pouvoir n’est pas forcément le plus visible. Il nous faut reconstruire le » temple « . Il nous faut les fameux gardiens du temple, dont parle Cheick Hamidou Kane. S’ils ne sont pas trouvables, eh bien il nous faudra les inventer. Il y a beaucoup de symboles dans ce roman. Prenez, par exemple, l’arbre à l’envers, dont les racines se nourrissent des éléments de l’air. J’explique longuement cette première partie du roman, qui rebute tant les lecteurs. Un livre inspiré d’une société initiatique ne peut être qu’hermétique. Le narrateur n’a fait que mettre les choses à l’endroit mais de manière détournée. Aux Africains, ou à quiconque s’intéresse à la culture, de creuser et de trouver. Il y a dans cette première partie tout un jeu de cache-cache qui pourrait se révéler fort intéressant, pour peu que l’on veuille s’y prêter. L’arbre est à l’envers. On va de la branche dix pour finir à la branche une. Ce sont là des étapes initiatiques. Si vous vous intéressez à la culture orientale ou du Moyen-Orient, vous trouverez une correspondance avec l’arbre des Séphiroth de la Kabbale. Je n’en dis pas plus. Il y a aussi dans cette culture sengele le concept de » Mpese Na Soke « , Mpese et Soke, qui se trouve être l’équivalent du Yin-Yang chinois. Or nous savons combien ce concept chinois intéresse le monde aujourd’hui. Mais ceux des Africains qui veulent aller » casser les masques » vous diront d’oublier » Mpese Na Soke « , parce que cela fait trop » cocotier » ou trop » jungle « . Je n’en dis pas plus.
Les Asiatiques ont réussi à enseigner le Yin et le Yang, les juifs la Cabbale. Pourquoi n’enseigne-t-on pas ce savoir ésotérique de la société sengele ?
C’est exactement ce qu’essaie de faire ce roman, particulièrement dans cette première partie, la plus ésotérique du roman. Si nous qui avons pu y avoir accès ne faisons rien, tout cela va disparaître. Il ne subsiste que des lambeaux de savoir. Mais un mouvement panafricaniste pourra, par le bout à bout, constituer le quilt, cet édredon qui, en Amérique, se constitue par des bouts de tissus différents, rajoutés de génération en génération. C’est la raison pour laquelle apparaissent à la fin du roman, des figures historiques de l’Afrique.
Il est temps de transmettre notre savoir. Werewere Liking ne fait que cela depuis des années. Mais son enseignement était surtout dispensé sur place dans l’école Ki-Yi d’Abidjan. Elle a finalement accepté de mettre à la disposition du grand public ce précieux savoir dans un ouvrage que j’ai eu l’honneur d’éditer et de préfacer : L’enseignement d’une éveilleuse d’étoiles. J’espère que sa maison d’édition le sortira vite, car cette uvre non seulement édifiera plus d’un lecteur à l’esprit ouvert, mais elle apportera des clés pour la compréhension de beaucoup de ses uvres de fiction.
Je le répète, nous devons nous reconstruire et faire fi des théories stériles prônant que » l’Afrique n’existe pas » ou que » le panafricanisme est impossible à cause des ethnies multiples « . Aussi incroyable que cela puisse paraître, en cette année où elle célèbre ses cinquante ans d’indépendance, l’Afrique a plus que jamais besoin de retenir, dans une véritable » dynamique du dire et du vivre « , le discours que lui tenait Césaire il y a plus de cinquante ans ! Le grain n’a pas pris, il faut se l’avouer. Nous devons ressemer.
Du point de vue littéraire, L’Impair de la nation est un roman initiatique. Pourquoi n’avez-vous pas écrit un conte ramassé, comme l’a fait Amadou Hampâté Ba dans Kaïdara ?
C’est une excellente idée. Mais dans ce cas, j’aurais été amené à développer encore plus longuement la première partie, qui semble résister déjà aux lecteurs. Or, vous le savez, l’accès au vrai message de Kaïdara n’est pas donné au premier lecteur venu. Je ne dis pas qu’on devrait nécessairement y chercher le message initiatique. Aujourd’hui encore beaucoup de gens ne voient dans des récits comme La Belle au bois dormant ou La Belle et la Bête, que d’innocents contes pour enfants. Or une lecture anagogique en ferait sortir un savoir qui est une vraie » nourriture pour adulte « . Encore une fois, et rien de surprenant ici, la personne, qui a su le mieux interpréter Kaïdara, c’est Werewere Liking, dans une uvre clé, dont on ne parle pas beaucoup : Une vision de Kaïdara. Il suffit à quiconque croyant avoir bien compris Kaïdara de lire l’analyse que Werewere en a faite pour davantage apprécier l’écriture de notre grand Hampâté Bâ. J’espère, en tous cas, que les gens, qui auront lu la discussion que nous sommes en train d’avoir sur cette première partie de mon roman, comprendront finalement comment, les femmes sont arrivées à arracher le pouvoir aux usurpateurs, à le » remettre » en place et à le garder sans se l’accaparer. Ceci explique cela.
Ce qui est fascinant dans ce roman, c’est le fait que la fiction devance les faits. Sir Ellen Johnson avait-elle déjà été élue présidente du Liberia à l’époque où vous l’écriviez ?
Non, le roman fut achevé deux ans plus tôt ! Un ami, qui a lu le tapuscrit m’a dit : » C’est bien fait, mais soyons réalistes dans notre situation africaine actuelle, ce n’est pas demain qu’on aura une femme présidente de la République « . Quand l’inspiration vient, il faut s’en tenir à elle. Lorsque Mme Johnson est devenue présidente du Liberia, j’ai dit à mon éditeur, qui avait pris du retard pour éditer le roman, que nous avions manqué là une occasion historique. Heureusement il a pris soin de mentionner en quatrième de couverture que nous avions » vu » cela venir quelque deux ans auparavant.
Quelle a été la réception de ce livre ?
Un ami allemand, qui a été dans mon village natal dans les années soixante-dix, et qui connaît très bien ma culture, celle dans laquelle j’ai puisé les éléments de la première partie dite » hermétique « , m’a écrit pour me dire : » j’ai adoré le roman, j’espère qu’on en fera un film ; un tel film sera certainement apprécié par tout le monde « . N’est-ce pas très intéressant de constater qu’un livre, qui a dérouté certains Africains est bien assimilé par un Allemand ? Beaucoup d’universités américaines ont ce roman dans leur bibliothèque. Il est bien vendu chez Soumbala et, aux États-Unis, en ligne chez Alibris. Il fait lentement son petit chemin. Au fur et à mesure que les gens découvrent les concepts des Nanas Benz et des Mamas Moziki 100 kilos, ce roman se posera de lui-même comme l’un des premiers à célébrer ce rôle d’ Atlas que joue la femme africaine, mais également à lui donner une part égale en politique. Donnons- lui le temps.
Le paradoxe de votre roman réside finalement dans le fait qu’il parle de la tradition alors que sa technique de narration est très moderne.
Non. La technique est bel et bien de chez nous. NGandu NKashama par exemple puise dans la tradition Luba. On apprécie mieux son écriture si l’on a un peu étudié cette tradition. En effet, il y a chez les Luba le Kasala, qui est un chant traditionnel raconté à plusieurs voix et sur plusieurs niveaux narratologiques. C’est-à-dire que le griot raconte plusieurs histoires enchevêtrées, parfois sur différents temps narrant et narrés, tout en gardant l’unité du récit cadre. Les Luba le font de manière remarquable. Nous avons aussi ce genre de récit dans ma culture, les Sengele l’appellent Iyanza Nguba et les Mongo et les Nkundo, nos cousins culturels, l’appellent Liyanza. Nos traditions ont, elles aussi, des choses à apporter au monde. Avec un peu d’humilité, les artistes peuvent s’y abreuver à satiété. En tous cas, il y a un peu de Liyanza et de kasala dans mon roman, L’impair de la nation.
Vous avez évoqué au cours de cet entretien Sembene Ousmane et Werewere Liking. Sont-ils pour vous des modèles ?
Absolument. Werewere Liking, Sembene Ousmane et évidemment Sony Labou Tansi et Ngandu Nkashama. Ce sont mes modèles en littérature africaine. Je n’oublie pas Ahmadou Kourouma. Tous ces écrivains font un véritable travail d’exorcisme. Je ne cite pas d’autres noms d’ailleurs aux consonances difficiles à prononcer en tant que modèles. Je ne suis pas aussi érudit. Je broute encore en vacillant sous le baobab qui m’a vu naître
1. ce sont les mots de Leiris, avec les sens « mélioratif » de l’époque surréaliste.
2. Les Mamans Moziki 100kg sont ces femmes commerçantes du Congo(RDC), généralement vendeuses de tissus, et dont la puissante ristourne permet, depuis 20 ans aujourd’hui, de faire tourner l’économie du pays, au moment où, comme aujourd’hui, les hommes sont à 90% au chômage.
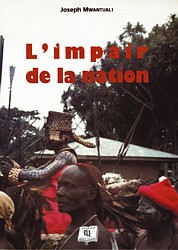







![[VIDEO] Jimmy Jean-Louis présente son livre « Le Héros »](https://africultures.com/wp-content/uploads/2025/05/jimmy-jl-214x140.jpg)

