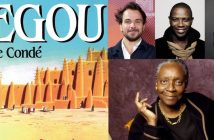Inscrit dans les programmes officiels de l’enseignement des lettres du Cameroun (classe de première de l’enseignement général), Balafon du poète-prêtre camerounais Engelbert Mveng(1930-1995) est aujourd’hui l’un des recueils camerounais les plus connus. Mais le livre du jésuite insoumis assassiné il y a une dizaine d’années à Yaoundé n’est pas reçu de la même manière au lycée et dans les cercles des poètes. Anne Cillon Perri nous le prouve suffisamment dans ce regard désaccordé qu’il pose sur un livre « trop encombré d’indications bibliques ».
A la fin du siècle dernier, deux tempéraments ont marqué la poésie camerounaise d’expression française. Il s’agissait véritablement, comme le dit Fernando d’Alméida, de deux ordres littéraires. D’une part, le courant à surcharge évènementielle, à la trame sociale, et d’autre part, l’odyssée intimiste, la plongée de soif en soif pour dépasser le pathétique et l’agressivité sociale. Ces deux ordres n’ont pas toujours coexisté pacifiquement. Ceux qui, comme Ernest Alima, avaient opté pour une poésie à l’eau de rose1 étaient âprement combattus par des poètes à l’instar de René Philombe et Jean-Pierre Gonda dont l’écriture, particulièrement marxisante était fortement instrumentalisée dans l’optique de la lutte anticolonialiste et l’exaltation de l’idéologie rouge.
Prenant tout le monde de court, le père Mveng intervient pour brouiller les cartes en même temps qu’il salue Moscou par ses « tam-tams de l’amitié », en même temps il salue New York ou il a « semé les rizières de ses tribus depuis les bords Congo et du Niger ». Cela s’est appelé après le sommet de Bandoeng, le non-alignement. Mais chez le prêtre jésuite, il y a comme une conjonction souterraine, et de l’Est représenté par Moscou et de l’Ouest représenté par New York par le ciment de l’amour. Et pour cela, il dérangeait un peu. Car, Mveng publie balafon à une époque où il faut choisir nettement son camp entre l’Est et l’Ouest, ou si vous voulez, entre le capitalisme et le communisme. Il dérange encore aujourd’hui non seulement parce que le lecteur de ce siècle ne se reconnaît plus dans cette doctrine manichéenne, mais aussi, parce que le prélat a voulu théologiser la négritude. De sorte qu’on peut parfaitement se demander s’il est encore lisible aujourd’hui. La réponse à cette question m’amènera à situer un tantinet le contexte génésique de Balafon qui est complètement différent de l’environnement actuel.
Les seize poèmes de balafon ont été écrits de 1956 à 1971. Ces deux dates marquent d’une part la composition du poème le plus ancien et, d’autre part, le poème le plus récent. Ce livre à donc été entièrement conçu pendant la période dite de guerre froide. Il est par conséquent difficile de lire Mveng ou de l’enseigner en faisant abstraction du fait que ce livre porte les stigmates de la guerre idéologique entre le bloc de l’Est et le monde capitaliste qui se sont affrontés de manière constante de 1945 à 1989. Aujourd’hui, ces guerres sont dépassées et l’apaisement que joue Mveng ne se comprend plus que si on veut bien replacer ses poèmes dans leur contexte génésique.
Par ailleurs, les quatre premiers poèmes du recueil s’inscrivent dans une logique qui met l’accent sur la couleur de la race. « Kon Fu-tseu » représente le levant jaune par opposition à la nuit de mon visage éthiopique. Roland Roger c’est mon Europe binaire qui marche à droite et regarde à gauche. C’est la race blanche qu’il oppose aux amérindiens représentés par Moteczuma, c’est-à-dire, les rouges. Le quatrième poème salue d’un élan amical toutes les races qu’il compare à la sienne visiblement la meilleure d’après lui. Car il pense que c’est la seule qui soit capable d’aimer les hommes, simplement parce qu’ils sont hommes. Cela peut s’appeler le racisme.
Trop encombré d’indications bibliques, historiques et géographiques, Balafon dissimule mal le fait que c’est un prêtre doublé d’un historien qui y parle. Et d’ailleurs, la préséance qu’il semble accorder à l’histoire antique participe du fait qu’en même temps que balafon, il écrit Les sources grecque et négro-africaines depuis Homère jusqu’à Strabon, un livre qu’il publie à Présence africaine en 1972. Balafon est donc en quelque sorte la version poétisée de ce livre. Il lui ajoute simplement pour les besoins de la cause quelques bons sentiments plus en adéquation avec sa charge sacerdotale, sa camerounité et son origine forestière. C’est sans doute pour cette raison qu’il semble impotable à la jeunesse actuelle confrontée, non plus aux problèmes raciaux, ni à l’antagonisme idéologique, mais aux miasmes d’un monde marqué par les pandémies globalisées, la paix injuste, le jeu des représailles, l’inhibition de l’altérité des peuples du Sud, la brutalité de l’entreprise d’homogénéisation de la planète par des sicaires et plutarques qui composent l’oligarchie octale qui mène le monde par le bout du nez. Il y a aussi les nervis de Davos qui entraînent l’illusion de l’internationalisation de la justice et uvrent au renforcement de la dictature du capital.
Ainsi donc, dans un monde jeté en pâture aux marchands, quel crédit la jeunesse peut-elle accorder au chant d’espoir de Mveng ? Celui-ci ressemble bien davantage à une désagréable plaisanterie, à moins de convenir qu’il chantait là un monde qui est toujours à venir comme le royaume de Dieu chez les catholiques dont il est un serviteur invétéré.
En outre, dans une Afrique où on se rejette mutuellement au nom de la tribu comme chez les Hutu ou chez les Tutsi ou chez les Dioula en Côte d’Ivoire, on peut parfaitement se demander si c’est bien de notre continent qu’il parle dans sa lettre collective. Dans un contexte où le jazz et le blues n’éveillent plus rien chez les jeunes, dans un contexte où les valeurs culturelles les plus mondialisées semblent être le coca cola, le rap, la drogue, le blues-jeans et le sexe, le vagissement initiatique des tam-tams peut-il valablement constituer une solution pour la paix comme il prétend dans le poème « New York » ?
C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres que je me ferrai le plaisir de préciser, si vous m’en donnez l’occasion, que la jeunesse scolaire d’aujourd’hui ne peut plus lire Mveng en fête.
1 Ernest Alima a écrit quelques textes engagés, mais globalement, on ne peut vraiment pas dire qu’il est un poète dont le militantisme est avéré comme chez René Philombe///Article N° : 3986