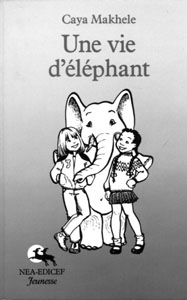Parler de la production littéraire en Afrique implique de poser, ne serait-ce que de façon sommaire, le problème des conditions de production et de circulation des biens matériels sur ce continent.
On sait depuis les travaux de Samir Amin (1968, 1970, 1971, 1985) qu’à la différence des économies occidentales assurant leur propre cohérence interne, les économies africaines sont subordonnées aux besoins des métropoles industrielles. Cette extraversion économique à l’origine du sous-développement dans les pays du Tiers-Monde et particulièrement en Afrique n’a pas toujours existé. Le sous-développement en Afrique a, selon Samir Amin, une genèse et une histoire : celle de l’intégration progressive des économies de subsistance au marché mondial, à travers l’esclavage, la colonisation et les indépendances formelles.
S’inspirant des travaux de Samir Amin, le philosophe Paulin J. Houtondji trouve une similitude structurelle entre le mode de fonctionnement de l’économie et l’activité scientifique africaines. Pour lui, l’extraversion scientifique de l’Afrique est un aspect particulier de son extraversion économique. Cette thèse, il la développe dans le dernier chapitre de son livre : Combats pour le Sens (1997). A ses yeux, l’anthropologue du Tiers-Monde est, dans le contexte international de la recherche, l’héritier de l’informateur illettré ou semi-lettré de l’anthropologue occidental. Le problème prévient, tout de suite Houtondji, ne doit pas être posé en termes de compétence, parce qu’il existe en Afrique des anthropologues de qualité, mais en terme de structures. Pour lui, l’activité scientifique en Afrique se caractérise par sa dépendance et souffre de ce fait de quatre faiblesses essentielles qui l’empêchent de se mettre véritablement au service des peuples africains :
1) la dépendance financière vis-à-vis de l’étranger,
2) la dépendance institutionnelle vis-à-vis de laboratoires et centres de recherche du Nord,
3) la primauté des échanges scientifiques Sud/Nord sur les échanges horizontaux Sud/Sud, entraînant ainsi l’extraversion des publications locales,
4) enfin, la subordination intellectuelle aux questions, aux attentes du public savant d’Occident. Ce qui n’est autre que la conséquence de l’extraversion et de la dépendance institutionnelle.
On l’aura compris, pour P. J. Houtondji, l’anthropologue africain produit pour un lectorat extérieur à l’Afrique dont il doit prendre en compte les exigences. Ce problème, Mongo Beti le pose déjà en 1954 de façon latérale dans la critique qu’il adresse à Camara Laye, à l’occasion de la parution de l’Enfant noir. Généralement, lorsqu’on évoque cette critique, on insiste sur son aspect jdanoviste et on occulte le problème du rapport entre l’écrivain africain et le contexte d’énonciation de son oeuvre, qui l’oblige parfois a tenir un discours convenu.
Problème que devait poser (plus tard) de façon plus sereine, Mohamadou Kane dans L’Ecrivain africain et son public (1966) où il montre que, dès le mouvement de la Négritude, l’écrivain africain est partagé entre un public de coeur (africain) qui « exigeait » de lui une sorte de piqûre de courage pour se décomplexer face à l’homme blanc et un public de raison (occidental), son principal lecteur et client, exigeant insidieusement un exotisme littéraire pour se dépayser. (1) On le voit : l’écrivain africain est piégé dès le départ et devrait se montrer vigilant pour éviter que son discours ne soit récupéré ni par son lectorat de coeur qui le condamnerait à magnifier l’Afrique, ni par son lectorat d’adoption qui a souvent de l’Afrique une image figée : celle d’un monde dans lequel vit encore ce bon sauvage cher à Montaigne et Diderot dont les vertus naturelles s’opposeraient à celles de la civilisation occidentale. De ces pièges tendus à l’écrivain africain, le plus redoutable est celui de son public de raison, qui bénéficiant des traditions et d’institutions littéraires établies le pousse insidieusement à satisfaire ses attentes.
Face à une telle situation, l’émergence, à la veille des indépendances de certaines maisons d’éditions africaines : N.E.A, Clé, Mont noir, Akpagnon, etc. a incontestablement contribué à l’élaboration d’un « discours autonome » en Afrique. Même si, très vite, ces éditions ont été rattrapées par des difficultés objectives : coût excessif du livre, faible pouvoir d’achat des Africains, distribution plus ou moins chaotique du livre, absence chez les gouvernements d’une politique culturelle d’envergure vraiment nationale, statut problématique de l’écrivain et du créateur en Afrique, aliénation culturelle du lecteur qui préfère généralement la production occidentale à la création locale, etc.
Ajoutons à ces difficultés objectives l’absence manifeste de stratégie commerciale et éditoriale chez les éditeurs et écrivains africains penchant davantage vers la « la haute littérature » (essais, poésie, romans, etc.) que la paralittérature (feuilleton, roman populaire, policier, etc.) qui aurait pu être économiquement et symboliquement bénéfique au Continent.
Sur le plan économique, la paralittérature aurait pu contribuer à fidéliser le lectorat moyen, comme a su le faire le roman populaire d’Eugène Sue au XIXe siècle. Sur le plan symbolique, elle aurait servi de véritable contre-littérature susceptible de récuser les stéréotypes racistes et dévalorisants du monde noir présents dans les romans d’espionnage et la bande dessinée (style Tintin au Congo). Toutefois, ces maladresses des aînés tendent à être évitées par la jeune génération d’éditeurs comme le Malien Moussa Konate et la Sénégalaise Aminata Sow Fall. Le premier, directeur des éditions le Figuier, adapte des textes oraux en français, produit une abondante littérature de jeunesse, donne à lire des textes bilingues, invente de nouvelles formes de distribution, notamment le porte à porte ; la seconde fonde simultanément une maison d’édition et un Centre d’animation et d’échanges culturels (CAEC) regroupant une libraire et une salle de débats, le tout dans le but de mieux assurer la diffusion des livres.
Soulignons également la naissance en Côte d’Ivoire aux Nouvelles Editions Africaines (NEI) d’une collection Adoras consacrée aux romans à l’eau de rose. Inspirée probablement par les romans de Barbara Cartland et de Corine Tellado, la collection est adaptée aux réalités africaines. Le caviar est remplacé par le manioc ou la banane frite, le champagne devient jus de gingembre et la valse se fait mapoukas, une danse à la mode à Abidjan. Le tout dans un souci manifeste de réduire au maximum la fulgurance de l’aliénation culturelle. Pour la directrice Meliane Boguifo, » l’idée vient d’un constat : les femmes de notre pays et les Africaines en général adorent les histoires d’amour à l’occidentale et les apprécient autant dans les livres qu’au cinéma. Aujourd’hui, nous leur donnons plus l’occasion de baigner dans une ambiance africaine. » (Courrier de l’Unesco, nov. 98, p.42)
Il ne s’agit nullement de tourner le dos à l’espace parisien pour verser dans un nationalisme de clocher qui entraînerait l’Afrique dans un ghetto mais plutôt de poser les bases d’une autonomie intellectuelle et culturelle sans laquelle il n’y a pas de démocratie véritable.
(1) Il faut relativiser cette critique. Certains intellectuels français (Sartre, Balandier, E. Mounier, Gide, etc) ont joué un rôle fondamental pour le rayonnement de la littérature africaine, soit en parrainant le revue Présence Africaine, soit en préfaçant l’anthologie de L. S. Senghor, soit en dénonçant la situation faite au Noir dans les colonies. Par public occidental, il faut entendre les lecteurs qui ne sont pas forcément au fait des réalités africaines, même si parfois on retrouve des tiers-mondistes « amis » de l’Afrique qui sont souvent ses pires ennemis du fait de leur paternalisme. ///Article N° : 608