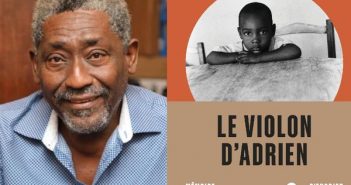Chaque mois, le conteur, dramaturge et romancier Raharimanana nous donne rendez-vous sur son chemin nomade. Des mots et images posés sur des paysages sensibles, imaginaires, et leur résonnance avec le monde en train de se (dé)-(re)faire, avec toujours, quelque part, un regard porté VERS un espace à advenir, l’Utopie.
Un rendez-vous mensuel, un carnet de voyage que l’on découvre, avec un fil rouge ; la reprise à chaque fois, du dernier poème écrit, vers le premier, pour aller… VERS.
Premier épisode de cette série : Revenir, Tisser, tout cela ne semble plus avoir de sens.
3 mars 2023, Rabat, 10h28 jusqu’à Sablé-sur-Sarthe, 12 mars, 14h10 .
Emprunter le chemin nomade
Refaire le chemin, à l’envers, pour comprendre ce qui s’est passé – non comprendre n’est pas le bon mot, je ne sais pas quel est le bon mot, lorsqu’on ne comprend pas, et que l’on cherche, ou que l’on refuse, oui, que l’on refuse, de rester à terre. Il faut se lever. Horizons. Car brutalement, alors que vous croyez signer pour l’éternité, une nuit, de vent et de tempête, où les pierres s’écroulent, tout s’effondre aussi pour vous. Revenir, Tisser, tout cela ne semble plus avoir de sens. Alors pour ne pas vous jeter des falaises qui ne sont pas si inaccessibles que cela, vous empruntez le chemin nomade.
Entamer une année nomade, confier ses pas au loin, et savoir que toujours l’inconnu devient paysage, et que paysage est acceptation de soi dans un passage, le corps demande inscription, l’être demande à être. Du visage de ce qui se figure devant lui. Alors, commencer à l’envers, reprendre quelques phrases à chaque fois, du dernier poème écrit, vers le premier, pour aller vers.
Vers.
La durée ouvre la vision et le paysage l’habille, les récits se terrent et s’enterrent sous les monts, dunes, sables, ou se vaporisent dans les brumes et les torpeurs des aurores. Vous est parfois l’envie de sentir par les parois le chemin à dénouer, prendre, et ouvrir, ouvrir pour être noué, à nouveau nouer et s’emmêler, encore, ouvrir, et sangs, mêler.
Ce regard vers le pays, vers l’île, et la laideur toujours présente, la misère mentale, la corruption, l’attitude des puissants et des politiques, en contradiction avec ce que les gens se font de vous, de votre pays, un pays de beauté et de nature incomparable, un pays de douceur et d’accueil, et vous vous taisez, ne voulant pas rompre dans cette réalité, car oui, l’île est belle, et vous-même, comment pouvez-vous dire la misère quand vous êtes bien souvent dans le luxe, des endroits où vous passez, Venise, L’Algarve, Vienne, aujourd’hui Rabat… dans les hôtels – cinq étoiles aujourd’hui, où vous posez votre bagage – bagage cabine, pas plus de 10kg. Tout doit y tenir, le nécessaire, vous savez qu’il faut peu de choses pour être. La frugalité est une immense besace – vous riez en vous, d’un rire amer d’une telle expression, vous vous permettez la frugalité car vous en avez les moyens n’est-ce pas ? Combien peu ont-ils vos compatriotes qui crèvent de faim sur votre île ?
C’est un paysage aimé qu’il faut laisser
Vous regardez à travers la vitre de votre chambre de luxe. Ce ne sont pas les rues de Rabat que vous voyez. C’est un paysage aimé qu’il faut laisser. Vous oubliez la colline en face où paissent les moutons, vous dites adieu aux arbres plantés, vous demandez pardon au jardin potager que vous devez abandonner, ce n’est pas votre choix, vous allez vous absenter un peu, sûrement à jamais, à peine étiez-vous enraciné, on vous a déraciné et pratiquement jeté – ce ne fut pas l’intention de vous jeter, tentez-vous d’entendre, mais le résultat est le même, vous vous sentez traité comme un indésirable, vous n’êtes plus l’objet d’un soin qui vous garde, l’accueil manque désormais, votre bouche a dit spontanément que vous partez.
Vous vous autorisez la chute et non la disgrâce. Vous pensez à ces herbes qui vous frôlent les jambes, qui parfois vous grattent fort, vous les remerciez. Vous regrettez déjà l’odeur de la menthe sauvage, entêtante, qui vous donne le vertige à force d’arracher ses racines rhizomiques. Honneur se dit en malgache voninahitra, mot que l’on peut décomposer en vony–ny–ahitra. Vony désigne le bouton de la plante qui peut donner naissance à la fleur ou à la graine ; ny désigne l’article le ou la ou les – il n’y a pas à proprement dit de marque de pluriel dans votre langue, et il n’y a franchement pas de genre, pas de masculin ni de féminin ; ahitra indique ce qu’on appelle communément les mauvaises herbes. C’est en respectant la graine de la plus insignifiante plante que l’on fait honneur à la vie que nous tous nous portons.
Dignité.
Vous partirez ainsi. En donnant honneur à la belle histoire que vous aviez vécue malgré tout. Et nomadisme car aucune nouvelle maison ne doit s’ériger dans de tels effondrements, ou tout au moins votre nouvelle maison, votre nouvel horizon. Si un jour, vous en auriez envie, d’un nouvel enracinement…
Vous pleurez dans un baume de silence apposé par vous ne savez qui, quoi – la croyance en l’ouverture et en vos propres forces.
Vous êtes fendu, vous venez de comprendre ce mot, fendu, une part qui n’a plus envie de rien, et l’autre qui rassure, qui dit, ferme les yeux, ferme tout simplement, tout va aller, comme sous des paupières.
Les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment,
– arrivent-il à franchir ce qui forme l’univers pour une fourmi,
le pas hésitant d’un enfant ?
Les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment :
tes songes deviendront des cauchemars
si tu penses trop à ce qui peut mystérieusement se passer
pendant ce temps ![…]
Clin d’œil, dans « Presque-songes », de J.J.Rabearivelo, 1934.
Les récits se terrent, depuis combien de temps ai-je rusé afin de ne pas les aborder de face ? Et s’enterrent sous les monts, dunes, sables, mais les monts, dunes, sables, ne sont-ils pas que l’amoncellement de ma lâcheté ? Ou de ma fatigue ? Ou de mon désir d’un monde meilleur ? Ou de l’envie simple de vivre ma vie sans l’advenir à celle de mon écriture ? Les récits se terrent et se déterrent, aujourd’hui que je suis redevenu rien, une friche où me reprendre, hors.
Exil à nouveau.
Je dessine. Et tout en crayonnant, entends les propos d’un ami, Thierry Bedard, ne perds pas ton temps à tout ça, jouer, performer, représenter… écris !
Je dessine. Et gratterai les cordes de mon marovany. Je ne dessine pas, je renforce les traces de mes visions, je m’engouffre dans les profondeurs et les imprécisions de ma calligraphie. Je ne joue pas de la musique, je dérive dans des sons et des mouvements qui me traversent, j’y traque la voix, celle où je me reconnaîtrai.
Une route dites-vous ? Une route
Je m’éloigne de la vitre. Le lit immense. Où je peine à plonger. Et de l’orgueil de ce bâtiment : « The view », du haut de sa petite quinzaine d’étages. La lumière tamisée de la suite. Les rues de Rabat. Immenses. Propres. Modernes. Entretenus. Vous pensez à vos rues, à Mazava Huile, Mahajanga, à Betafo, près d’Antsirabe… des trous immenses, la boue, la terre rouge qui saigne, ce n’est même pas à la campagne où l’on peut justifier le cloisonnement, les pistes, la pauvreté, c’est en pleine ville, et lorsqu’il y a des panneaux qui annoncent l’entretien, à coups de milliards d’ariary, où vous ne savez plus compter, où vous ne savez plus évaluer l’importance, des zéros et des zéros qui s’alignent, et vous constatez les travaux, les ouvriers travaillent à la truelle. Une route dites-vous ? Une route, à la truelle. Qui bloque la circulation depuis des semaines, une dizaine de mètres ont été accomplies paraît-il, bloquées par des grosses pierres pour qu’en attendant elles sèchent, n’y passent ni piétons, ni bajajs, ni pousses-pousses, ni chiens ni zébus, et bien sûr ni voitures impatientes ni autres véhicules réfractaires. Un camion a tout pété d’un pneu baladeur.
Comme ces images qui vous révoltent profondément, un président de la République qui descend de son jet pour distribuer des plats de riz à une foule à qui on demande de s’aligner – presque à genoux, assis, avec leurs bols ou plats en mains, prêts à recevoir la manne présidentielle. Pour une bien bonne photo d’instagram et de facebook. Des motos distribuées pour les représentants du peuple. Des motos car les routes sont impraticables. Que de belles compréhensions de la réalité. Je ne reconstruis pas la route, non, j’offre des motos tout-terrain. Je ne reconstruis pas le pays, non, j’offre un plat de riz. Je bâtis des bâtiments manara-penitra – aux normes internationales, sans y mettre aucune administration, aucun travailleur. Je bâtis des gymnases en plein milieu des rizières tandis que les paysans ne disposent d’aucun endroit pour battre le riz, pour entreposer les produits. Et des T-shirts orange à tout-va. Non, ce n’est pas propagande. C’est vêtir les pauvres. Je joue sur la compassion et l’humanitaire. Je bâtis ma légitimité sur quinze secondes de story. Les commentaires sont mes débats, et les clics mes nombres de vote.
Vous avez tellement honte. Vous êtes troublé. Ici, à Rabat, vous n’êtes pas royaliste. Vous vous dites : ne regarde pas seulement les belles routes et la ville propre, tu sais parfaitement que tu es dans un contexte où la pauvreté n’a pas droit à la visibilité, mais tu ne peux pas contester qu’il y a une intention de bien-faire, regarde, il y a des réalisations de ce bien-faire. Chut, la démocratie, la liberté, et tous ces discours qui balaient d’un revers de la main toute approche hors d’occident…
Désemparé.
Quelles réponses pour l’Afrique ?
Mais vous êtes seulement écrivain, et non économiste. Vous êtes raconteur d’histoires et non politologue, et non journaliste, ni un quelconque juriste ou autre spécialiste patenté, un historien ou un sociologue. Mais vous savez aussi que votre excuse est inacceptable, car vous faites partie d’une caste qui a la possibilité de s’exprimer, de parler, de dire, de dénoncer, de bâtir, de proposer. Dans ce genre de pays, vous ne pouvez pas vous contenter d’un tel argument, que vous n’êtes qu’écrivain…
Alors, vous jouez avec les mots, vous dites que vous êtes « d’abord » écrivain, ou mieux, poète. Dégagé dirait l’ami Johary…
Vous vous dites aussi que vous vous êtes éloigné de l’idée d’en finir parce que vous avez encore un roman à finir…
Dans une page de votre recueil, une réminiscence de phrase : je n’en finis pas de finir. Ce n’était pas la règle de sauter ainsi les pages, il fallait aller à rebours, poème après poème.
Et vous dire aussi qu’à Mayotte, vous savez qu’on meurt en mer, que les corps flottent, que les kwassa sombrent, qu’ici, là, partout des êtres tombent. Debout est nécessité. Que cette peine a remis les yeux à l’endroit, ou plutôt pousse à nouveau à dire, sans précaution, sans détours.
Avez-vous le temps de bâtir un vivre-ensemble où la conscience et le respect éloignent les conflits ? Votre écriture a-t-elle ce pouvoir ? Au mieux, vous n’êtes qu’étincelle, mais l’étincelle a grande capacité, vous êtes luciole, vous disparaissez peut-être, mais vous scintillez nuit après nuit, ténèbres après ténèbres, sans explications. Ça, vous le savez.
Vous n’oubliez pas la graine qui porte la vie, non, vous n’oubliez pas la mauvaise herbe qui colonise le sol, inlassablement, malgré les arrachements, les mots sont graines, les poèmes mauvaises herbes.
Vous repensez à ce rêve qu’on vous a communiqué : l’image d’un enfant assis dans les ténèbres, tenant entre ses mains une fumée blanche.
Tenant l’instant, une main, maintenant, deux mains, la fumée précieuse et persistante, petite.
Vous ne devez pas lâcher tant que cette petite fumée reste dans le creux de vos mains. Vous ne voyez pas son feu. Qu’importe.
Quelqu’un vous chuchote que votre loin ressemble à sa maison.
- Les yeux de la luciole
- Hors
- L’aigle inaccompli
- Vienne, hiver
- La mort du prince
- Luciole encore
- Délestage, Amborovy
- Fil et couleur
- Peut-être que je voyage de racine en racine
- Voninahitra
- Les pierres muettes
- Présence
- An-dalana
- Dans les mains, une fumée blanche
- Vers, toujours