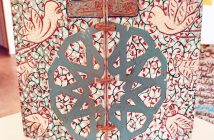L’artiste égyptienne Ghada Amer s’inspire de la pornographie, de la culture populaire et de légendes anciennes pour évoquer le plaisir au féminin, le désir obsessionnel et le savoir érotique.
« [
] Allah urged us to observe it, showed us the need to practice it and, giving priority to pleasure, indicated the grandeur of coition, placed the desire for it in women and inspirited them to practise it [
]. »
Al Katib, The Encyclopedia of Pleasure, p. 43.
Il nous faut parler de l’amour en Afrique. L’Afrique rose. C’est au romantisme qu’invite la couleur. Un idéal auquel toute femme aspire. Le rose, la rose et l’innocence, dans l’univers féerique des contes et légendes. Un monde imaginaire dont Ghada Amer, artiste égyptienne, tire son inspiration.
Parler de l’amour en Afrique, disions-nous. Mais voilà, Ghada Amer habite New York depuis bientôt dix ans. Revient alors à notre esprit ce séjour au Maroc où les films d’amour allaient des sitcoms égyptiennes aux productions bollywoodiennes. Le Maghreb, il est vrai, est un carrefour de civilisations. (1) Et, de la même manière que l’Afrique a été traversée par différentes cultures, elle s’exprime aujourd’hui sur d’autres territoires que le sien. C’est dans ce contexte que son oeuvre nous intéresse.
Romantisme et innocence, s’ils ont fait les débuts de l’artiste dans les années 1980, ont depuis une dizaine d’années cédé la place à la réalité charnelle des corps en plaisir. Des nus en extase ont remplacé les prudes ménagères. Et si l’on a cru un temps qu’Amer contestait le conservatisme de l’islam, on comprend aujourd’hui que son travail s’inscrit dans la droite lignée avec la définition de l’érotisme telle qu’on la trouve dans la culture arabe. De fait, après avoir puisé dans les revues pornographiques, Ghada Amer s’est intéressé à l’amour dans le monde musulman, des contes populaires aux traités érotiques.
Née au Caire en 1963, Ghada Amer, fille d’un ancien diplomate égyptien, a toujours été encouragée à voyager. Elle étudie l’art à l’École du Musée des Beaux-Arts de Boston, obtient une maîtrise en peinture aux Beaux-Arts de Nice puis poursuit ses études à Paris. Elle peint depuis les années 1980, mais ce qui fait la singularité et le succès de son uvre tient à l’utilisation du fil en guise de pigments.
Le cheminement par lequel elle en vient à la couture est bien connu. (2) Lorsqu’elle retourne en Égypte en 1988, après une dizaine d’années à l’étranger, elle tombe sur un numéro de Venus, magazine de mode égyptien. Elle y découvre des mannequins portant des vêtements de marques occidentales adaptés, par collage, aux exigences de l’islam. À la fin de la revue, des patrons permettent aux lectrices de réaliser leurs propres modèles. Ce numéro, que l’artiste » conserve comme un talisman » (3), a été le point de départ de sa broderie figurative. Au début des années 1990, elle l’emploie à représenter la femme dans le rôle domestique que lui attribue la société. Des uvres comme Cinq Femmes au Travail (1991), La Femme qui repasse (1992) ou Au Supermarché (1992), marquent cette époque. Et, de la même manière que les pionnières de l’art féministe mettaient leur corps à l’épreuve, Ghada Amer s’inflige la dure tâche de piquer ses scènes points par points, dans un procédé lent et minutieux ; faisant de la broderie, travail artisanal et féminin, un art majeur.
Lauri Ann Farrell rapporte qu’Amer a toujours été fascinée par les images sentimentales et romantiques. (4) Ses premiers coups de crayon reproduisaient en nombre des jeunes femmes amoureuses. On peut voir dans sa série de Mariés (1995) une sorte d’ultime aboutissement. Mais derrière l’image du couple se cache une intimité faite de désir, de passion et d’union des corps dans la douceur, ou dans l’ardeur.
Lorsqu’en 1993, Ghada Amer aborde l’image érotique, elle ne fait qu’approfondir les stéréotypes et tabous qui entourent le monde féminin. L’artiste peint des femmes extraites de magazines pornographiques dont elle complique la lecture en brodant sur la toile. Ses tableaux se font support d’un entrelacs de fils qui ne manquent de rappeler les drippings de Pollock. Les coutures fonctionnent comme le revers d’un travail, une sorte de métaphore de ce qui est caché et ne se produit qu’à l’abri des regards. Et alors que l’il innocent se concentre à démêler les formes, se dévoilent devant lui des femmes s’embrassant, jouissant de cunnilingus ou s’adonnant à des plaisirs solitaires.
Ghada Amer s’approprie des revues destinées à une consommation masculine pour traiter des désirs et fantasmes féminins. Elle fait de ses protagonistes des femmes qui se suffisent à elles-mêmes. Et en abordant les rapports entre personnes de même sexe, elle libère la femme d’une sexualité dans laquelle elle serait soumise aux désirs de l’homme.
De la masturbation et du lesbianisme elle banalise le caractère tabou en multipliant la même scène sur une toile. Mais son propos n’est pas exprimé abruptement. Les fils qui rendent les corps indistincts pourraient être un jeu visuel purement artistique, consistant à révéler tout en dissimulant. Pour Lauri Ann Farrell, ils fonctionnent comme des voiles. (5) Comme un écran qui protègerait le corps féminin de la convoitise masculine. (6) Car, comme nous l’apprend la légende de Majnun, il n’est plus fou désir que celui d’un homme pour une femme.
Pour Ghada Amer qui a vécu vingt ans en France avant de s’installer à New York, la légende de Majnun est le premier conte oriental qu’elle explore dans son art. Avant d’aborder Majnun (1997), il paraît important de revenir aux sources de ses premiers textes brodés.
En 1993, elle crée Conseils de beauté du mois d’août, composé de quatre mouchoirs sur lesquels sont reproduits des conseils tirés de magazines de beauté. On y trouve ce qui touche aux soins du corps, des cheveux, des ongles et de la peau. Amer a choisi le mois d’août car c’est le mois de l’été où la femme, consciente de son corps, en est aux plus petits soins. En abordant la question du bien être féminin et de la séduction, l’artiste effectue un bond conceptuel. (7) Ceci est d’autant plus vrai qu’avec la lettre, elle s’éloigne du figuratif et aborde un nouveau champ sémantique.
Ce jeu entre figuratif et conceptuel, elle le développe dans deux uvres réalisées en 1995. Dans La Belle au bois dormant, elle brode le conte de fées sur une robe blanche. Celle-ci embrasse alors une double narration. Disposée sur son mannequin, elle semble attendre d’être portée pour une grande occasion. Un mariage peut-être, entre la Belle et son prince. Et à cela s’ajoute l’élément narratif du conte.
Dans Barbie aime Ken, Ken aime Barbie, le texte est aussi cousu sur le vêtement. Chaque combinaison semble composer une enveloppe corporelle dont la forme servirait à distinguer le féminin du masculin. Ici, ce n’est pas une histoire qui est reproduite mais la déclaration d’amour répétée à un point de saturation tel que les personnages, comme le note Farrell, sont littéralement prisonniers de leur désir. (8) L’amour, bien que réciproque, ne peut être ni partagé, ni consommé. Il devient obsessionnel et c’est en cela que Barbie et Ken annoncent le thème du Majnun (le fou d’amour).
Leila et Majnun, conte perse écrit par Nizami au XIIe siècle, parle de l’amour irraisonné de Qais pour la belle Leila. Trahi par de passionnels échanges de regards, Qais se voit interdit par le père de Leila de s’approcher d’elle. Alors, son amour et l’incontrôlable désir qui le gouverne, le rendent fou. Il devient le Majnun, décide de vivre en reclus et meurt consumé par un amour impossible. Coupé du monde, il n’a de cesse de chanter la douleur de son cur sous forme de poèmes. Portées par le vent, les oiseaux et les nomades, ses paroles atteignent le désert de Najd où Leila, prisonnière de sa tente, les apprend avant de composer à son tour ses réponses.
Ghada Amer reprend les mots de Majnun qu’elle traduit de l’arabe au français, et les reproduit sur des boîtes de rangement. Plusieurs interprétations ont été données de cette uvre. Pour Candice Breitz, il s’agit d’un hommage à la souffrance de Leila, obligée d’exprimer sa passion par répétition, et d’une exploration du moi contraint à différer son désir, pour le vivre par procuration. (9) Laura Auricchio qui évoque la position doublement subalterne de la femme au temps de la colonisation cite Gayatri Spivak pour justifier un parallèle entre la répétition et l’adoption, notamment par l’artiste, de la langue du colon européen. (10)
Ce qui nous intéresse dans Majnun, l’histoire comme l’installation, est la tension psychologique créée par la retenue et l’interdit, de même que la non-figuration, qui sont en totale opposition avec le libertinage précédemment abordé. Car l’islam ne condamnait pas le plaisir.
En 2001, Ghada Amer réalise une installation intitulée Encyclopedia of Pleasure. On connaît deux précédents à cette uvre. L’un tiré de source occidentale, La Définition de l’amour d’après le Petit Robert (1993). L’autre puisé dans le Coran, Private Rooms (1998-99). D’une facture similaire à Majnun, Private Rooms reprend tous les textes du Coran traitant de la femme. Certains sont élogieux, d’autres répressifs. Ensemble, ils exposent les attitudes contradictoires de l’islam envers la femme. La sexualité y est ouvertement évoquée et il est même souligné qu’un bon musulman se doit d’être un bon amant. (11) C’est sans aucun doute pour aider le dévot à parfaire ce devoir qu’entre les Xe et XIe siècles, Abul Hasan’Ali Ibn Nasr Al Katib rédige son traité sur la sexualité arabe. (12)
Alors qu’Amer, en quête de nouvelles sources, se tourne vers l’islam médiéval, elle redécouvre cet ouvrage oublié du monde musulman. Traduit en anglais en 1977, Encyclopedia of Pleasure est un document rare, et l’installation de l’artiste est la seule en date à y être consacrée. Elle consiste en une cinquantaine de boîtes de coton sur lesquelles sont cousus en fil doré des passages de l’Encyclopédie. Sahar Amer, sur de l’artiste et professeur associé en études orientales et internationales à l’université de Caroline du Nord, précise qu’ici l’artiste a choisi un type de broderie d’origine indienne appelé sirma, très en vogue en Égypte. On l’utilise pour broder en calligraphies décoratives les versets du Coran. (13) En adoptant cette technique, Amer sacralise et réattribue sa légitimité à un texte que certains préféreraient voir oublié.
Sur les quarante-deux chapitres de l’ouvrage, Ghada Amer a sélectionné les sept abordant le plaisir féminin. Encore une fois, elle traite par la non-figuration des textes on ne peut plus explicites. Ce qui ne fait qu’enraciner le caractère conceptuel de son travail. Comme dans ses précédents travaux inspirés de sources arabes, elle ne cherche pas à illustrer. Est-ce par respect pour l’interdit de figuration ? Ses uvres érotiques nous répondent par la négative. Tout comme l’Encyclopédie qui nous apprend que les personnalités du monde arabe, très sophistiquées en matière de plaisirs sexuels, faisaient construire des bains sur les murs desquels étaient représentés des couples pratiquant différentes positions de coït. Colorées, enrichies de mosaïques et d’or, ces pièces garantissaient à elles seules une stimulation efficace. (14) L’installation, quant à elle, a pour effet de stimuler l’imagination du spectateur. Car les passages qui y sont reproduits ne permettent pas de saisir la totalité du texte. Ici et là, les quelques mots lisibles sont dotés de facultés suggestives.
Olu Oguibe remarque qu’en faisant référence aux écrits médiévaux arabes, eux-mêmes » indicateurs d’un précédent pluralisme dans l’islam, Ghada Amer nous rappelle que la pruderie aujourd’hui adoptée par les radicaux serait davantage déterminée par la politique ou l’histoire, plutôt que motivée par la religion » et qu’elle est en contradiction avec » les inclinaisons et désirs que les époques précédentes reconnaissaient comme faisant partie de notre nature, hommes comme femmes « . (15) Ghada Amer aurait dédié cette uvre aux femmes musulmanes. (16)
Rappelons que l’Immaculée Conception est le premier dogme catholique à refuser à la femme le droit de jouir des plaisirs de la chair
Notes
1. Il nous paraîtra ici justifié d’assimiler cultures arabe et nord-africaine sur la base de l’autorité des préceptes de l’islam, notamment en ce qui concerne la position de la femme et l’interdit de représentation figurative.
2. Lire Eleanor Heartney, « Ghada Amer, Cendrillon Versus Shéhérazade », Art Press n. 308, janvier 2005, pp. 28-29. Titre original « Ghada Amer: Embroidering on Pleasure », traduit par Aude Tincelin.
3. Id. p. 29.
4. Lauri Ann Farrell, « Recalculating Exchange Rates: Power and Poetics in the Works of Ghada Amer », in L. A. Farrell (ed.), Looking Both Ways, Art of the Contemporary African Diaspora, New York, Museum for African Art, 2003, p. 51.
5. Id., p. 56.
6. Heartney rapporte que Fatima Mernissi verrait dans l’obligation du voile moins le souci » de protéger la femme de l’agression et du désir masculins que de protéger l’homme de l’avidité du désir féminin « . Eleanor Heartney, « Ghada Amer, Cendrillon Versus Shéhérazade », op. cit., p. 30.
7. Lauri Ann Farrell, « Recalculating Exchange Rates: Power and Poetics in the Works of Ghada Amer », in L. A. Farrell (ed.), Looking Both Ways, Art of the Contemporary African Diaspora, op. cit, p. 55.
8. Id., p. 57.
9. Candice Breitz, « Ghada Amer: Critical Strands » in Echolot, Museum Fridericianum, Kassel, 1998, p. 25.
10. Laura Auricchio, « Works in Translation:Ghada Amer’s Hybrid Pleasures », Art Journal, vol. 60, n. 4, Hiver 2001, p. 34.
11. Eleanor Heartney, « Ghada Amer, Cendrillon Versus Shéhérazade », op. cit., p 30.
12. L’auteur inclut le Maghreb dans la sphère d’influence de la culture musulmane. Salah Addin Khawwam, Introduction, Abul Hasan ‘Ali Ibn Nasr Al Katib, Encyclopedia of Pleasure, editée et annotée par Salah Addin Khawwam, traduite par Adnan Jarkas et Salah Addin Khawwam, Toronto, Ontario, Aleppo Publishing, 1977, p. 2.
13. Sahar Amer, « The Encyclopedia of Pleasure », in S. Amer, O. Oguibe, The Encyclopedia of Pleasure, Amsterdam, De Appel, 2002, p. 14.
14. Al Katib, Encyclopedia of Pleasure, op. cit., p. 28
15. Olu Oguibe, « The Regarded Self » in S. Amer, O. Oguibe, The Encyclopedia of Pleasure, op. cit., p. 6.
16. Lauri Ann Farrell, « Recalculating Exchange Rates: Power and Poetics in the Works of Ghada Amer », in L. A. Farrell (ed.), Looking Both Ways, Art of the Contemporary African Diaspora, op. cit, p. 58.