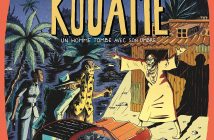Calligraphe, décorateur, dessinateur de bandes dessinées et illustrateur de contes pour enfants, Yacouba Diarra, dit Kays, est surtout connu comme dessinateur de presse. Il commence sa carrière de caricaturiste au milieu des années 80 en collaborant au trimestriel Jamana, revue culturelle de la coopérative du même nom. Par la suite, il deviendra le caricaturiste attitré de l’hebdomadaire Le Canard déchaîné. Tiré à deux mille exemplaires, Le Canard déchaîné publiera également chaque année, une à deux compilations de ses meilleures caricatures. Kays est aussi depuis plus de vingt ans le caricaturiste vedette du quotidien Les échos. En parallèle, il a illustré plusieurs ouvrages aux Éditions Jamana. Son parcours en matière de BD démarre en 1977, puisqu’il lance avec Gérard Galtier, Kòtèba kura, un journal de bandes dessinées en bambara, qui connaîtra deux numéros. Par la suite, il continuera à publier de la bande dessinée dans Grin Grin. A près de 70 ans (il est né en 1946), il reste encore actif dans le milieu du dessin de presse.
Quelle est votre formation ?
Je me suis formé sur le tas. Quand j’étais petit, je pensais que la bande dessinée, c’était de la magie. Que l’on introduisait les pages dans une machine et que celle-ci faisait tout. C’est quand j’ai vu un album dessiné par un auteur que j’ai compris que c’était un travail fantastique. Cela m’a inspiré et je me mettais à recopier les petits albums que j’avais entre les mains : Akim, Bleck le roc, Zembla
..
Vous aviez quel âge ?
Est ce qu’un artiste a un âge ? Aujourd’hui, j’ai presque 70 ans. A l’époque j’étais simplement jeune.
Quand avez-vous réalisé votre première BD?
En 1977, je crois, avec le linguiste Gérard Galtier. Je m’amusais à faire des petites BD, il m’a remarqué et m’a proposé de faire une revue BD tous les deux, en bamanan : Kòtèba kura. A l’époque, l’imprimerie n’était pas très développée, on a sorti les planches avec du stencil. On a fait deux numéros puis ça s’est arrêté. J’ai continué à faire de la calligraphie, des panneaux publicitaires afin de vivre de mon art car le travail de dessin tombait au compte-gouttes.
Vous êtes dessinateur de profession ?
J’ai toujours vécu grâce à mes dessins, en particulier chez l’éditeur Jamanah. Je travaillais pour lui en dessinant dans Grin grin mais aussi dans le journal Les échos où je dessinais chaque vendredi un bandeau composé d’un strip vertical. J’étais l’illustrateur officiel de cette maison, au départ dans le journal Jamanah qui était une revue culturelle. Puis, ils ont fini par créer Les échos. C’était difficile car c’était l’époque du général Moussa Traoré, les services de sécurité ne blaguaient pas, ils étaient implacables. On a commencé par publier des caricatures mais des gens passaient nous voir au bureau et demandaient après moi. Les collègues répondaient que je n’étais pas présent.
Comment s’est déroulée votre enfance ?
Elle a été très difficile. J’ai perdu mes parents très tôt. Mon père était mort et ma mère s’est remarié et est partie vivre dans une région éloignée. Je suis resté seul auprès de la famille. Mon grand-père était marié à quatre femmes. Il y avait plein d’enfants dans la cour de la maison, mais la différence est que les autres avaient leur maman qui les choyait. Moi, j’étais seul. J’en souffrais beaucoup, mais cela m’a donné un regard externe sur les gens, sur la société, car j’observais beaucoup. Je suis parti à 17 ans de la maison. Je suis allé vivre chez des copains par ci, par là. Leurs familles se méfiaient de moi, les parents disaient que j’étais un traînard, un voyou. Alors, je restais dans la rue, je marchais toutes les nuits et restais devant des boîtes de nuit afin de pouvoir dormir à côté, sans craintes d’être agressé. Le matin, j’allais au fleuve pour faire ma toilette et pêcher. Je gagnais un peu ma vie en redessinant les affiches de cinémas, en particulier les films hindous qui étaient très populaires à l’époque. Je pouvais vendre mes dessins et me faire un peu d’argent pour me nourrir. C’est comme ça que j’ai pu vivoter pendant quelques années, du fait de ma plume.
Vous avez également vécu en Côte d’Ivoire
Vers l’âge de 33-34 ans, j’avais un sentiment d’échec et pas d’argent, je ne savais pas quoi faire de ma peau. J’ai réussi à gagner 80 000 Fcfa en dessinant des écriteaux pour l’Ambassade de Chine. Cela m’a permis de partir en Côte d’Ivoire où je me suis installé pendant quelques temps. Je travaillais pour la société Ivoire immédiat et faisais des dessins sur les bus de transport.
Mais le virus du voyage ne vous a pas quitté !
Je ne trouvais ma place nulle part ! Alors, par la suite, j’ai essayé d’aller en Libye à l’époque ils accueillaient pas mal d’africains. Je suis allé à Ouagadougou puis de là au Niger où il a fallu trouver l’argent pour passer. Avec un camarade, on est allé à Ghardaïa, à côté de Tamanrasset. On a trouvé un guide pour faire passer en Libye. Il nous a demandé 50 000 Fcfa pour chacun. On était treize. Cependant, je me suis méfié car j’avais remarqué beaucoup de bagages dans le sable autour de sa maison et cela m’a mis la puce à l’oreille. Pourquoi tous ces gens avaient-ils laissé leur bagage, n’en avaient ils pas besoin ? On lui a dit qu’on était d’accord mais à la condition de pouvoir l’attacher pendant la nuit. Il a refusé. Je ne suis donc pas parti et ai décidé de retourner au Mali. Bien m’en a pris car m’attendait une proposition de Gérard Galtier, celui-ci voulait me faire venir en France et m’avait envoyé le prix du billet. Je suis allé prendre l’avion à Ouagadougou. Puis, depuis Roissy, j’ai pris une navette jusqu’à la gare de Lyon. Avec mon unique pièce de 1 franc j’ai appelé Gérard, il était stupéfait. Il m’a hébergé chez lui. Au début j’ai été fasciné par la télévision. Alors, j’ai passé mes nuits à la regarder, programme après programme. Je ne dormais pas. Il est vrai qu’à l’époque, il n’y avait pas de télévision au Mali.
Vous êtes resté combien de temps en France ?
J’y suis resté environ 3 ans jusqu’en 1984. Je suis d’abord allé à l’ACCT, où j’ai pu montrer mes planches. Mais cela n’a pas donné grand-chose. Puis, j’ai travaillé pour diverses publications dont Fouyaya, un journal de BD antillais, comme pigiste. Gérard m’a suggéré d’aller à Saint Denis pour suivre des cours de dessins. Il y avait plus de 200 élèves. Une femme se déshabillait et chacun la dessinait selon l’angle où il était positionné. Il n’y avait pas vraiment de cours, juste quelques diapos alors j’ai fini par arrêter car je n’apprenais rien.
Vous avez choisi ensuite de revenir au Mali.
Oui, Alpha Oumar Konaré n’était plus ministre de la Culture et avait lancé son propre journal. Ils ont fait appel à moi. C’est donc là, comme je vous l’ai dit, que j’ai commencé à travailler pour Les échos, Jamanah. J’ai également beaucoup dessiné pour Le figuier, pour lequel j’ai d’ailleurs produit beaucoup de livres pour enfants et même deux BD : Comment le lièvre sauva les chèvres en 1997, premier album de BD publié dans le pays et La revanche du chasseur en 2001. Je suis devenu le dessinateur principal de Jamanah même s’il n’y avait aucun contrat d’exclusivité avec eux. Je travaillais donc à côté et faisais de la calligraphie, des dessins pour la publicité, des illustrations pour des livres scolaires.
Vous avez surtout dessiné dans le journal pour la jeunesse des éditions Jamanah, Grin grin.
Oui, durant très longtemps. Cela s’est arrêté car le journal a arrêté de publier régulièrement de la BD dans ces pages. L’aventure avec Grin grin se présentait bien. Puis aux alentours du N°25, il y a eu une divergence artistique avec la direction.
Nous, les dessinateurs, voulions en faire un vrai journal avec un vrai volet BD, avec des histoires à suivre, mais ce n’était pas leur objectif. Ils voulaient faire des BD éducatives. De plus en plus de pages étaient occupées par des textes, des articles, des dessins. Il n’y avait plus de place pour des planches de BD. On a essayé de créer une association d’illustrateurs pour se former et faire pression, mais les intérêts individuels l’ont emporté. Il était impossible de s’autoéditer, on a donc dû se plier à leur exigence. Afin de pouvoir vivre. Sinon, ils auraient pris de jeunes dessinateurs qui sortaient des écoles de formation. J’ai quand même pu dessiner presque en continu plusieurs séries qui ont marqué toute une génération de jeunes maliens : L’aigle noir, Les trois amis et surtout Saro qui a été publié de 1990 à 1998.
Avez-vous d’autres expériences en matière de BD ?
Oui, j’ai aussi publié une revue BD, Donko, qui signifie connaissance en bambara. Lorsque j’ai publié le N°00, Moussa Konaté l’a vu et m’a racheté le reste de mes planches ce qui faisait l’équivalent de cinq numéros. C’était au milieu des années 90.
Vous êtes à la retraite aujourd’hui ?
Non, je continue ! Je suis toujours actif pour Les échos, et ce depuis 1984. Ce matin, j’ai terminé de décorer la façade d’un maître coiffeur. J’ai dessiné, à sa demande, la figure de Barack Obama en train de se faire coiffer. Mais j’ai arrêté de caricaturer car j’ai eu peur. Même la rédaction de Jamanah a eu peur suite aux incidents de Charlie Habdo et la mort de Wolinski, Cabu et les autres. Ce qui leur est arrivé est affreux. J’ai approché Wolinski lorsqu’il était chez Albin Michel. J’avais proposé quelques planches de ma série saro en langue nouchi. Il m’avait gentiment reçu, il m’a conseillé et m’a suggéré de faire une dizaine de pages. Je n’y suis pas retourné car je n’avais pas de scénario. Je me rappelle de Cabu dans l’émission de Dorothée.
Quel bilan tirez-vous de votre carrière ?
Tout ce que les autres recherchent, je l’ai obtenu. Grâce au dessin. J’ai une maison, une famille et je leur assure un niveau de vie correct. J’ai éloigné ma famille de la misère que j’ai connue. Ça c’est grâce au dessin. Donc, je continue même à mon âge.
J’ai quand même eu quatre enfants dont une fille. Il faut que je les aide. Mais, apr contre, après toutes ces années, je suis devenu moins soucieux du devenir de mon travail. Lorsqu’une ONG me donne un texte sur l’excision, je le prends et l’adapte en BD. Par contre, ce qui se passe par la suite, je ne m’en occupe pas. La vie continue.