Le réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacôte était le parrain de la Fabrique des Cinémas du monde au festival de Cannes 2024. Il a dans ce cadre donné une masterclass le 17 mai, modérée par Stéphane Goudet, directeur artistique du cinéma Méliès à Montreuil. Transcription complète résumée.
La vidéo de la masterclass peut être visionnée ici (et donc les extraits de films dont les timecodes seront indiqués) : https://www.facebook.com/watch/?v=468465178911656
Stéphane Goudet : Philippe, tu es né et tu as grandi à Abidjan d’un père français et d’une mère ivoirienne, et tu racontes que tu as découvert le cinéma dans les salles de cinéma à Abidjan. Quel fut ce tout premier contact et son importance pour toi enfant ?
Philippe Lacôte : En fait, ma maison était collée à un cinéma qui s’appelait « Le Magic » à Marcory, qui a fermé depuis. Ma mère utilisait ce cinéma comme une garderie : dès qu’elle avait une course à faire, elle m’y mettait et revenait me chercher parce que c’était un cinéma où tout le monde rentrait ou sortait ! Je ne voyais jamais les films en entier, ça se sent d’ailleurs dans mon travail !
Je voyais toujours 10 minutes, 15 minutes, ou je voyais le début, puis la fin du même film et au milieu on m’avait sorti. Je connaissais tout le monde et je montais dans la cabine. On prenait tout ce qu’on voyait au premier degré, c’est-à-dire qu’on était persuadés que les Européens ne se lavaient pas parce qu’on ne les voyait jamais se laver dans les films ! Et pour vous dire à quel point cela allait, un jour, un méchant à l’écran venait poignarder Bruce Lee. Et là, il y a un gars qui saute sur la scène et qui poignarde l’écran pour tuer le méchant !
Stéphane Goudet : On dirait une scène des Carabiniers de Godard.
Philippe Lacôte : Ce jour-là, je me suis dit : « Waouh, ça c’est le métier que j’ai envie de faire ». De créer des images qui ont cette force concrète et en même temps qui ont cette force de rêve. Voilà, pour moi c’est ça le cinéma.
Stéphane Goudet : Mine de rien ça raconte des choses, ton cinéma, la dimension de collage, le rapport documentaire-fiction, mais on va en reparler.
Philippe Lacôte : Et pour moi, je dois croire en chaque image, c’est une croyance : si je n’y crois pas, je ne le montre pas, quand je dirige des acteurs, je dois y croire. C’est-à-dire que si ce n’est pas relié à une expérience personnelle, ça ne m’intéresse pas, et donc je vis d’une manière sacrée le fait de tourner, le fait de produire des images, c’est un rituel.
Stéphane Goudet : Alors, je reprends le fil, les études supérieures tu vas les faire en France, à Toulouse et là, tu vas progressivement avoir des activités qui te rapprochent du cinéma mais qui n’en sont pas nécessairement toujours, notamment une activité à la radio, et ta première approche avec le cinéma ça va être l’exploitation puisque tu vas être assistant de programmation du « Cratère » à Toulouse…
Philippe Lacôte : J’étais projectionniste d’abord.
Stéphane Goudet : D’abord projectionniste, puis assistant de programmation. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces activités t’ont mené vers la réalisation.

Philippe Lacôte : La radio, c’est un média qui m’a passionné et je pense que si j’avais pu être réalisateur à Radio France, je n’aurais pas fait de cinéma. Mais il fallait vingt ans pour devenir réalisateur. J’avais 20 ans et je n’avais pas envie d’attendre vingt ans! A la radio, j’ai été assistant de Maurice Audran sur Les Tréteaux de la nuit, des fictions radiophoniques, ce qui veut déjà dire scénario, acteurs et bruitages. J’y ai appris beaucoup de choses. Et j’ai été projectionniste dans un petit cinéma de Toulouse qui existe toujours, « Le Cratère », parce que le cinéma c’est un refuge pour moi. Quand j’ai du temps libre, je chercher à rentrer dans un cinéma, parce que c’est l’endroit où je me sens le mieux au monde. Même pour réfléchir, c’est mon refuge. Et donc je suis arrivé au Cratère qui est une petite salle, un cinéma utopique. On était financés par la Fédération des Œuvres Laïques et par la Ligue de l’enseignement, donc on n’avait aucune pression économique, la programmation se faisait avec une dizaine de personnes et chacun disait ce qu’il avait envie de voir. C’est là que je me suis formé au cinéma. Quand je voyais un film d’Almodovar, j’allais lire des choses sur Almodovar. Et on projetait les autres films d’Almodovar et je les regardais une fois pour le son, une fois pour l’image, une fois pour les costumes puisque je les passais dix fois ! Ce cinéma était fréquenté par les jeunes de l’école de cinéma de Toulouse, l’ESAV, et c’est là que j’ai rencontré Lubomir Bakchev, un chef opérateur bulgare qui a travaillé sur plusieurs films d’Abdellatif Kechiche. Il était complètement dingue de photo ; son appartement était une chambre noire où on développait la pellicule dans la baignoire ! On a commencé comme ça. Avec lui on a réuni un groupe de passionnés et on a commencé à faire des courts-métrages : Affaire Libinski, Le Passeur…
Stéphane Goudet : Tu as également fréquenté ATRIA, à Paris, où tu as rencontré beaucoup de grands réalisateurs comme Rithy Panh, Souleymane Cissé, Abderrahmane Sissako dont tu as coproduit le dernier film, Black Tea… Cette structure était animée par une personnalité importante dans l’histoire du cinéma africain, Andrée Davanture.
Philippe Lacôte : Andrée Davanture, c’est une femme qui a accompagné le cinéma africain et les cinémas du Sud pendant 25 ans. En 25 ans, ATRIA a coproduit et accompagné 80% du cinéma francophone africain. Mais ATRIA ce n’était pas seulement une structure de production, c’était un lieu magique aussi. C’était en plein Paris, à côté de la Place de la République. Il y avait cinq salles de montage. Tous les cinéastes qui passaient à Paris venaient travailler là. Donc moi, j’allais ouvrir la salle le week-end à Raoul Ruiz, à Leos Carax, je leur offrais un café et des fois, on échangeait deux mots, c’était ça mes week-ends. Il y avait aussi une structure de production et une structure de diffusion pour le festival et ce qui était magnifique, c’est que tous les réalisateurs venaient travailler là au quotidien. Donc on pouvait assister à une discussion en russe entre Abderrahmane Sissako, Souleymane Cissé et Abdoulaye Ascofaré parce qu’ils avaient été formés à Moscou !
Stéphane Goudet : Oui, au VGIK.
Philippe Lacôte : Sarah Maldoror aussi qui était souvent là, Nacer Khemir passait, et j’en oublie plein !
Stéphane Goudet : L’auteur de La Trilogie du Désert.
Philippe Lacôte : Voilà. Il y avait Souleymane Cissé évidemment, et Adama Drabo, Fanta Régina Nacro, etc. Un grand lieu de débats, tous les jours à partir de 19 h c’était apéro jusqu’à 21 h. Mais apéro constructif ! Tout le monde pouvait passer, à ATRIA on travaillait de 7 h du matin à 22 h le soir. Quand j’y suis entré, j’ai déménagé pour venir habiter à 200 m de la structure. En fait c’était un sacerdoce. J’étais l’assistant d’Andrée, dans son bureau pendant deux ans, et chaque fois qu’elle raccrochait son téléphone, elle me disait : « La personne que je viens d’appeler, c’est telle personne, elle a fait ça, et ça, et ça ». J’ai pris une certaine histoire du cinéma africain comme ça. C’était aussi le moment où j’avais un court-métrage, Le Passeur, dont on va voir un extrait, qui était bloqué. Je n’avais pas d’argent pour le finir. Mais quand je travaillais à ATRIA, je n’ai jamais dit que j’étais cinéaste, j’étais au service des autres cinéastes. On travaillait avec des cinéastes qui étaient à l’autre bout du monde. Des fois je me retrouvais au labo à l’étalonnage avec le réalisateur au téléphone, et c’est moi qui devais transmettre ce qu’il fallait changer. C’était des missions importantes artistiquement, une très belle époque.
Stéphane Goudet : Avant de faire Le Passeur, tu as fait un autre court, Affaire Libinski, qui est un film très particulier dont on va voir un tout premier extrait puisqu’il est fondé sur des images fixes.
Philippe Lacôte : C’est un peu faussé, en fait Le Passeur est sorti après Affaire Libinski mais Le Passeur a été tourné avant, si on voit Denis Lavant on comprend.
Stéphane Goudet : Denis Lavant, qui est dans les deux films, et qui est l’acteur fétiche de Leos Crax que tu as cité tout à l’heure comme passant à ATRIA.

Affaire Libinsky
Philippe Lacôte : On peut parler d’Affaire Libinski, en fait au départ je n’étais pas cinéphile, j’étais collé à un cinéma et je regardais des films d’arts martiaux et des films de Bollywood. Mais, c’est les meilleurs films pour apprendre la structure. Au Cratère, je suis devenu un grand fan de la Nouvelle Vague, où le cinéma est lié à la vie. C’est comme ça que je vois le cinéma : le geste et l’acte de création en même temps. Donc Affaire Libinski, c’est un film qui est en image fixe comme La Jetée de Chris Marker, c’est une sorte d’hommage, de reprise d’un procédé qui fait appel à la radio aussi parce qu’il y a une bande sonore.
Stéphane Goudet : Et bien on va en regarder un extrait de 3 minutes.
– Extrait n°1 : 14:26 à 17:20 (Affaire Libinski)
Stéphane Goudet : Alors, deux mots sur la raison de ce choix. D’abord j’aimais bien que ça finisse sur la fabulation, parce que c’est une question importante dans ton cinéma, et dans cet extrait, il y a deux choses qui m’intéressent : la première c’est la contradiction entre un film en image fixe qui va enregistrer une poursuite, par définition un art du mouvement. Ton expérience de radio est très prégnante dans cet extrait puisque le mouvement est aussi bien donné par le montage que par le son.
Philippe Lacôte : En fait, je suis un grand fan de cinéma muet. Le cinéma a commencé par le fusil photographique, par des gens comme Etienne-Jules Marey qui travaillait sur image fixe. C’est une succession d’images fixes qui ont fini par donner le mouvement. Je voulais revenir à ces origines, mais au début, en commençant à travailler avec les acteurs, ça ne marchait pas ! Je disais à Denis Lavant : « Tu marches et on va faire une photo ». Il marchait, on faisait une photo et la photo ne nous parlait pas. A la fin, on faisait des petits gestes, comme un photogramme qui va résumer et incarner le mouvement et l’émotion qu’il y a dans la séquence entière. En image fixe, c’est la bande-sonore qui crée le rêve, qui crée le mouvement. Pour ce film, on a fait 1 400 photos. On a travaillé en fiction, mais on est allés aussi au Port du Havre, où on a travaillé en documentaire. Les journalistes que vous voyez sont les vrais journalistes de RFI, on a réussi à avoir une autorisation de RFI, donc c’est le vrai journal. Il y a de la fiction en image fixe, en moyen format, et il y a le travail documentaire qu’on faisait avec un Leica, avec quelque chose de plus léger, parce que le moyen format ça peut être un peu lourd, pour apporter de la dynamique, du mouvement. C’est un film que j’ai coréalisé avec Delphine Jaquet, et c’est mon chef opérateur qui a développé toutes les pellicules en moyen format, donc on travaillait vraiment de manière artisanale.
Stéphane Goudet : D’autres choses frappantes dans cet extrait, c’est l’enchâssement du récit, parce qu’il y a plusieurs récits. Il y a une scène de poursuite, qui pourrait être très classique, mais il y a aussi la poursuite plus abstraite par la presse, une sorte de chasse à l’homme avec des inserts sur les articles de journaux, et il y a un autre récit qui s’infiltre, celui de l’avocat, un contre-récit qui vient raconter une autre histoire que celle de la presse.
Philippe Lacôte : Il y a les deux récits. La course, c’est M le maudit. Sinon, je travaille beaucoup sur la contradiction des récits, qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux, et sur combien d’histoires il y a autour d’une histoire. Combien de versions ? Combien de récits ? Quels sont les récits qui sont vrais ? Quels sont les récits qui sont faux ? Quels sont les récits à moitié vrais ? Que ce soient des récits de famille ou des récits politiques, c’est quelque chose qui m’intéresse.
Stéphane Goudet : Tu travailles aussi sur un autre motif, en général associé à Alfred Hitchcock : la fausse culpabilité. Dans ce film, se pose la question de savoir si c’est un vrai ou un faux coupable, si la société n’est pas en train de choisir un bouc émissaire.
Philippe Lacôte : Je n’ai jamais un personnage qui va au travail et qui paye un loyer. Je n’ai jamais filmé ça et je ne sais pas comment filmer ça. Tous mes personnages sont des marginaux, en parallèle de la société. Ce qui m’a donné envie de faire ce film, c’était une chasse à l’homme, celle de Khaled Kelkal, un jeune terroriste français d’origine algérienne, qui après avoir mis une bombe sur le TGV était pourchassé par la police et le déchaînement des médias. Il y avait déjà deux versions sur les conditions exactes de sa mort, et c’est ça qui m’a amené à faire le film.

Le Passeur
Stéphane Goudet : Alors on passe au suivant, que tu as donc fait avant, Le Passeur, 2005. Est-ce que tu peux nous raconter d’où est venu ce récit, dont on verra ensuite le tout début ?
Philippe Lacôte : Là c’est une fiction. J’avais envie de tourner avec Denis lavant, qui est un acteur de Leos Carax, un acteur que je trouve très inventif, que j’ai repris dans La Nuit des Rois aussi. J’habitais à Toulouse et Denis Lavant passe au théâtre. Je vais le voir et lui dis que je voudrais tourner un conte de fées avec lui, un chevalier qui va libérer une princesse. Il me dit de lui amener le scénario le lendemain. Je l’écris durant la nuit, et le lui amène avec une affiche originale du Nosferatu de Herzog, et c’est comme ça qu’on a fait ce film.
– Extrait n°2 : 24:55 – 27:45 (Le Passeur)
Stéphane Goudet : Voici donc le tout début du film, on est vraiment dans le rêve avec un grand R, un mythe même, un conte littéraire et cinématographique, mais on sent bien qu’il y a là une autre mythologie, celle du cinéma, nourri par plein d’allusions, par exemple quand elle regarde par la fenêtre et qu’elle invite sa fille à regarder : le format de la fenêtre est un format cinématographique et quand on passe au contre-champ de l’autre côté, on a l’impression d’un projectionniste qui regarde par la fenêtre pour vérifier la qualité de sa production.
Philippe Lacôte : C’est vrai, mais ça c’est des choses inconscientes. Sur le plateau, je ne me disais pas « Je vais faire ça ». Ces choses étaient là, des fenêtres dans les fenêtres. Stéphane Piger, qui a cadré ce film, un cadreur magnifique, l’a senti aussi.
Stéphane Goudet : On part donc du conte, avec ses clichés, le cheval blanc, le sauveur… Mais ça vient culbuter un tout autre registre, la condition des femmes, parce qu’il s’agit de délivrer la princesse de son mari et que le récit est une séparation.
Philippe Lacôte : C’est une histoire d’enfermement, de solitude. Dans ce conte, elle n’en sort pas, mais c’est la petite fille qui en sort. On part du conte pour arriver à une réalité sociale. C’est aussi un hommage à l’expressionisme allemand, tourné en 35 mm, en noir et blanc. On était super pauvres quand on a tourné ce film ! On avait une heure de pellicule, donc il ne fallait pas faire plus de trois prises. Je disais souvent que c’est la première la bonne ou la dernière. Avec une au milieu, ça devait aller. Et donc, sur l’heure, on a développé 37 minutes. De 37 minutes, on a monté un film de 18 minutes. Le matériau était vraiment inspiré, je ne sais pas pourquoi mais il y avait quelque chose dans ces images. On montait dans un centre pédagogique où un monsieur avait sauvé une vieille table 35. C’est un film que j’aime beaucoup. J’ai passé sept ou huit ans dessus, dont cinq bloqués parce que je n’avais pas d’argent…
Stéphane Goudet : A l’arrivée c’est un très beau film qui d’ailleurs va être pris au festival de Rotterdam entre autres.
Philippe Lacôte : Oui, mes amis se moquaient un peu de moi. Je leur disais : « C’est un conte de fées », ils me répondaient : « Ouais, mais tu nous fatigues avec tes contes de fées, on est sur un terrain vague, il fait froid, c’est quoi ton conte de fées ? » Et à la fin, à Rotterdam, huit ans après, il a été sélectionné dans une catégorie « conte de fées » !
Stéphane Goudet : Jolie catégorie ! Tu vas en outre travailler sur un premier long-métrage de science-fiction, Banshee, conte du temps immobile et du soleil de plomb, quand même le titre le plus tordu du monde ! Mais tu ne vas pas réussir à le financer ce film-là. Quelles leçons as-tu tirées de cette expérience, en dehors du titre que tu vas reprendre pour une structure de production ?
Philippe Lacôte : Oui, notre boîte de production française s’appelle Banshee films. Banshee est une révolutionnaire irlandaise dans Les Celtiques d’Hugo Pratt qui est très rêveuse, qui a trahi son camp d’ailleurs, et c’est aussi les pleureuses irlandaises banshee, donc pour moi c’est un mot qui ouvre sur un imaginaire. Je voulais faire un film de science-fiction, sur un monde détruit. Je pense que c’est un film qui était en retard sur le moment où on l’a présenté, mais je ne pourrais plus le faire aujourd’hui parce que je suis tout le temps allé chercher des choses dedans. Il était assez riche, peut-être trop, mais sincèrement on a fait un bon développement parce que l’idée intéressait tout le monde. Je me souviens même être venu à Cannes à l’époque avec ma productrice Claire Gadéa, on avait des rendez-vous mais aucun badge, on se prenait la tête à chaque contrôle pendant 10 minutes pour pouvoir entrer !… Cela n’a pas marché parce que le scénario n’était pas assez bon, pas parce que les gens étaient contre moi. Je n’avais pas encore trouvé une manière d’incarner l’écriture, ça restait trop théorique.
Stéphane Goudet : Pourquoi dis-tu : « on était en retard », par rapport à quoi ?
Philippe Lacôte : On était en retard parce qu’on voulait travailler sur un système de rétroprojection, on voulait créer un univers un peu frontière, comme un rêve, comme si les personnages étaient dans un songe. Mais c’était la montée des films en VFX. On était un peu en contradiction sur la technique.
Stéphane Goudet : Tu as cité Banshee comme nom de ta boîte de production française mais tu en as aussi une en Côte d’Ivoire, Wassakara, qui est un quartier d’Abidjan. Pourquoi fallait-il deux structures et dans quelle mesure devais-tu être doublement producteur en plus de créateur ?
Philippe Lacôte : J’ai commencé quand j’ai fait Somnambule et Le Passeur. On a financé avec les amis que j’avais à cette époque. On avait une maison abandonnée pleines de films : on a vendu ça aux collectionneurs !
Stéphane Goudet : Tu l’as trouvée dans la région de Toulouse ?
Philippe Lacôte : Non, dans la région parisienne, on les a rapatriés à Toulouse et comme j’étais projectionniste je connaissais tous les gens qui avaient des projecteurs chez eux et qui collectionnaient des films. C’était des Hitchcock, des Chaplin, et on vendait la copie à 2000 ou 3000 francs. Cela a financé nos premiers courts-métrages. Et le reste de ces copies sont aujourd’hui à la cinémathèque de Toulouse.
Stéphane Goudet : Une belle histoire. Ça ne répond pas du tout à ma question mais ce n’est pas grave, donc je la relance, pourquoi avoir créé deux sociétés de production ?
Philippe Lacôte : C’est comme ça que je suis devenu producteur ! Si je pense à ce verre, je vais directement chercher le verre, je n’ai pas besoin de quelqu’un pour aller me le chercher. Quand j’écris un film, je pense directement à comment en trouver le financement : je fais déjà acte de production en écrivant.
Stéphane Goudet : Et la nécessité d’être producteur sur les deux continents ?
Philippe Lacôte : Je fais vraiment partie des deux continents, je fais des allers-retours entre la Côte d’Ivoire et la France, mais on n’avait pas pensé à deux structures au début. On a créé Banshee Films avec Delphine Jaquet un jour où on était chez Arte : on avait fait un documentaire au Caire, Cairo Hours, sur les poètes. Le programmateur d’Arte dit à notre producteur qu’il fallait doubler le film. Il a regardé ses chaussures et n’a rien dit. J’ai compris qu’il me fallait créer ma propre structure. Quant à Wassakara, elle a été créée le 18 septembre 2002, au début de la guerre, par nécessité.
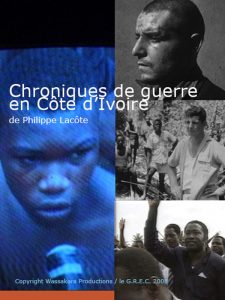
Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire
Stéphane Goudet : Tu voulais faire un documentaire à priori plutôt dirigé vers ta famille, sauf que les évènements-vont changer le cours du film et probablement du tournage. Tu vas mettre un certain temps à le monter et le finaliser. Il date donc de 2008 et s’appelle Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire. Peux-tu nous raconter ce qu’était le projet d’origine et ce qu’est devenu le film ?
Philippe Lacôte : Ce n’est pas exactement comme ça. En 2002, je décide de partir en Côte d’Ivoire pour faire un film sur un ami, sur une génération d’amis. Tous mes amis d’enfance sont soit morts en prison, soit morts d’alcoolisme. Donc je voulais raconter un peu cette génération catastrophe, celle de Barbe Noire qui est mort à la prison MACA et qui deviendra un personnage de La Nuit des Rois. Donc, j’arrive à Abidjan pour filmer quelque chose dans mon quartier, mais je ne sais pas quoi. J’arrive, caméra vidéo, tout seul avec mes cassettes, je m’installe et trois jours après, la rébellion commence, tentative de coup d’Etat. Je deviens le chroniqueur de ces trois premières semaines de couvre-feu dans mon quartier. Je me lève tous les matins, je vais là où il y a les journaux, et je filme les gens qui regardent et commentent les journaux, et je vais dans chaque camp comme ça. C’est un film au jour le jour, et c’est après ça que je ramène l’histoire de ma famille, ce n’était pas prévu au départ. Et si le film a mis six ans à être fait, ce n’était pas à cause d’un problème économique, c’était un problème de montage, d’aller voir les archives. Parce que quand on filme en vidéo, en tant que documentariste, en tout cas moi je le ressentais comme ça, on peut filmer des choses en vitesse mais on ne comprend pas forcément le sens de ces images. Il faut les laisser reposer. Et quand je n’ai pas pu faire Banshee, sur lequel j’avais passé cinq ans, trois ans avec ma productrice et deux ans tout seul, je me suis décidé à sortir ces rushs. Et j’ai passé un an sur le montage, et ça a donné Chroniques.
Stéphane Goudet : Alors, on va voir un extrait de Chroniques mais avant je reviens sur cette dimension familiale. Le film est évidemment saisissant puisqu’on voit ta mère qui raconte sa vie de couple, comme si tu enquêtais sur ton père et leur histoire à eux et ton arrivée dans leur histoire. La particularité du rapport au père, c’est que ton père a été milicien. Cela permet en miroir de raconter le parcours politique de ta mère aussi.
Philippe Lacôte : Ma mère a aussi fait partie des milices jeunes patriotes, qui sont dans le film aussi. Donc quand j’ai commencé Chroniques, Delphine Jaquet qui est toujours ma partenaire en montage et en production, m’a rappelé que je ne pouvais faire un film aussi personnel sans dire que mon père était pro-nazi, milicien. Et donc j’ai reconstitué le parcours de mon père d’une manière fictionnelle à partir de ce que je savais, avec les inconnus aussi, par des images d’archives. C’est comme si j’allais le chercher dans les archives. J’ai passé un an toutes les nuits sur le site de l’INA à regarder des archives de guerre, à les sélectionner et fabriquer un récit. Pour moi, c’était important de raconter cette histoire, parce qu’en France, on ne dit jamais qu’il y a toute une jeunesse qui a réellement adhéré aux idées nazies. Et donc, je suis un grand fan du film Lacombe Lucien de Louis Malle. J’ai fait Chroniques à un moment où je n’arrivais pas à faire le long-métrage et, en fait, j’avais l’impression que le cinéma français me bloquait. Pas personnellement, mais il me bloquait parce que je ne rentrais pas dans les codes. Je ne venais pas de La Fémis, je ne venais pas de Louis Lumière, et on me le disait. Donc j’ai aussi fait ce film pour dire que je venais de la marge française, et que j’étais prêt à l’assumer.
Stéphane Goudet : Vous aviez fait une école, vous avez fait Le Cratère !
Philippe Lacôte : Mais oui, c’est une école ! Et j’ai squatté Louis Lumière pendant un an.
Stéphane Goudet : Allez, on va regarder un extrait.
– Extrait n°3 : 43:50 – 46:50 (Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire)
Stéphane Goudet : C’est un extrait assez dense !
Philippe Lacôte : Oui, mais c’est là que la radio revient parce que là c’est du micro-trottoir, il faut descendre dans la rue. On est deux, avec mon meilleur ami qui était mon assistant, et on fait comme si on était complètement naïfs, donc on ne pose aucune question. Je dis : « On va allumer la caméra et vous allez dire ce que vous avez envie de dire ». C’est un peu dangereux quand même, mais je fais comme si je ne sais pas la portée de ce que je suis en train d’enregistrer.
Stéphane Goudet : Dangereux parce que pour le coup tu es vraiment pile à l’endroit où l’Histoire est en train de trembler ! Comment vois-tu le film aujourd’hui par rapport à l’Histoire de la Côte d’Ivoire ?
Philippe Lacôte : Ce film est vraiment fondateur de mon travail. Depuis ce film, depuis 2002, j’ai toujours tourné en Côte d’Ivoire. Dans mes premiers films en noir et blanc, on sent une esthétique, une recherche de cinéma, mais il n’y a pas de territoire personnel, d’ailleurs les deux films se passent nulle part. Avec Chroniques, j’ai trouvé mon territoire. Je n’avais jamais filmé en Côte d’Ivoire. Ce fut comme un baptême. J’étais devenu par la force des choses un observateur de cette guerre, avec des images que personne n’a. J’ai même le premier communiqué à 4 h du matin sur le coup d’Etat, parce que ma caméra était déjà en face de la radio, j’étais déjà prêt. Pouvoir attraper ce moment-là en tant que cinéaste, c’est un cadeau. Trois jours avant, je ne savais pas pourquoi j’y allais. Les hommes politiques du film, je les voyais dans mon salon quand j’étais enfant puisque ma mère faisait de la politique. Et ce qui me fascine, c’est comment la politique devient une histoire, le narratif du politique.
Stéphane Goudet : On voit dans cet extrait que ta position est potentiellement problématique, perçu comme entre la France et la Côte d’Ivoire. Tu dis d’ailleurs qu’il faut quelqu’un qui t’accompagne pour pouvoir être légitime à cet endroit.
Philippe Lacôte : Quand je filmais Chroniques, je voyais des caméras de France 2 qui étaient cassées à cinq mètres de moi pendant que je continuais à filmer, c’est-à-dire que j’avais des autorisations spéciales pour pouvoir filmer sinon ce n’était pas possible, c’est pour ça que quelqu’un m’accompagnait parce que les gens étaient très énervés. En fait j’ai voulu dire par cet extrait que j’étais métisse et que je pouvais être vu des deux côtés, mais en fait en Côte d’Ivoire je n’ai pas ce problème, je suis vraiment chez moi et j’ai développé une méthode de travail qui me permet d’aller avec des assistants dans des endroits qui sont peut-être dangereux; où le sujet peut être sensible. Quand on a fait La Nuit des Rois, 25 % des figurants étaient des junkies ou des ex-prisonniers mais je voulais la réalité de la prison. Je n’ai pas de problème en Côte d’Ivoire, c’est un territoire dans lequel je suis complètement installé.
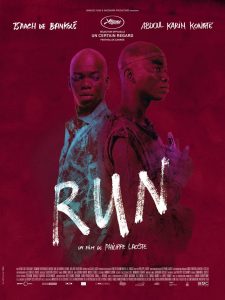
Run
Stéphane Goudet : Avec ton premier long-métrage, Run, tu gagnes le prix du Jerusalem Film Lab et il fait partie des projets retenus à la Cinéfondation. Donc, puisqu’on est à Cannes, à quoi t’a servi la Cinéfondation pour ce film ?
Philippe Lacôte : Avant de faire Run je me disais « Si ce film ne passe pas, j’arrête de faire du cinéma ». Donc comme il s’appelait Run, j’ai passé trois mois à courir tous les matins ! Je répétais mon pitch pour Amiens, qui s’est très bien passé. Georges Goldenstern est venu me voir. Je ne connaissais personne à ce moment : je sortais de cinq ans enfermé chez moi, d’un an de montage de Chroniques et à faire la voix-off. Georges Golderstern vient me voir, parce que pour l’atelier Cinéfondation, c’est eux qui viennent te voir pour que tu candidates. J’ai répondu que j’en parlerai à ma productrice qui a sauté de joie. Pendant tout le festival, on a des rendez-vous avec des professionnels. Vingt rendez-vous par jour, on pitche nos projets, on rencontre des producteurs, des distributeurs, des coproducteurs… Madame Diomandé, qui était directrice du cinéma au ministère de la culture et qui dirige maintenant l’ONAC-CI, et le ministre de la Culture de l’époque Maurice Bandaman sont venus à Cannes pour annoncer qu’ils soutenaient le film et ça, ça a changé quelque chose. Parce qu’on était en 2012, donc un an après le conflit : tout le monde était intéressé par le film mais ils se demandaient si les conditions de sécurité étaient suffisantes et si on avait le soutien du pays. J’ai demandé à Georges Golderstern de leur organiser une visite du Palais qui s’est terminée à monter les marches avec toutes les stars et le ministre a doublé la somme qu’il avait promise !
Stéphane Goudet : Le film a été sélectionné pour Un Certain Regard, une consécration pour un premier long-métrage. Quel souvenir en as-tu ?
Philippe Lacôte : Moi je trouvais ça normal. En tant qu’ancien projectionniste, j’étais spécialement présent au test de projection. Pour la séquence où il y a de la musique à fond, Black Samouraï d’Alpha Blondy, on leur a demandé avec mon mixeur Emmanuel Crozet de monter le son parce que sinon, ça reste trop tempéré.
Stéphane Goudet : En voici un extrait, pour le plaisir de la mise en scène qui est assez remarquable.
– Extrait n°4 : 57:00 – 01:01:06 (Run)
Stéphane Goudet : Voilà une science du rythme dans le rapport entre la fixité des personnages et la dynamique des mouvements, que ce soit la figure du défilé dans l’ensemble du décor, et le mouvement de caméra qui permet de ressaisir le cadavre au sol à la fin quand on enveloppe le personnage principal, ou bien le travail sur la lumière, notamment lorsqu’il se confronte au groupe et qu’on voit les ombres projetées au sol, et le soin esthétique général qui justifie pleinement la sélection à Un Certain Regard. Est-ce que tu passes par une étape de storyboard ? Est-ce que tu as des collaborateurs artistiques qui sont en partie responsables de l’excellence de cette première fiction ?
Philippe Lacôte : Pour moi, les repérages c’est sacré. Sur internet, je cherche des endroits. C’est ainsi que je découvre Sindou, au Burkina Faso, un village avec des pics, des cascades. J’y vais avec un producteur burkinabè, dans ce lieu qui a été filmé par plusieurs cinéastes africains comme Dani Kouyaté. Quand j’y arrive, je me sens bien. Je me dis que c’est là qu’il faut tourner cette scène de sacrifice, je ne peux pas expliquer pourquoi. Pour filmer un endroit, j’ai besoin d’y aller au moins une dizaine de fois pour voir la lumière du jour, la lumière de nuit, l’après-midi, des fois je reste seul pendant deux heures dans le lieu, j’essaye de le comprendre parce que chaque lieu a sa vibration, surtout des lieux naturels comme ça. C’est un endroit où les populations font des sacrifices, c’est un endroit où ils sont allés se cacher quand il y a eu des guerres, ce n’est pas un endroit anodin. A chaque fois que j’ai une scène de mort, je prends beaucoup de temps pour choisir le décor. Là c’est un sacrifice, le lieu doit être panthéiste, mystique. Ce sont ensuite deux ans de négociation avec ce village, avec tous les vieux que vous voyez, parce que c’est le village du président Alassane Ouattara que l’on accusait d’être du Burkina. Ils en voulaient donc aux Ivoiriens. Je leur ai dit : « Non, non, c’est un conte, c’est tout ! ». On y est allés six fois, jusqu’à ce qu’ils nous connaissent. Pour cette scène, je pensais à Pasolini, la terre, quelque chose de brut… Et je n’avais pas prévu le filmage, c’est mon chef opérateur Daniel Miller qui a fait ce film, il est israélien, il avait 27 ans, il ne parlait pas français et a débarqué en Côte d’Ivoire. Je l’ai rencontré par le Jerusalem Film Lab, et il me dit : « Tu as vu ce chemin ? Il faut que les gens le montent par là ». Et c’est comme ça qu’on a fabriqué cette séquence en direct.
Stéphane Goudet : Le serpent humain.
Philippe Lacôte : Voilà, le serpent humain, et après j’ai beaucoup plus travaillé sur le cercle, sur le demi-cercle qui est assez présent en Afrique quand on distribue la parole. Après, cette séquence-là est aussi très complexe à tourner parce qu’il y a une pluie, des effets spéciaux… Mais j’aime bien ça aussi, quand il y a des défis techniques. Sur Run, je croyais encore beaucoup aux plans séquences. Maintenant, après un an et demi à Hollywood, je crois moins aux plans séquences !
Stéphane Goudet : C’est très bien fait, il y a eu des cris dans la salle et effectivement la décapitation est quand même très efficace sur le spectateur.
Philippe Lacôte : Mais ça marche. Le film a été interdit au moins de 16 ans par le CNC, car c’était l’époque des décapitations de Daesh. Ils ont donc mis un avertissement.
Stéphane Goudet : En 2018, tu réalises certains des épisodes de Les Routes de l’esclavage, une série pour Arte mais tu as enlevé ton nom du générique. Pourquoi ?
Philippe Lacôte : C’était la première fois que j’allais faire une commande. Juan Gélas m’a rejoint et je me rends compte que toute l’équipe a fait des études d’histoire sauf moi. Mais la boîte qui a produit le film, n’a jamais géré le plateau. Je n’ai pas signé car si on annule ma fonction de réalisateur, ce n’est plus possible que je signe le film.
Stéphane Goudet : Pourquoi annuler la fonction ?
Philippe Lacôte : Parce qu’à un moment, le film est complétement repris par la production qui en détermine le montage alors que c’est moi qui ai réuni grâce à mes contacts les bonnes personnes. On descendait dans des quartiers où eux ne pouvaient pas aller. A un moment, je ne me suis plus reconnu dans ce montage qui était une sorte de faux speed américain. Mais le travail d’enquête qu’on a fait pendant deux ans m’a appris à comprendre le continent africain. L’esclavage est une porte très intéressante pour lire le continent africain ainsi que les échanges avec les Caraïbes et l’Amérique. Cela a changé ma lecture des choses.
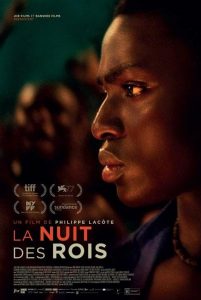
La Nuit des rois
Stéphane Goudet : La Nuit des rois en 2020 : un film fait à la fois de souvenirs d’enfance (lorsqu’à 8 ans, tu rendais visite à ta mère en prison) et du désir de reconstituer cette prison.
Philippe Lacôte : En fait, je travaille toujours sur l’intime. Je ne travaille sur aucun sujet qui ne m’est pas personnel, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Mais je ne le décrète pas. Devenu un raconteur d’histoire, je raconte tellement d’histoires que je ne vais plus les chercher, j’attends qu’elles viennent. On a tourné Run en pleine crise politique un an après la guerre dans un décor très sensible. Je le savais, mais j’étais tombé amoureux de ce décor. Ma photo a été mise en une des journaux de l’opposition pendant deux semaines : « Cet homme est dangereux. Cet homme fabrique de fausses preuves pour La Haye contre le président Gbagbo ». Mes enfants et moi et mes enfants étions suivis, des gens débarquaient sur nos plateaux, c’était très compliqué mais on n’a jamais perdu une journée de tournage. Le jour où ils ont publié ma photo pour la première fois, j’ai fait changer le plan de tournage pour aller dans la rue pour que les gens nous voient en disant : « Si on se cache aujourd’hui, c’est fini ». Mon principe c’est qu’on ne fait rien de mal, on a le droit de raconter l’histoire du pays. Un soir, je croise un ami qui sort de prison, celle de Yopougon, dans mon quartier. J’ai des amis qui sont morts là-bas. Quand je vais à Abidjan, il y a toujours une journée réservée pour aller voir ceux qui sont en prison. Et donc il me dit « En prison, on choisit quelqu’un, on l’appelle « roman » et il doit nous raconter des histoires toutes les nuits ». Moi, j’ai mis ça en une nuit et boum ! La violence, la narration… En fait mon travail est sur la violence, je questionne la violence.
La prison, la MACA, je la connais par cœur parce qu’en fait les parloirs sont publics, une grande pièce de 300m². En tant que visiteur, tu croises d’autres prisonniers, tu as des interactions. Quand tu fais ça pendant un an une fois par semaine et que tu traverses une forêt dans un taxi collectif et que tu as 8 ans, ça te laisse des images ! Et j’ai été frappé par le fait qu’en prison, tout le monde fonctionnait en double. Il y avait toujours des rois et des valets, parce que comme il y a beaucoup de gens qui n’ont pas les moyens de survivre, si quelqu’un a de l’argent tu deviens son assistant, tu l’aides à porter son sac. Donc il n’y a jamais quelqu’un qui est seul, il y a toujours quelqu’un qui est associé à un autre et ça, j’avais l’impression que c’était un royaume où il y avait des rois, des reines et des valets. C’est pour ça que j’ai écrit La Nuit des rois.
Stéphane Goudet : Alors, on va voir le dernier extrait et ensuite on passera à ton actualité immédiate.
– Extrait n°5 : 01:17:40 – 01:21:40 (La Nuit des rois)
Stéphane Goudet : On voit le dispositif narratif, le montage alterné entre le temps du récit et la reconstitution, mais aussi des danseurs, des artistes, pour incarner le récit.
Philippe Lacôte : Sur le tournage, au scénario, on les appelait des « joueurs », c’est-à-dire qu’ils devaient rejouer, ou comme on peut dire dans les Caraïbes des « répondeurs » aussi. Des hommes qui reprennent ce qui est dit, parce que j’avais envie aussi que la prison soit un lieu d’incarnation de ce récit. La prison, c’est une histoire de corps. En plus de l’expérience de visiteur de prison enfant, j’ai fait beaucoup de ciné-clubs dans les prisons en France, notamment pour montrer Affaire Libinski. Une prison en dit beaucoup sur la société. Je n’ai jamais fait de prison mais j’ai un frère qui y est pour de nombreuses années, donc je suis encore visiteur de prison ! La question qui se pose est de savoir si le corps va survivre à cet enfermement. Tout le film est donc sur l’immobilité du corps et du coup l’extravagance de l’esprit et de l’imaginaire, car comme le dit Frantz Fanon, le colonisé comme le prisonnier rêve qu’il saute des ponts, qu’il escalade des immeubles. On pouvait donc partir dans une hyperbole du récit. C’est pour ça qu’il y a des reines, des rois, des combats…
Stéphane Goudet : Ton film avait été à La Fabrique, qu’est-ce que ça t’a apporté ?
Philippe Lacôte : Le parrain était Cristian Mungiu. J’avais hésité parce que je me disais que j’avais déjà fait trop de choses pour qu’on me prenne. J’ai su après que ma candidature avait été très discutée, mais la perspective d’un film allant dans un gros festival était intéressante aussi.
Stéphane Goudet : Il était à Venise et Toronto.
Philippe Lacôte : Quand je suis venu, j’ai un peu fait profil bas parce que je connaissais tous les intervenants, c’était un peu gênant. On a quand même gagné le prix du scénario Orange. L’entrevue avec Cristian Mungiu, qui a gagné une palme d’or, a duré deux minutes. Il m’a dit : « Ton film, c’est sur quelqu’un qui raconte ? » J’ai dit oui. Il m’a dit : « Il devient conteur en prison ? » J’ai dit oui. Il m’a dit : « Fais-le se tromper et reprendre l’histoire. »
Stéphane Goudet : Il est très fort Cristian Mungiu !
Philippe Lacôte : Il avait tout compris et moi je n’avais pas vu ça. Donc il y a un moment où Roman dit : « Excusez-moi, je vous l’ai mal raconté », et là tout le monde comprend qu’il est en train de s’exercer au conte. Donc j’espère être à la hauteur de Cristian Mungiu !
Stéphane Goudet : Terminons sur tes deux projets en cours, que tu mènes de front aux Etats-Unis, d’une part Killer Heat avec Amazon Studios, et un projet personnel, Les 7 voleurs d’or, dans le cadre des résidences d’écriture de la Villa Albertine aux Etats-Unis. Produire aux Etats-Unis ou en Europe, c’est extrêmement différent, une façon de découvrir la méthode américaine.
Philippe Lacôte : Oui, c’est pour ça que je suis allé là-bas. C’est intéressant de découvrir les endroits où on fait du cinéma et les systèmes où on fait du cinéma différent. Je suis un voyageur, je suis curieux, dans chaque film j’essaye de mettre une nouvelle technique. La Nuit des Rois m’amené aux Oscars, qui m’amènent à Toronto où je gagne un prix. Cela a fait qu’un agent américain est venu me voir pour me proposer de signer dans son agence. Au départ, je dis non, mais le boss de l’agence a fini par me convaincre. Du coup, j’ai le super boss, le même agent que Michael Mann. Aux Etats-Unis, les producteurs ont le scénario et ils cherchent le réalisateur. Cela veut dire pendant trois ou quatre mois des entretiens, des moodboards, et à la fin, j’ai été choisi. Killer Heat est un film de genre, cela signifie des codes que nous avons en commun, sinon je ne l’aurais pas fait.
Stéphane Goudet : Sur quel genre alors ?
Philippe Lacôte : C’est un film noir. Un détective arrive en Grèce, et va essayer d’enquêter tout en réglant ses problèmes personnels : l’outsider des films noirs qui a sa propre morale, qui boit, qui est hanté par son passé…
Stéphane Goudet : Tu es donc réalisateur sans intervenir sur le scénario.
Philippe Lacôte : Je suis un peu intervenu sur le scénario en réécriture, même si après il a encore été réécrit. On était 250 sur le plateau et il y avait une super énergie. Bon, ils étaient un peu surpris par ma manière de travailler. « Philippe tu ne dois pas choisir les figurants, faut te reposer ». J’ai dit non ! Et à un moment, je leur ai dit : « Rien de ce qu’il y a à l’image ne m’est impersonnel ». Tout ce qu’il y a dans l’image me concerne, même si c’est une fourmi, sinon on l’enlève. Des fois, ils me disaient : « Attends, là c’est 30 secondes, on peut le tourner vite ! ». J’ai dit : « Si ce n’est pas utile, ne le tournons pas ! Mais si on le tourne, on le tourne bien. » A un moment, on avait des problèmes de décor : j’ai demandé à venir deux heures avant pour les installer. C’est un travail de 7 h du matin à 22 h. On a fait les repérages, l’écriture de scénario, le casting des techniciens et des acteurs et on a enchaîné le tournage directement.
Stéphane Goudet : Tout en travaillant en même temps sur Les 7 Voleurs d’or ?
Philippe Lacôte : Sur ce film, j’ai embauché ma propre équipe en France, mon propre storyboarder et quelqu’un qui faisait des recherches pour m’aider à répondre aux Américains, parce que ça allait trop vite pour moi. Donc j’ai créé une équipe en back que j’ai payé avec l’argent de mon salaire. Je faisais travailler des gens derrière pour répondre à la vitesse à laquelle ils allaient.
Merci à Noélia Dominique pour l’aide à la transcription.










Un commentaire
N’oubliez pas Jean René Debrix qui a mis sur pieds le cinéma africain francophone au Bureau du cinéma qui fur remplace à sa fermeture par Atria et Mme Daventure était proche de lui, Il fut aussi un des fondateurs de l’IDHEC et permis l’accès à cette école par le biais des Affaires étrangères à des étudiants comme Paulain VIera,
Maurice Tanant réalisateur et son neveu