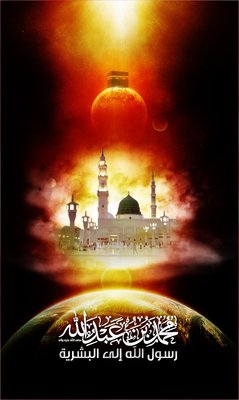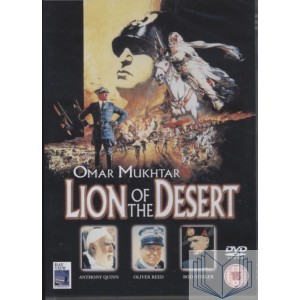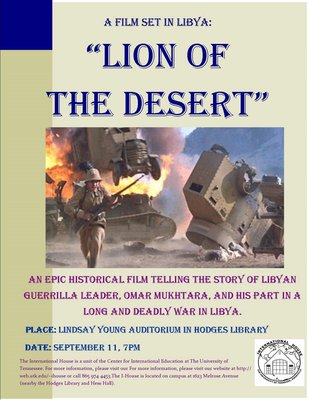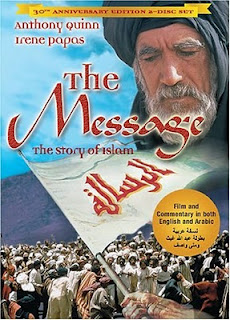Ramadan Salim est né en 1953 à Azizia (Libye). Il est écrivain, journaliste et critique littéraire et de cinéma. Il a commencé à écrire en 1979 sur la littérature libyenne et n’a jamais cessé depuis. Il dirige aussi The International Mediterranean Film Festival for Documentary and Short Films (sous le parrainage du ministère libyen de la Culture), prévu du 11 au 18 juin 2012 à Tripoli (cf appel à propositions [à lire ici]). Son travail porte sur la culture arabe en général, et sur la littérature et le cinéma maghrébins en particulier. Il a publié les romans Journey and Discover (1997), Critical Dimension (2000), et des essais sur le cinéma : The individual man in the circle of adventure (1981) et Cinema. The horizon and the reality (1982). Il est le rédacteur en chef du mensuel artistique Rainbow, journaliste au quotidien February mais aussi bloggeur et auteur de critiques dans différents journaux et magazines libyens.
Pourriez-vous nous parler de l’industrie du film en Libye : production et diffusion ? Je sais que la Libye a produit six longs métrages, une quarantaine de courts et deux centaines de documentaires
Vous savez, la Libye est un pays pauvre. Avant 1965, nous n’avions vraiment rien. Le pétrole n’a été découvert que vers 1963 et auparavant, la Libye était pauvre. L’Italie, comme puissance étrangère, a fait quelques films courts et documentaires sur la Libye. Après que l’Italie quitte le pays en 1951, le royaume de Libye a produit quelques courts métrages sur la cité antique de Lebtis Magna, à des fins touristiques.
Le premier long métrage libyen date de 1972, un film en noir et blanc : The Destiny is very har, également connu sous le titre When Fate Hardens (Indama Yaqsu al-Zaman) du cinéaste libyen Abdella Zarok, où jouaient des acteurs libyens. Vint ensuite The Road (al-Tariq) en 1974 de Mohamed Shaaban. A cette époque, en 1973, le cinéma a été organisé autour de The General Organisation for Cinema, qui a réalisé des documentaires, entre 20 et 25 courts et était également impliqué dans la réalisation de longs métrages. Nous avons aussi produit en 1977 The Green Light (al-Daw’ al-Akhdar) d’Abedalla Mushbahi, une coproduction incluant des acteurs égyptiens, tunisiens, marocains et libanais, en somme un film arabe !
En 1983, ce fut un film de guerre, Battle of Tagrift (Ma’rakat Taqraft) de Mushafa Kashem et Mohamed Ayad Driza sur la bataille qui opposa les armées italienne et libyenne. Un autre film a gagné des prix dans des festivals internationaux, notamment le second prix en Corée du Nord vers 1985 : The Bomb Shell qui porte également le titre The Splinter (al-Shaziya), réalisé par Mohamed Ferjani. Et le dernier long métrage date de 1993/94, Symphony of Rain (Ma’azufatu al-matar), d’Abdella Zarok. En 2010, l’Organisation du cinéma a cessé d’exister et la production s’est arrêtée.
Comment un Libyen pouvait-il voir des films libyens ?
Pour un Libyen, il n’était pas aisé de voir un film libyen ! Ce n’était possible qu’à l’Organisation du cinéma à Tripoli, qui est liée au ministère de la Culture, mais qui ne faisait pas cinémathèque. Elle était dotée d’une salle où l’on pouvait visionner les copies originales des films, mais on ne pouvait les emprunter. On ne les trouve pas en DVD et seulement un ou deux étaient en VHS. Les Libyens n’avaient donc pas accès aux films libyens. Nous envisageons maintenant de les diffuser en DVDs. Mais il serait dorénavant préférable, dès qu’un film est réalisé, de le publier sur internet en vidéo à la demande et d’en faire la promotion ici. C’est comme ça que les gens pourront le voir.
La Libye comporte quelques salles et galeries d’art. Il n’y eut longtemps aucun théâtre public et juste quelques cinémas montrant des films étrangers. Quelle est l’histoire des salles de cinéma en Libye ?
Des années 40 aux années 60, il y avait beaucoup de cinémas mais ils ont arrêté leur activité. Il y en avait 14 à Tripoli, une dizaine à Bengazi. Ils montraient des films italiens ou égyptiens, mais aussi indiens et américains. Après 1975, le gouvernement a pris le contrôle des cinémas, lesquels ne pouvaient plus se procurer des films à l’extérieur du pays. Ils ont fermé peu à peu. Il nous faut maintenant repartir de zéro.
Vous dirigez le International Mediterranean Film Festival for Documentary and Short Films qui débute en juin 2012. Quelles perspectives et défis voyez-vous pour ce festival ?
Il y a bien sûr de nombreux défis mais nous nous y attelons ! Nous avons des réalisateurs, des cameramen, des équipes techniques. Et nous avons une académie où 100 à 150 étudiants apprennent à cadrer, à réaliser, à monter. Il y a aussi des cours d’histoire du cinéma. La plupart trouvent du travail dans les huit chaînes de télévision existantes et la différence n’est pas marquée avec le cinéma. Il nous faut aussi rebâtir nos salles de cinémas : nous en avons cinq ou six qui pourraient être rénovées. Cela prendra quelque chose comme une année.
Le travail a-t-il déjà commencé ?
Vous savez, ce sont de vieux cinémas avec 400 ou 500 sièges. Nous construisons maintenant un nouveau cinéma, un petit, avec de 100 à 200 sièges. Cette salle sera gérée par le Libyan Cinema Club. Le Club y montrera un film par semaine et y tiendra des séminaires sur le cinéma. Nous produirons aussi quelques films suite à des appels à propositions à destination des cinéastes libyens. Cela prendra un peu de temps mais pas trop, j’espère. Nous pourrons peut-être démarrer le processus dans un ou deux ans, tout dépendra des fonds disponibles. La Lybie doit se concentrer sur sa reconstruction, et c’est une priorité. Mais nous espérons pouvoir produire à terme un ou deux longs métrages par an, une dizaine de courts et des documentaires. Tout dépendra des moyens financiers.
Vous disiez que le festival est financé par le ministère de la Culture. Pensez-vous que le nouveau gouvernement voit le cinéma différemment du précédent ?
Avant, tous les films étaient issus d’un contexte politique. Une personne décidait : Muammar Khadafi. Par exemple pour Battle of Tagrift, Khadafi a écrit l’idée et a financé le film en ordonnant au ministère de la Culture de le produire. Pour les courts et les documentaires, nous étions un peu plus libres mais pour les longs, c’était Khadafi. Il était le premier à voir le résultat et à décider de sa sortie. C’est ainsi que Leyla, également connu sous le titre Searching for Layla al-‘Amiriya (al-Bahth’An Layla al-‘Amiriya), sur une femme libyenne nommée Leyla que l’on avait séparé des autres femmes, un film qui a été fait il y a 25 ans, n’est jamais sorti : Khadafi ne l’aimait pas et nous ne l’avons jamais vu ! Le réalisateur était un Iraquien, Kasem Hwel, qui vit maintenant aux Pays-Bas. Leyla est un bon exemple : seul le réalisateur a une copie du négatif. Le film était entreposé dans les archives et je suppose qu’il est perdu. Tout cela parce que l’industrie du cinéma dépendait d’un seul homme. Et même maintenant, cela reste délicat car le film et sa production étaient liés à l’ancien régime, au « système Khadafi ». Il avait créé une maison de production appelée Rays qui produisit cinq films, notamment Earth of fear, des films égyptiens avec des acteurs et actrices égyptiennes car son but n’était que de se montrer sur le tapis rouge avec eux. Ils allaient le voir et ils profitaient ainsi de leur aura. Ce n’était jamais des Libyens mais des Egyptiens. Son fils, Al-Saadi Khadafi, qui vit au Niger, était producteur dans une maison hollywoodienne et a produit plus d’une dizaine de films à Hollywood. Ses investissements étaient financés par l’argent du peuple libyen… C’était le système Khadafi. Le peuple, l’argent, les filles et les femmes appartenaient à Khadafi. Ceux qui refusaient d’entrer dans le jeu étaient jetés en prison ou assassinés. Donc, maintenant, cela va prendre un an ou deux pour abolir ce système et nous allons repartir sur un bon pied, et nous ferons des films !
En partenariat avec Africavenir (traduction Olivier Barlet).///Article N° : 10730