Avec la sortie l’an dernier de son premier album, Lucha, chronique d’une révolution sans armes au Congo (Ed. La Boîte à Bulles – 2018), BD-reportage centrée autour d’un mouvement pacifiste Congolais (RDC), la dessinatrice franco-camerounaise Annick Kamgang a fait sensation dans le milieu du 9ème art africain. En effet, à l’exception du centrafricain Didier Kassaï (Tempête sur Bangui, Maisons sans fenêtres), les dessinateurs du continent produisent peu de bande dessinée engagée. Cette particularité fait du témoignage fort et édifiant que constitue Lucha une belle exception dans la production actuelle. Retour sur le parcours atypique de cette jeune dessinatrice décomplexée et talentueuse.
 Comment est né ce projet d’album sur La lucha ?
Comment est né ce projet d’album sur La lucha ?
Je crois qu’on entre dans la bande dessinée par des rencontres. Je n’ai pas fait d’études des Beaux-arts au départ. Et dans ce cas-là, c’est une rencontre avec Dominique Meyer – dont le nom de plume est Bearboz – un dessinateur de presse français au Maroc qui travaillait dans un journal qui s’appelait L’Économiste. Aujourd’hui, il vit en France et a été remplacé par Rik. A l’époque je faisais du dessin de presse pour Jeune Afrique et prenais des cours du soir. C’est lui qui m’a dit que La Boîte à bulles cherchait à faire quelque chose sur l’Afrique, en particulier sur des mouvements citoyens comme Y’en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina, et Lucha en République démocratique du Congo.
Aviez-vous envie de faire de la bande dessinée depuis longtemps ?
Pour donner une image, le dessin de presse c’est le sprint alors que la BD, c’est le marathon. Et je ne savais pas à l’époque si je pouvais travailler en continu sur plusieurs mois sur un sujet, écrire un scénario. J’ai fait quelques planches d’essai qui ont été refusées dans un premier temps.
Qu’est ce qui n’allait pas ?
En effet, je me devais de trouver un style graphique propre à la BD. Je ne maîtrisais pas bien mon encrage. Mais ma chance est que mon éditeur m’a laissée un peu de temps et m’a orientée vers des auteurs dont je me suis inspirés.


Comment avez-vous travaillé avec la scénariste ?
Au début j’avais un autre scénariste mais il n’a pas pu continuer sur le sujet. Un autre dessinateur m’a parlé de Justine Brabant qui travaille depuis de nombreuses années sur le Congo et avait écrit un livre sur les miliciens de l’Est, Qu’on nous laisse combattre et la guerre finira. Je l’ai contactée et elle a tout de suite été d’accord. Elle trouvait intéressant de travailler sur des militants de droits humains pacifiques après avoir travaillé sur des miliciens. Évoquer l’audace de ces gens qui luttent pacifiquement dans un espace en guerre permanente depuis 25 ans lui a beaucoup plu. Donc, on est parties d’un synopsis rédigé par Justine, avec l’éditeur. A partir de là, Justine a découpé en chapitre, avec les dialogues, les off, case par case. Tout cela s’est fait en deux parties. Mais La lucha était un sujet sensible dans le sens où les militants sont régulièrement arrêtés et passent souvent en procès. On ne pouvait donc pas faire n’importe quoi. Je n’ai d’ailleurs pas eu l’occasion de présenter l’album en RDC, on y avait été invitées pour le salon du livre en novembre dernier mais les militants de la Lucha nous ont déconseillées de venir car c’était en plein milieu de l’élection présidentielle. On a donc dû renoncer. C’est là où je me suis rendu compte que j’avais une situation privilégiée car je parle de l’Afrique mais je vis en France avec un passeport français. Ce n’est pas la même chose que mes confrères africains.
Dans quelle mesure l’éditeur vous laisse-t-il une grande liberté ?
Dans cette collection, on y trouve de tout, des formats différents, des dessins en noir et blanc comme moi ou bien ceux de Didier à l’aquarelle. Même le nombre de pages change selon les albums. Mais cela s’inscrit surtout dans le mouvement du roman graphique. Cela m’a beaucoup plu et je me situe d’ailleurs pleinement dans ce courant. A tel point que je ne sais même pas tellement quels sont les codes traditionnels et les standards de la Bd franco-belge. Mais aujourd’hui, en bande dessinée de façon générale, on fait un peu ce que l’on veut et c’est chouette car j’arrive à ce moment-là.
Quel est votre parcours ?
Je suis née en 1980 à Yaoundé au Cameroun. J’ai toujours dessiné mais ne savais pas que l’on pouvait en faire un métier. C’était plus pour moi un loisir qu’autre chose.
Autour de l’année 2010, à la trentaine, après une première carrière professionnelle, j’ai donc décidé de retourner à ma passion première qu’était le dessin. J’ai pris des cours du soir à la ville de Paris : Modèle vivant, Bande dessinée. A partir de là, je me suis demandée comment reprendre le dessin et prendre en compte mon histoire familiale sur laquelle je vais revenir. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à faire du dessin de presse.


Comment avez-vous commencé ?
Par une simple discussion ! En 2013, une amie m’a parlée du journal L’Opinion qui organisait un concours pour recruter son dessinateur de presse. J’ai participé et n’ai finalement pas été retenue. Mais cela m’a démontré que j’étais capable de faire un dessin par jour. Certains des dessins que j’avais proposés sont même sortis dans ce journal durant la période du concours. Je me suis rendue compte que ce métier me correspondait et cela m’a encouragé.
Alors, j’ai commencé à envoyer mes dessins à plusieurs journaux, dont Jeune Afrique. Au bout de plus de 6 mois de tentatives, la rédactrice en chef m’a contactée et m’a proposée de publier mes dessins. Ce fut le début. Cette collaboration a duré environ trois ans, jusqu’en 2018, période pendant laquelle, j’y ai publié un dessin de presse chaque semaine. Cette année-là, j’ai arrêté pour me consacrer à la bande dessinée mais je n’exclus pas d’en refaire un jour.
Vous nous avez parlé d’une première carrière professionnelle avant 2013…
J’étais salariée et travaillais dans les télécommunications, pour le développement de la fibre optique en France. Je l’ai fait depuis ma sortie d’études, en 2002, jusqu’au début des années 2010. Cela me correspondait puisque j’ai fait des études en sciences sociales avant de me spécialiser en informatique et en système d’informations géographiques.
 Vous avez fait allusion à votre histoire familiale, quels sont vos liens avec l’Afrique ?
Vous avez fait allusion à votre histoire familiale, quels sont vos liens avec l’Afrique ?
Ma mère est française des Antilles et mon père Camerounais. Je suis née au Cameroun et j’ai vécu en Centrafrique à Bangui jusqu’à 14 ans. Mon père était fonctionnaire camerounais détaché en Centrafrique. Il travaillait pour l’UDEAC – L’Union douanière des Etats d’Afrique Centrale. Dans les années 91 – 92, il y a eu les conférences nationales et beaucoup de manifestations des populations qui demandaient le multipartisme, davantage de démocratie. Or, mon père a brisé son devoir de réserve en publiant une tribune dans un journal. De ce fait, il a été rappelé au Cameroun, démis de ces fonctions et mis à la retraite anticipée. Après cela, ma mère étant antillaise, nous sommes parties aux Antilles alors que mon père restait au Cameroun. Pendant des années, nous n’avons pas vécu ensemble, étant sur deux continents différents. D’ailleurs pour la petite histoire, je ne suis arrivée en France métropolitaine qu’en 2000 depuis les Antilles, pour y démarrer une licence à Nanterre.
Mon père étant très engagé sur le plan politique – il l’est toujours – j’ai été biberonnée au panafricanisme. Par exemple, il nous réunissait dans le salon et nous parlait de Mandela, de Nkrumah, de Sankara, etc. Lorsque Mandela a été libéré en 1990, mon père a pleuré. Cette enfance explique le dessin de presse car j’ai voulu faire un lien entre ma passion pour le dessin et cet intérêt pour les sujets politiques. Je m’inscris totalement dans le mouvement de la bande dessinée du réel, qui rend compte du monde qui nous entoure.
Quels sont vos projets ?
J’en ai, je dessine, mais je ne scénarise pas. Alors, il faut que je trouve la bonne personne car les sujets que je traite doivent être très documentés. En l’occurrence l’un de mes deux projets porte sur le Cameroun et ne peut pas être traité à la légère même si cela appartient au passé. Mais je ne préfère pas en parler car rien n’est signé. L’autre sujet est très technique et d’actualité. La grande difficulté est de parler d’un sujet extrêmement technique en arrivant à l’incarner à travers des personnages dans une bande dessinée.
Un dernier mot ?
Oui. Je suis arrivée là où je voulais être, après un parcours un peu atypique et une carrière qui a démarré sur le tard. Je me sens plutôt bien comme auteure de BD, et plus généralement comme une personne engagée qui dessine. Cela me correspond.
Tétouan, le 25 avril 2019.








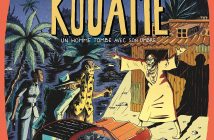

2 commentaires
Très beau article ,sa me donne du courage de continuer dans le monde du dessin, j’aime les BD engager et certain roman graphique qui parle de sujet sensible…chapeau à cette jeune auteure de BD.
Je constate une déferlante de BD qui parle du monde » noir » ET tant mieux il y a tellement de chose à raconter et à déconstruire sur ce monde toujours vue avec des stigmates du colonialisme. que ce sois en Afrique ou dans les caraïbes.
C’est un beau parcours et très inspirant. Bonne continuation.