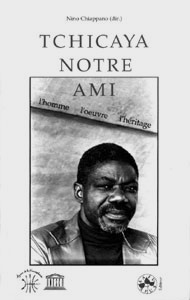« Vous habitez le Congo, le Congo m’habite« . C’est ainsi que le poète Tchicaya U Tam’si répondait à ceux de ses compatriotes qui l’incitaient à rentrer au pays. A l’époque, cette jolie formule, nous paraissait comme une pirouette intellectuelle ; aujourd’hui, force est de saluer sa pertinence.
Bien qu’ayant séjourné près de quarante ans en France, Tchicaya U Tam’si n’a cesser de chanter le Congo. De Epitomé (1962) au Bal de N’dinga (1988), son uvre littéraire est nourrie par une seule obsession : le Congo – une obsession liée à trois raisons.
– L’éloignement géographique : venu très jeune en France, Tchicaya U Tam’si, déçu par la « maigreur » de la Seine, rêve du majestueux fleuve Congo.
– La deuxième raison plusieurs fois évoquée par la critique est sa rencontre avec le nationaliste Patrice Lumumba. Marqué par la disparition du « prophète », comme le nomme joliment le cinéaste Raoul Peck, Tchicaya U Tam’si ne se remettra jamais de la mort du nationaliste congolais. De sorte qu’on pourrait dire qu’il a eu dans sa vie deux amours : e Congo et Patrice Lumumba. L’un ne va d’ailleurs pas sans l’autre.
– La troisième raison est d’ordre privé. Hanté par l’itinéraire de son père, Félix Tchicaya, premier député congolais au Palais-Bourbon, Tchicaya essayera plus tard, après la mort de celui-ci, de faire fructifier poétiquement l’héritage politique et historique de son père à travers un grand travail de mémoire. Evoquant le sens de son projet romanesque, lors d’un entretien avec le dramaturge Tandundu Bisikisi, Tchicaya dit : « Ce que j’ai voulu dès le départ, c’est écrire un roman typiquement congolais, trempé dans l’histoire du Congo, pour me faire une mémoire, parce que j’avais besoin de cette mémoire. Car je n’arrivais pas à savoir d’où je venais, où j’allais et ce que faisais là. » (1)
Il y a dans cette soif de mémoire chez Tchicaya U Tam’si deux paliers. Le palier public, celui d’un ex-colonisé en quête d’identité s’interrogeant sur l’histoire de son pays et le palier « intime », qui relève de l’histoire individuelle. Plus que tout autre Congolais, Tchicaya est fasciné par la période historique qui précède les Indépendances pour la simple raison qu’il est le fils du député Jean-Félix Tchicaya, le premier parlementaire congolais à siéger au Palais Bourbon sous la IVe République française aux côtés de Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor et Gabriel Lisette. Il s’agit pour lui de s’interroger sur ce qu’aurait été le destin de son pays si le PPC (Parti Progressiste Congolais) fondé par son père Jean-Félix Tchicaya avait recueilli l’Indépendance comme l’ont fait Senghor, Houphouët, Léon Mba, etc. « Le Congo, dira-t-il à Roger Chemain, c’était la quête politique de mon père, c’est aussi la mienne. »
Dans son livre intitulé Regards sur l’autre à travers les romans des cinq continents (1993), Michel Nauman présente le départ de Tchicaya U Tam’si de la maison parentale à Paris dans les années 50 comme une prise de distance « vis-à vis d’un parti (le PPC) qui devait son image de gauche à l’alliance communiste et à l’hostilité de l’administration coloniale« . Cette thèse me paraît discutable. La vie de bohème menée par Tchicaya U’Tam’si dans les années 50 à Paris a été davantage l’expression d’une révolte d’adolescent contre son père, contre l’autorité tout court qu’une protestation politique. Il suffit de lire les déclarations faîtes par Tchicaya U Tam’si lui-même pour s’en convaincre. Dans une interview accordée en 1966 à Mohamed Bahri, il dit : « J’étais rebelle, j’ai quitté les bancs de l’école plus tôt qu’il n’aurait fallu ; c’était une rébellion, comme on dirait, contre mon père, mais aussi contre mes maîtres qui ne m’ont pas appris grand-chose, et j’ai voulu apprendre tout par moi-même. Je ne sais pas si j’ai appris grand-chose, mais le monde est tellement pavé de prétentions
». (2)
Plus tard, il reviendra dans un entretien avec Roger Chemain sur cet épisode de sa vie pour dissiper définitivement tout malentendu : « Maintenant, il faudrait que je vous parle un peu de ma relation avec mon père. On a mal reproduit un certain nombre de propos que j’ai tenus au cours des interviews antérieurs. J’ai adoré mon père saintement. Je crois que tout enfant a eu ce sentiment de vouloir mourir avant ses parents. Et mon père est mort très tôt, hélas, avant que je ne puisse verbaliser la relation sans doute privilégiée que j’aurais pu avoir avec lui. Mon père est au Congo et sans doute en Afrique un homme très en avance de son temps. (
) Un homme pour qui j’aurai bien voulu mourir, parce qu’il avait sans doute beaucoup de choses à apporter. Si je me réfère à l’histoire de notre pays, il est tombé bien bas, faute de n’avoir pas eu cette force morale de dépassement. » (3) Ces propos montrent bien que Tchicaya U Tam’si s’est interrogé sur le destin politique de son père, auquel il dédie son roman Les Phalènes et sur l’histoire de son pays en général.
En réfléchissant dans les années 90 sur les années postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale, Tchicaya a voulu sans doute montrer, à l’instar de Mongo Beti que le centre de gravité de l’Histoire contemporaine de l’Afrique ne saurait être situé, comme on le fait souvent, en 1960, mais quelques années plutôt à l’époque de l’Union Française, puis de la Loi-Cadre, c’est-à-dire au moment précis où les Africains se trouvèrent à la croisée des chemins et où l’histoire aurait pu prendre un autre parcours.
Cette méditation sur le sens de l’Histoire du Congo et de l’Afrique est perceptible dans tous ses romans et particulièrement dans Les Phalènes, où il écrit une chronique historique et politique. Alors que l’action des Méduses a lieu à Pointe-Noire, poumon économique du Congo, celle des Phalènes se situe à Brazzaville, capitale de la France-Libre et de l’actuel Congo. Ce changement de lieu d’action du roman n’est pas gratuit. Il s’agit pour Tchicaya de donner tout de suite une orientation politique à son texte.
Par ailleurs, si dans Les Méduses l’atmosphère générale paraît tendue à cause des morts violentes d’Elenga et de Muendo, elle est en revanche détendue dans Les Phalènes. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les alliés viennent de gagner la guerre contre les fascistes, mais les anciennes puissances coloniales sont fragilisées. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Les colonisés ont lourdement contribué à la victoire des alliés et vont sans doute revendiquer la liberté en échange de leur loyauté à l’égard de la « Mère-Patrie ». La conférence de Brazzaville, organisée par De Gaulle et les gouverneurs généraux des colonies, sans bien entendu la présence des colonisés, a plaidé pour des réformes du système colonial. Sur le plan international, l’émergence de deux superpuissances invitent elle aussi à des réformes politiques des Empires coloniaux. Dans le cas de l’Empire colonial français, ces réformes vont être mises sur pied dans le cadre politique et juridique de l’Union française. On assiste alors à l’abolition de l’indigénat. Les anciens colonisés, qui passent du statut de l’Empire à celui de citoyen de l’Union française, peuvent désormais suivre le même enseignement que les Européens, participer à la vie politique dans le cas des évolués, etc.
Cette réflexion sur le destin du Congo, Tchicaya le prolonge dans son dernier roman, Ces fruits si doux de l’arbre à pain, publié en 1987 aux éditions Seghers. Son thème : la justice et les morts sans sépultures en Afrique post-coloniale et particulièrement au Congo-Brazzaville. Livre que l’on pourrait à considérer, au même titre que sa nouvelle Le Bal de N’Dinga, comme son testament littéraire et politique. Tout ceci confirme les propos du poète qui ouvrent cet article. Bien que vivant à Bézancourt, en France, Tchicaya était habité par le Congo.
Analysant la condition de l’écrivain latino-américain en exil, Julio Cortázar a eu cette pensée lumineuse : « Contre l’autocompassion, il vaut mieux soutenir, pour démentiel que cela paraisse, que les véritables exilés, ce sont les régimes fascistes de notre continent, exilés de l’authentique réalité nationale, exilés de la justice sociale, exilés de la joie, exilés de la paix. Nous sommes plus libres qu’eux et nous sommes plus qu’eux dans notre pays. » (4)
Tchicaya U Tam’si n’aurait pas dit mieux.
1. Bisikisi Tandudu, Les fiançailles, suivi de « J’ai mission de mourir », entretien inédit avec Tchicaya U Tam’si, Paris, L’Harmatan, 1997, p. 170.
2. Propos recueillis par Mohamed Bahri, Jeune Afrique du 24 avril 1966, cités par Claire Céa, dans sa préface au recueil de Tchicaya Epitomé.
3. Propos recueillis par Roger Chemain. Cf le disque consacré par RFI au poète.
4. Julio Cortàzar, Colloque de Cerisy, Paris, UGE 10 :18, 1980, p. 20.///Article N° : 2123