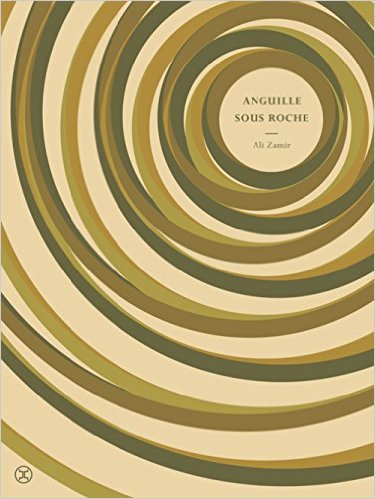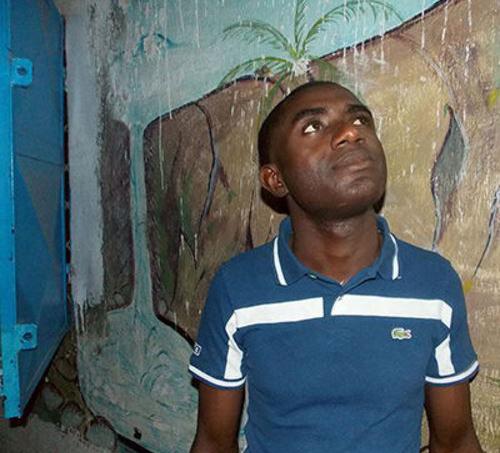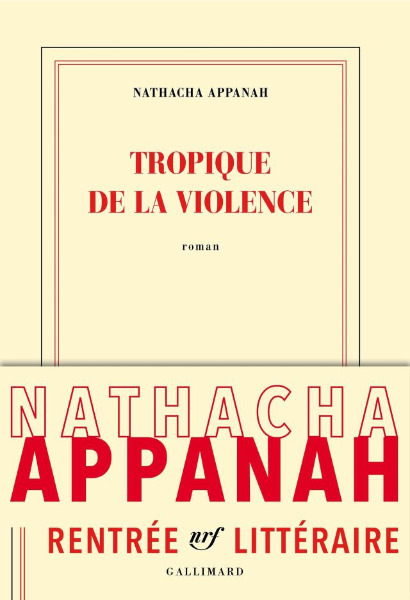Alors que la question des réfugiés est au cur des préoccupations de l’Europe, leur localisation semble aller de soi : ils passent, et meurent, en Méditerranée. C’est pourquoi, il est aussi nécessaire qu’agréable de lire deux romans sortis durant la rentrée littéraire qui traitent exactement de la même question, celle des clandestins qui fuient l’île d’Anjouan, appartenant à l’archipel indépendant des Comores pour tenter de gagner sa proche voisine Mayotte, comorienne aussi, mais appartenant à la France. Les deux écrivains sont originaires de la zone ; la mauricienne Nathacha Appanah, romancière confirmée (1), accède à la collection blanche de chez Gallimard avec Tropique de la violence et Ali Zamir, un jeune comorien qui vit à Anjouan, publie son premier texte Anguille sous roche aux éditions Le Tripode.
Chez l’un et l’autre, il sera question de ces embarcations à moteur dites kwassa-kwassa qui chavirent entre les deux îles, de la vie des clandestins souvent refoulés, de l’attraction irrépressible d’une île où il y a tout pour des voisins qui se voient semblables et pourtant écartés de cette abondance importée. Les deux récits prennent pour cadre l’eau (jamais appelée océan) qui, en dépit de sa beauté, apporte la mort.
Le sujet, bien que méconnu du public français, n’est pas nouveau puisque le malgache David Jaomanoro (2), qui vivait à Mayotte et le comorien Soeuf Elbadawi (3), qui vit en France, ont déjà fait parler les migrants en danger, hommes et femmes.
Ces fictions, pourtant, veulent redire, chacune à leur manière, l’urgence de considérer ces drames lointains entre deux îles minuscules : « ce qui se passe ici ne traverse jamais l’océan et n’atteint jamais personne. Nous sommes seuls. D’en haut et de loin, c’est vrai que ce n’est qu’une poussière ici, mais cette poussière existe » dit un personnage de Tropique de la violence. Et les deux auteurs de faire exister, entendre, les voix de personnages représentatifs : Anguille la jeune narratrice de 17 ans de Anguille sous roche fuit Anjouan à cause d’une situation personnelle sans issue, Moïse, arrivé de la même île mais bébé, raconte, à 15 ans, son destin tragique au milieu des enfants délinquants de Mayotte. Nathacha Appanah choisit la polyphonie en faisant se croiser les voix et donc les points de vue d’une mère adoptive française, du chef de bande, d’un jeune bénévole d’ONG et d’un policier français. Cette technique lui permet de mettre en évidence l’absolue contradiction entre les visions des uns et des autres sur le même pays. Admirable pour son « plus beau lagon du monde » pour ceux qui vivent à l’européenne dans des villas, univers de saleté et de violence extrême pour ceux qui y ont faim dans le ghetto surnommé Gaza. Par les voix des jeunes bandits, elle dénonce la naïveté et l’incompréhension des premiers qui pourtant évoluent, barricadés c’est vrai, au milieu des seconds, « des théories plein la bouche et pas une once de courage dans les mains » (p. 115) dira l’un d’eux. Comme symétriquement, le discours des jeunes perdus est saturé de haine pour ces Blancs qui ne les comprennent pas : « Va pas croire toutes ces conneries sur les mineurs isolés comme disent les gens des associations et des ONG et des comités et des secours et des croix, ils comprennent jamais rien ces gens-là. Je suis né ici, moi. De tous les gars, je suis le seul vrai Mahorais, j’ai mes papiers » (p. 67) dit le chef de bande. Si tout est vu depuis Mayotte dans son texte, y compris les clandestins renvoyés à Anjouan, Ali Zamir ne raconte qu’Anjouan et le mirage mahorais. La narratrice qui se noie avant d’arriver a le temps de « révéler comme témoignage » (p. 278) la vie de sa famille, ses déboires amoureux et, fugitivement la rude vie des pêcheurs, des producteurs de banane et de girofle, des passeurs qui embarquent chaque nuit une « cohue prête à tenter le diable » (p. 276) dont une partie retente la traversée après avoir été reconduite par la police française de Mayotte.
Cependant, si les deux récits se répondent au point parfois de ne faire qu’un en deux facettes d’un miroir, leur degré d’aboutissement les distingue radicalement.
Nathacha Appanah, comme dans ses romans précédents, construit un drame par scènes distinctes qui sont comme de minces tranches (vingt-deux exactement pour cinq locuteurs) savamment agencées avec une économie de moyens qui élimine tout pathos pour ne conserver que des phrases à la syntaxe simple : « Gaza était en noir et blanc ce soir-là. Le blanc des tuniques des petits garçons qui allaient à la prière ou rentraient, le noir des caniveaux dans lesquels j’avais peur de basculer, le blanc des seaux et des bouteilles en plastique alignés près des points d’eau, le noir des visages et le blanc des yeux. J’ai senti l’odeur du Gaza de Mayotte et je sais aujourd’hui, sans même avoir voyagé, que c’est l’odeur de tous les ghettos du monde » (p. 73-74). Ali Zamir, qui a sans doute lu Soeuf Elbadawi, tente de l’imiter en faisant de son monologue une longue déclaration sans points, structurée seulement en sortes de sections mais sans que la logorrhée n’ait le temps de s’interrompre ni de gagner en intensité. Il s’ensuit une contradiction interne entre la situation de la narratrice qui perd son souffle puis sa vie dans l’eau et sa prodigieuse capacité de discours et de mémoire, y compris sur des faits connexes et mineurs.
En conséquence, le suspense est tel que l’on court d’un bout à l’autre du premier texte jusqu’au dénouement qui vous laisse pantois alors que l’on patauge dans le second, au risque même de s’y noyer.
Il faut regretter pour ce jeune auteur qu’il n’ait pas été mieux accompagné dans ses débuts balbutiants de francophone qui veut insérer tous les mots et tournures insolites qu’il a collectés. Dans son souci de « faire français », alors qu’il fait parler une jeune fille musulmane peu instruite, il verse dans l’hypercorrection (les galéjades, un sacré protée, les corps valétudinaires) associée à de l’argot, accumule les clichés, francise (les personnages « implorent Dieu » avec des versets coraniques, disent des « gauloiseries »,la narratrice s’exclame « Dieu soit loué »), les noms situent les personnages en français (Crotale, Tranquille, Connaît-tout, les passeurs s’appellent Rescapé Garanti et Miraculé). La jeune fille qui, enceinte, sort de sa médina « franchit le Rubicon » (p. 243), connaît les « amants de Vérone » (p. 206), « sent le sapin » (p. 313) mais ne mentionne ni son enfant ni le Coran avant de « trépasser en pleine anguillade » (p. 317).
La mort est au bout de ces deux traversées. Annoncée dans les deux textes dès le début, elle délivre d’une lente déchéance le jeune Moïse et laisse à Anguille la naufragée le temps de « dresser son bilan » (p. 314). Les deux romanciers se rejoignent dans leur dénonciation des drames qui se jouent dans ces eaux réputées paradisiaques. On peut les remercier de rendre visible, chacun à sa manière, cette zone tropicale si lointaine.
1. Le Dernier frère (2007), En attendant demain (2015).
2. « Pierrot », in Chroniques de Madagascar, Sepia, 2005 et Pirogue sur le vide, L’Aube, 2006.
3. La rage entre les dents. Un dikhri pour nos morts, Vents d’ailleurs, 2013.///Article N° : 13838