« La France a des problèmes de mémoire, elle connaît Malcom X mais pas Frantz Fanon, pas le FLN, connaît les Blacks mais pas les Noirs », rappe Rocé en 2006 dans l’album Identité en crescendo. Douze ans plus tard, l’artiste apporte une réponse à ces « problèmes de mémoire » avec le projet Par les damné.e.s de la terre. Des voix de luttes 1969-1988, qui sort le 2 novembre prochain en autoproduction chez Hors-cadres. Une compilation de 24 titres interprétés pendant cette période des décolonisations et de la Guerre Froide. Des morceaux qui, ensemble, racontent une histoire de convergences des luttes, éclairantes pour penser le présent. Rencontre avec Rocé, qui avait, pour Afriscope, l’année passée raconté en quelques chroniques l’histoire de plusieurs morceaux de ce projet (lire ici). Un lancement est prévu à Paris le 28 octobre.
« Par les damné.e.s de la terre », le titre de cet album qui réunit des titres, dont certains inédits, sortis entre les années 1969-1988 fait référence à une œuvre majeure du psychiatre anticolonialiste et indépendantiste, Frantz Fanon, Les damnés de la terre, publié en 1961. Qui sont les damné.e.s de la terre ?
Dans ce projet ce sont tous les exilés, les colonisés, les ouvriers, les pauvres, les subalternes. Ce sont tous ces gens dont l’histoire ne parle pas. Qui n’ont pas leur histoire. Qui n’ont pas leur mot à dire. Qui n’ont pas la parole.
Les préoccupations de ces « damné.e.s de la terre » sont aussi celles de nos générations. Les années soixante sont des modes d’emploi pour aujourd’hui.
Comment est né ce projet que vous définissez comme embrassant à la fois la musique et le patrimoine ?
Ça fait longtemps que ce projet mûri dans ma tête. Aurélien, un ami disquaire aux puces de Clignancourt (Paris 18e) m’a fait écouter un morceau sur un 45 tours, début 2000, du béninois Alfred Panou. Un morceau qu’il a fait avec l’Art Ensemble of Chicago, célèbre groupe de free jazz contemporain américain. En l’écoutant, je me suis dit : « c’est du rap ! » A cette époque, le slam – le texte clamé – était alors à la mode. Dans la même dynamique je découvre Colette Magny, avec un morceau « Répression » enregistré avec des musiciens de free jazz. Colette Magny, française, était quelqu’un de très engagée, qui jouait dans les usines en grève, qui avait des textes sur les luttes de décolonisations et sur celles du monde ouvrier.
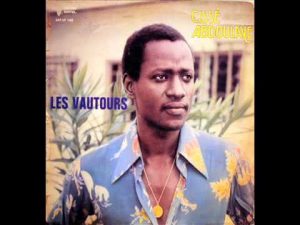 Ces morceaux c’est l’histoire sous l’histoire de la musique, l’histoire sous l’histoire. Je réalise alors que leurs préoccupations, celles de ces « damnés de la terre » sont aussi celles de nos générations. Les années soixante sont des modes d’emploi pour aujourd’hui. Des modes d’emploi qui ont été enfoui. Ça m’a pris une dizaine d’années de creuser cette intuition pour en faire un projet. C’est un travail archéologique sur le disque vinyle. C’est ce qui m’a tout appris, m’a fait tout comprendre. Et je me suis appuyé sur l’aide de deux historiens passionnés et connaisseurs de musique : Amzat Boukari Yabara, spécialiste du panafricanisme et Naïma Yahi, spécialiste des exils et des migrations. Ils ont écrit le livret du disque.
Ces morceaux c’est l’histoire sous l’histoire de la musique, l’histoire sous l’histoire. Je réalise alors que leurs préoccupations, celles de ces « damnés de la terre » sont aussi celles de nos générations. Les années soixante sont des modes d’emploi pour aujourd’hui. Des modes d’emploi qui ont été enfoui. Ça m’a pris une dizaine d’années de creuser cette intuition pour en faire un projet. C’est un travail archéologique sur le disque vinyle. C’est ce qui m’a tout appris, m’a fait tout comprendre. Et je me suis appuyé sur l’aide de deux historiens passionnés et connaisseurs de musique : Amzat Boukari Yabara, spécialiste du panafricanisme et Naïma Yahi, spécialiste des exils et des migrations. Ils ont écrit le livret du disque.
Quel est le lien que vous tracez entre ce projet et le rap, vous qui faites partie de cette « génération qui a vu naître le rap français, et avec lui l’énorme engouement pour cette musique des enfants de la deuxième et troisième génération d’immigrés »[1]. Vous parlez de « spoken word francophone ». Qu’est-ce que cela signifie ?
Ce projet je l’ai fait en France en tant que rappeur français, entouré de diasporas variées et multiples. Quand je vais dans les classes ici en région parisienne pour faire des ateliers, je peux rencontrer des élèves dont les parents sont originaires de Côte d’Ivoire, du Mali, du Maroc, d’Algérie… le point commun est qu’ils viennent de pays coloniaux et parlent tous français. Ce qui nous manque c’est la politisation et la fraternité des luttes passées.
Ce qui est normalement la base mais aujourd’hui on constate qu’on se retrouve dans la même classe sans savoir pourquoi. On ne sait pas que c’est à cause de la colonisation, que ça devrait lier par une sorte de fraternité, de sororité. Il y a un manque d’identification que je ressens dans les classes dans lesquelles j’interviens depuis des années, parce que beaucoup apprennent une histoire qui ne leur parle pas. Ils ne peuvent pas alors se sentir concernés par la société dans laquelle ils vivent, car cette société, dès l’école, ne les inclue pas. Si au fin fond du monde colonisé on apprend qui sont les rois de France, à Versailles on doit apprendre qui était Jean Marie Tjibaou. C’est normal.
Ce qui nous manque c’est la politisation et la fraternité des luttes passées.
Vous adressez ce projet particulièrement aux jeunes générations ?
Ce projet n’est pas un projet destiné aux jeunes, c’est un outil de transmission qui s’invite dans les programmes scolaires, chez les profs, chez les élus, dans les milieux de pouvoir, afin de souligner le malaise d’une histoire racontée qui est encore l’histoire impérialiste.
Ce problème d’identification dont vous parlez se ressent aussi dans la culture hip hop et le rap dites-vous.
Par rapport au rap, les gens de ma génération connaissent les Last poet parce que nous avons été baignés dans la culture américaine depuis notre plus tendre enfance mais nous ne connaissons pas nos propres last poet. Nous faisons du rap français sans connaitre nos ainés. On va nous parler de Brel, de Brassens, de Ferré et c’est très bien, mais sans référence aucune à ceux qui sont de nos origines d’exils, de diasporas, et qui ont pu écrire des textes en français sur ces réalités, sur les colonisations, sur les luttes de l’immigration. C’est ce qu’il fallait aussi peut-être découvrir et ressortir. C’est aussi de là que vient le rap français. Ce n’est pas de là que vient le rap mais les thèmes abordés dans le rap français sont les mêmes que ceux employés par nos aînés. C’est le fameux dicton : « Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, les histoires de chasses ne peuvent que chanter la gloire du chasseur ». On connait seulement l’histoire des élites. On nous apprend l’histoire des rois, pas celle des serfs. Et c’est un peu pareil avec les luttes : on ne sait rien sur les luttes, sur les ressorts, sur ceux qui les font.
Sous prétexte que c’est de la musique on invisibilise l’engagement politique des morceaux, on garde l’effet carte postale.
Aujourd’hui, pourtant, le rap comme d’autres cultures musicales, est imprégné de musiques africaines notamment, faisant le pont entre ces histoires liées.
Aujourd’hui beaucoup de projets sortent avec en effet des musiques dites « world ». Des fois les médias évoquent des musiques qui portent un lourd poids social ou politique sans jamais en parler. C’est une sorte d’orientalisme, d’exotisme, de fantasme. Sous prétexte que c’est de la musique on invisibilise l’engagement des morceaux, on garde l’effet carte postale. Oui c’est des morceaux pour danser mais pas seulement. Donc ma démarche est un peu inverse : montrer que la musique c’est aussi de la politique. Montrer que le rap est le prolongement de ça. C’est de la musique, mais la musique de ceux qu’on n’écoute pas.
Le hip hop d’aujourd’hui n’est plus aussi contestataire qu’à ses débuts diriez-vous ?
Je pense que la contestation n’est pas forcément dite, elle se trouve aussi dans la posture, dans le fait que le style musical est celui que les institutions ne veulent pas entendre. Le hip hop s’est juste adapté dans le monde dans lequel il vit. Le hip hop s’adapte au capitalisme, il est plus capitaliste que le capitalisme. Je dis pas que c’est une bonne chose, le capitalisme fait trop de mal sur le long terme, je veux juste dire que les nouvelles générations savent mieux gérer ce rapport de force et le renvoyer dans la gueule de l’industrie si je compare à ceux de ma génération. Mais il n’y a pas d’engagement politique sur le long terme. Ce n’est pas un reproche, le hip hop n’est pas là pour ça. Chacun en fait ce qu’il veut. Le hip hop est une culture dans laquelle certains ont su prendre leur autonomie économique et c’est déjà énorme.
Parmi les voix représentées dans ce projet, il y a celles des indépendantistes antillais, des ouvriers (« Groupe culturel Renault »), des travailleurs immigrés pour une reconnaissance de leurs droits (« Carte de résidence »), celles d’une mémoire oubliée autour de l’esclavage (« Où sont les tam tam » de Guy Cornely), celles qui racontent les douleurs de l’exil ( « Le Mal du pays » de Mano Charlemagne), celles qui dénoncent les oppressions ( « Aux tortionnaires » de Léna Lesca ou « Monsieur l’indien »). Ce projet crée alors une cartographie des luttes qui embrasse tous les continents.
On est dans une époque de résignation, et on voit la résignation presque comme quelque chose de cool, un lifestyle hype, style no life. A l’inverse mettre l’espoir dans des processus concrets c’est vu comme quelque chose de pas hype du tout
Aujourd’hui on parle de « convergences des luttes » comme si cela n’avait pas existé auparavant. A cette époque des non-alignés, des tiersmondistes, des décolonisations, il y avait une fraternité sur les décolonisations. Ces convergences là – dont on ne nous parle pas à l’école- ont existé : ce qui m’a frappé c’est de voir le général Giap avec l’équipe de FLN de foot parce qu’il les avait invités au Vietnam au moment de leurs luttes de libération. Quand on voit comment tous ces gens s’aidaient à l’époque, qu’ils avaient ces points communs du monde paysan au monde ouvrier, ce que ça dit c’est qu’il y avait un projet. Aujourd’hui on est dans une époque où il n’y a pas de projets de société. Il ne peut pas y avoir de connivences s’il n’y a pas de projets. Le seul projet c’est le capitalisme et on sait que ça ne lie pas les gens entre eux.

Vo Nguyen Giap & Equipe de foot du FLN Algérie
Quand j’ai fait ce projet, « Par les damné.e.s de la terre », j’ai simplement découvert qu’il y avait des modes d’emploi. Or, quand tu en parles, on te regarde comme si tu étais un extrémiste engagé. Comme si tu étais obtus ou nostalgique d’une époque. Alors qu’au final tu n’es seulement pas résigné. On est dans une époque de résignation, et on voit la résignation presque comme quelque chose de cool, un lifestyle hype, style no life. A l’inverse mettre l’espoir dans des processus concrets c’est vu comme quelque chose de pas hype du tout
« Tout est parti en couilles quand « rap conscient » est devenu une insulte », rappe justement Youssoupha dans son dernier album. Vous êtes aussi souvent classé dans les « rappeurs conscients ». Vous définissez-vous, et notamment avec ce projet, comme un militant ?
Je me sens proche de dynamiques qui ne sont pas des partis traditionnels. Je ne vote pas. Mais je pense qu’il y a des solutions il y en a plein, il y a des choses à construire et déconstruire mais ça passe par des chemins de traverse et non pas par l’autoroute. Je pense que beaucoup de choses se font localement. Et je crois en la nécessité de créer des réseaux autonomes, indépendants. Quand les réseaux sont créés par le pouvoir, sans projet de société, ça ne ramène que du clientélisme et des politiques qui vont vers le plus fort. Se créer des autonomies, des réseaux, des manières d’autogestion, par du travail de groupe, non par des leaders.
Des leaders politiques justement, il y en a dans le projet « Par les damné.e.s de la terre ». Vous avez agrémenté votre disque d’interlude d’hommes politiques comme Aimé Césaire et Jean Marie Tjibaou notamment.
J’ai tout mêlé dans le projet : il y a aussi un interlude de Ho Chi Min. Le projet commence par une allocution de Jean-Marie Tjibaou, un discours sur « Mélanésia 2000 » prononcé en 1974, où il montre finalement que la culture est un pilier de la politique. Il dit : « cette culture il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu’on n’existe pas ». Quand je vois des projets musicaux qui sortent en invisibilisant leur part de politique, pour moi c’est mauvais parce que on invisibilise du coup les cultures qui vont avec, les discours et les engagements. On laisse juste un corps sans cœur.
Ce projet est aussi une histoire de rencontres. Car il a fallu aller chercher les artistes, ou leur ayant droit, et vous êtes entré alors, parfois, dans les vies de celles et ceux dont vous cherchiez les œuvres. Comment ont-ils-elles réagi ?
Certains ont été très surpris : « comment est-ce possible aujourd’hui, à l’heure d’internet, qu’une personne s’intéresse à un 45 tours, sorti dans les années 70. En plus un morceau assez engagé. Comment est-ce possible que cette personne s’y intéresse alors que moi-même j’avais presque oublié avoir fait ce disque, et qu’il veut mettre ça dans un projet ? ».
La plupart sont tombé des nues. Quand je leur explique l’engagement du projet, ça leur a donné un souffle de fraicheur, un souffle de vie, un souffle d’espoir. Le combat continue.
Comme vous le disiez précédemment, certains morceaux retentissent jusqu’à aujourd’hui. Certains titres pourraient presque être écrits en 2018. Je pense notamment à « La logique du pourrissement » du martiniquais Jobby Bernabé sur le rapport entre les Antilles françaises et la métropole, datant de 1985. Qu’est-ce que cela dit encore de notre époque ?
En écoutant ces gens me parler, en écoutant les sons, je me suis juste rendu compte que notre génération n’a rien inventé. Que malheureusement, quand l’histoire n’est pas racontée, l’histoire se répète. Même sur certains mots, on pense les avoir inventés, alors que les générations précédentes l’utilisaient, comme celui de « convergence » par exemple. Quand on regarde le projet de la Troupe Al Assifa : c’est une troupe d’algériens et marocains et dans l’interlude que j’ai mis, c’est un mauricien qui parle parce qu’ils l’ont invité à prendre la parole sur scène. C’est de la convergence de luttes. Ou plutôt du lianaj, parce que ça crée du lien, pas de la convergence. La question que je me suis posée à la fin de ce projet : comment tout ça s’est arrêté ? Comment ces instants de magie se sont-ils éteints ? Qu’est ce qui a raté ?
C’est une question que je me pose encore, il y a plein d’éléments de réponses. Ce qui est sûr, aujourd’hui, c’est que ces moments de magie et de force il faut les montrer. Quoi qu’on en conclu derrière, il faut les montrer.
Quels éléments expliqueraient selon vous la cassure de cette magie et l’invisibilisation de ces luttes et résistances vis-à-vis de nos générations ?
Le premier est un élément personnel : à partir du moment où les parents ont lutté, ont été engagé dans des luttes, et qu’ensuite ils ont voyagé ou non vers un pays d’accueil, ils ont eu le sentiment d’avoir fait un combat, de s’être sacrifié pour que leurs enfants n’aient pas à le faire. Ils n’avaient donc pas avoir forcément envie que leurs enfants vivent la même chose. Ils ont vu des gens se faire tuer pour ça. Se faire torturer. Tout sacrifier et tout perdre. Et ce, pour que justement leurs enfants n’aient pas à vivre la même chose. Ajouté à cela la société de consommation qui est arrivée, avec une espèce de sentiment de bien-être qui flottait dans l’air, ils se sont dit ; « on va souffler un peu. Ils n’allaient pas élever des soldats ». Je pense que chaque génération doit trouver ses propres combats. Chaque génération a son combat, on ne va pas demander aux jeunes d’aujourd’hui de revivre Woodstock par exemple. C’est un élément de réponses mais il y en a plein d’autres.
Ce projet éclaire particulièrement les luttes décoloniales. Vous préférez le définir comme un projet panafricain.
Je le vois comme un projet panafricain. Même s’il n’est pas que ça. C’est un projet d’histoire. Au final cette dynamique de l’époque de magie dont je parle elle est panafricaine, avec un écho en France qui passera par les luttes ouvrières qui vont se servir de ces dynamiques de non alignés, de travailleurs arabes qui ont aidé les syndicalistes via leur formation marxiste. Ce sont des états d’esprits tiers-mondistes, un humanisme teinté des fraternités africaines. C’est un peu ce que ce projet dit aussi, que mai 68 ne dit pas ; que les mouvements d’indépendance, de décolonisation ont nourri à leur manière mai 68.
Ça veut dire beaucoup de choses « être panafricain » aujourd’hui.
Les nouvelles générations en France qui sont d’origines de pays africains ont envie de mieux comprendre, mieux connaître l’Afrique, sans mythe, et certains connaissent très bien leur pays d’origine ; savent ce qu’ils perdent et gagnent par rapport à la France. Moi je vois les choses sous le prisme de la musique ; de MHD à RimK on ne peut pas dire que ce sont des artistes français et ce sont des artistes français, on ne peut pas dire que ce sont des artistes africains et ce sont des artistes africains. L’un et le multiple aujourd’hui. Il y a une prise de conscience, il y a aussi une gestion différente des rapports de forces. Ce qu’il faut voir ce sont les rapports de force. Dans la musique, de plus en plus de rappeurs et autres commencent à comprendre que le continent africain est riche, et que cette richesse est un outil qui peut servir leur positionnement, leur rapport de force justement. Un domaine où l’eldorado n’est plus forcément l’occident, un domaine où le producteur n’est plus forcément la majore occidentale mais l’artiste d’origine africaine lui-même. Comprendre les choses ça permet de comprendre comment se positionner.
Que peut la musique dans le combat politique ?
Elle peut instaurer un socle culturel. Par la culture on peut faire passer des choses qui ne passeront pas par le politique et rendre visible des identités, des courants de pensées, des débats, des projets de société.
Vous parlez de cette époque de comme d’une poésie engagée parce que le contexte ne lui donne pas le choix, qu’en est-il aujourd’hui selon vous ?
Pour moi la poésie est engagée ou n’est pas. Je ne crois pas aux choses qui sont écrites sans raison.
[1] Extrait du livret d’accompagnement de l’album « Par les damnés de la terre ».









