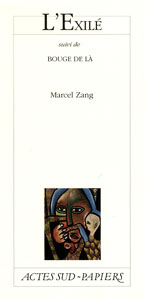Parmi les auteurs africains qui ont été reçus ces dernières années à la maison des auteurs, Marcel Zang, à côté de Ousmane Aledji ou de Florent Hessou est sans doute un auteur des plus étonnants. Il a quitté le Cameroun, voilà bien longtemps et il revendique son engagement dans la culture contemporaine à travers une écriture très moderne, sans ambages, à travers les sujets aussi qui sont les siens, puisqu’il évoque l’immigration, les Africains de France, les expulsions, la prison, la double peine…
L’écriture de Zang n’est pas politiquement correcte, elle laisserait Margot rouge de honte ! Les gros mots fusent, la pisse gicle, mais Marcel Zang dit des choses fortes, il soulève les mauvaises consciences et ne laisse pas de place à l’hypocrisie. Il réveille le ventre mou de ceux qui se drapent dans les bons sentiments et son théâtre secoue le spectateur ! Il publie aujourd’hui deux pièces chez Actes-Sud Papiers : L’Exilé, un texte écrit en résidence à Limoges, et qui a été mis en voix par Patrick Le Mauff en 2001, suivi de Bouge de là, une pièce créée au Manège en juin dernier, à La Roche-sur-Yon, par la Compagnie Universalisapo dans une mise en scène de Georges Bilau Yaya.
Ces deux textes évoquent la prison et mettent en scène une confrontation entre deux hommes, un Noir et un Blanc, un immigré et un flic. Marcel Zang sait créer des situations fortes d’une extrême tension dramatique, mais en même temps le dialogue s’y fait toujours très profond, parfois même philosophique et c’est une véritable réflexion sur la question de l’identité à laquelle il nous convie avec la violence d’une matraque. Difficile de ne pas ouvrir les yeux, difficile de ne pas regarder l’altérité en face. Mais son théâtre n’est pas pour autant dénué d’humour, bien au contraire. Zang travaille sur la dérision. Si L’Exilé est plutôt une situation tragique, où le thème du viol est récurrent et où le rire est plutôt grinçant, Bouge de là a tout d’une comédie et la scène où toute la brigade s’interroge sur la nature de la flaque de pipi laissée par un détenu au beau milieu du commissariat est des plus drôles.
Marcel Zang est un dramaturge de la prison, de l’enfermement, peut-être parce qu’il vit la langue française dans laquelle il invente ses histoires, comme un carcan, une silice même. Il se dit « privé de sa propre langue » et entretient à l’évidence un rapport de force avec le français. Il évoque notamment dans L’Exilé cette particularité de son rapport à la langue qui piège et détruit de l’intérieur si on n’y prend garde : « Ainsi me voici obligé d’adopter de force, et comme devant le fait accompli, une langue qui n’est pas la mienne… une langue qui me dicte ses volontés, ses sentiments, ses désirs, et qui me dit à tout instant, à chaque battement, au moindre détour, à quel point je ne suis rien, moi… obligé d’abriter dans ma tête, dans ma peau, dans mon cerveau, et jusque dans les replis de mon sommeil, des appréhensions, des perceptions, des sensations, des valeurs, des mythes, des rêves, des repères, une idéologie plus que factices, exogènes. Obligé d’utiliser des mots, des mots, tous ces mots étrangers, ces mots français, qui recèlent dans leurs infimes articulations une vision du monde et des préjugés absolument négatifs sur moi, le Noir. Obligé d’intégrer tous ces concepts et de les utiliser au quotidien, contre moi-même. C’est comme exhaler une respiration qui en retour m’étrangle ou marcher du matin au soir avec des chaussures emplies de clous. Voyez le supplice ! Mais il faut bien respirer, n’est-ce pas ? il faut bien marcher…. » (L’Exilé, Actes-sud Papiers, 2002, pp. 36-37)
S.C.
Comment êtes-vous « entré en écriture »? Comment avez-vous été entraîné par le désir d’écrire ?
Comme beaucoup, j’ai commencé à écrire à l’adolescence. Je tenais un petit journal, j’écrivais des poèmes. Rien de sérieux. Jamais j’ai pensé que je pourrais continuer dans cette voie là. J’écrivais comme ça. Puis, un jour, au lycée, j’ai eu envie d’aller plus loin et de raconter une histoire, d’écrire un roman. J’avais envie d’épater mes camarades de classe avec mes histoires. Et j’ai fait lire à une amie mon roman, elle l’a emporté et en me le rendant le lendemain, elle semblait étonnée, elle n’en revenait pas et ne comprenait pas comment j’avais pu inventer tout cela, construire toute une histoire. Elle était fascinée et j’étais fasciné par sa fascination !
Vous aviez pris le virus !
J’ai senti là le pouvoir de l’écriture et j’ai continué. Pour moi, l’écriture est une aventure, un jeu, cela suppose une rupture avec ses habitudes, son propre monde, car il s’agit d’investir l’inconnu. C’est partir d’un endroit connu pour s’élancer vers l’inconnu. On ne peut pas écrire sans rupture. Mais, pour moi, c’est une rupture que j’ai vécue de manière assez dramatique. J’avais 18 ans, j’étais en terminale et mon père s’est suicidé. Mon monde s’est alors écroulé. Je vivais jusque là dans une bulle identitaire, mon père et moi c’était très fusionnel et il y a eu l’éclatement de cette bulle. Je me suis retrouvé face au vide, c’était terrible pour moi. Mon univers avait littéralement été pulvérisé. Le terrain connu qui me restait n’était pas confortable, il n’était plus rassurant. Et finalement j’ai sauté, je suis entré en écriture. Un peu comme dans une piscine, on trempe le bout du pied et finalement on plonge.
C’était un moyen de dépasser la souffrance ?
C’était surtout un moyen de retrouver la vie, d’entrer dans le mouvement, dans le rythme, la turbulence de la vie. Quand on a affaire au même, il n’y a pas de mouvement. En passant du connu à l’inconnu, j’entrais dans le mouvement et retrouvais l’agitation de la vie.
Quels ont été vos premiers sujets ?
La dette a été mon premier texte publié grâce à La Revue noire. La perte, ce que l’on doit rendre, ce que l’on doit, l’attachement sont sans doute les sujets qui me hantent. J’avais neuf ans quand j’ai quitté l’Afrique avec mon père pour venir en France.
Et vous n’y étiez pas retourné ?
Non. Mon père est mort en 1972 et je n’ai pas revu ma mère depuis ce jour. Voilà trente ans que je ne suis pas retourné au Cameroun.
La dette est une nouvelle, mais aujourd’hui vous êtes d’abord un dramaturge. Qu’est-ce qui vous a conduit au théâtre ?
Un professeur d’histoire à la fac de droit de Nantes a lu mes textes et était convaincu que j’avais les qualités pour écrire du théâtre. J’ai trouvé cela un peu saugrenu, mais l’idée m’a trotté dans le crâne et j’ai finalement fait une adaptation théâtrale de La danse du Pharaon, ce roman avec lequel je suis vraiment entré en écriture. La pièce a été montée à Nantes, il y a an trois ans. Ce sont deux jeunes Africains qui se retrouvent en prison. L’un Georges veut rester en prison : il estime qu’il peut y retrouver ses racines et son passé. Il s’y accomplit. Max, lui, veut au contraire en sortir et s’élancer vers le monde moderne. On pourrait y voir une espèce de combat entre anciens et modernes. La pièce est bâtie sur la confrontation entre les deux personnages. On retrouve d’ailleurs cette confrontation dans Un couple infernal, une autre de mes pièces, une espèce de conte métaphysique qui a récemment été joué au conservatoire à Nantes. C’est une réflexion sur l’identité et la différence, la Genèse revisitée. L’Identité régnait depuis longtemps et un jour arrive La Différence. Ce mariage est très tumultueux, c’est un peu Adam et Eve : alors que La Différence apporte le sexe, L’Identité est pure, mais elle est en train de mourir, La Différence peut la sauver mais il faut s’unir et comment ? Par le sexe bien sûr ! Et L’identité s’indigne. Pas question de compromettre sa pureté !
L’Exilé met aussi en scène une confrontation…
Oui, cette pièce fonctionne comme un huis-clos, un face à face entre un Africain qui se nomme Imago et l’inspecteur Charon, qui joue un peu les passeurs de la mythologie grecque. Ce n’est pas vraiment autobiographique, mais c’est l’histoire d’un jeune Africain qui doit être expulsé après des années de prison, bien qu’il ait toujours vécu en France. L’inspecteur Charon a la mission de le convaincre. Il a l’art de faire partir les récalcitrants, de trouver les mots et utilise toute une batterie d’argumentations. Il raisonne et joue avec la langue.
Vous vous interrogez beaucoup sur le fonctionnement de la langue française.
C’est par la langue que l’on perçoit le monde. Mais un Africain qui s’exprime en français se retrouve un jour à découvrir à l’intérieur de la langue qu’il emploie une énergie et une idéologie qui est contre lui-même, contre le Noir, et c’est tragique. Il utilise un outil sans avoir le choix, puisque c’est son outil premier, et cet outil se retourne contre lui. Car dans la langue française, tout ce qui est blanc est positivé, tandis que le noir est négativé. Quand on prend conscience de cela, c’est le comble du tragique. C’est une autre prison !
///Article N° : 2628