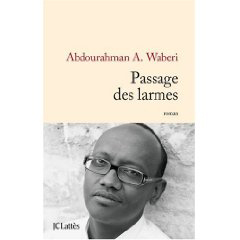Il n’y a pas de centre du monde, hormis le lieu d’où on l’observe. Il y a des espaces plus désirés, tant en émanent les signes de la modernité séduisante, et d’autres que l’on rejette, comme des marques de médiocrité ou d’infamie. Ce reste, ce sont les banlieues, plus ou moins provinciales, plus ou moins délabrées. Pourtant, cette latéralité supposée paraît aussi indispensable au centre que ne le sont les faubourgs aux grandes métropoles. Tel est bien le cas de Djibouti, un port creusé dans les laves de la côte des Issas il y a un peu plus d’un siècle, pour devenir une station de navires sur la ligne de l’océan indien, un des jalons visibles de l’impérialisme en marche. Dans des paysages de rocailles volcaniques, à la végétation rare, on peut entendre un appel, celui de l’accomplissement d’âpres mystiques qui conduisent à contenir en soi ce paysage tellurique, et redoutable. Mais aussi, dans les faubourgs miséreux de Djibouti, à s’éteindre comme un zombi dans la mastication renouvelée quotidiennement du khat, dans l’attente presque impatiente de l’effondrement. Comment peut on être djiboutien s’interroge Waberi, quand on a quitté ces rocailles coupantes et ce désespoir du vide, que l’on a rejoint les centres de décision de l’Euramérique, et que l’on participe de leur expression du monde ? Comment identifier dans ce qui est placé sous le regard ce qui y échappe résolument, le hors-champ de la manière de voir propre aux sociétés saturées par les technologies de la communication ? Pour la figure de l’écrivain, ces interrogations rejoignent alors cette question majeure : comment manifester littérairement ce lointain devenu inaccessible, malgré sa proximité, tout au-dedans de soi ?
Passage des larmes mène une approche qui dit tout à la fois le déplacement et la tragédie de ne plus être de là, comme on n’est pas de l’ailleurs. Employé par une officine de renseignements, le méticuleux espion Djibril revient sur la roche de l’enfance, quittée des années auparavant, pour y mener une enquête aux desseins guère avouables. Ses employeurs exigent de lui une extériorité qui n’a d’efficace que si elle est un effort de sortie de soi. Dans le cas de Djibril, formé dans des universités du monde riche, ce décentrement exigé est au moins double : il doit se déprendre momentanément de ce qu’il sait, retrouver en lui le djiboutien qu’il fut, et déplacer une seconde fois cette posture, pour enfin parvenir à mettre en uvre les techniques de renseignement qu’il a perfectionnées au fil des années. De ce paradoxe, Waberi offre un roman étrange et puissant qui concentre en lui les thématiques déclinées depuis les premières nouvelles, publiées dès 1994. Mais cette fois, il emprunte à un genre, celui du thriller, ses formes les plus courantes. Si enquête il y a, c’est celle que la victime elle-même va mener et c’est cette enquête qui entraîne sa propre disparition. Pour Djibril, Djibouti est devenu logogriphe : il n’en approche le centre que depuis des définitions énigmatiques, à travers des rencontres dont il ne soupçonne que trop tard la fonction manipulatrice.
Il y a, pour le lecteur, comme un effroi devant ce qui se commet : on ne revient pas impunément sur le temps de l’enfance. La géographie, c’est égal : les lieux anciens peuvent subsister et même s’ils ont disparu, ils composent le paysage intérieur que l’on visite seul. Depuis le XXème siècle et ses migrations continues et chaotiques, ces géographies étranges et intérieures constituent une part importante de l’invention romanesque. Bien entraîné, ce touriste peut parvenir à faire apparaître au milieu de ce paysage l’enfant qu’il fut. S’engage alors un dialogue, qui éblouit comme le signe même de la littérature. Cette rencontre peut aussi être relayée par les autres, sur lequel le temps aussi a passé. Ce n’est pas là le registre de Passage des larmes. Il est à la fois plus hautain, et surtout plus contraint. Celui qui vient voir, à force de regarder ne réalise que bien trop tard qu’il est lui aussi l’objet de l’attention inverse à la sienne. Ce paradoxe ouvre sur tant d’autres. Car Djibril a le tort de se croire seul, alors qu’il est entouré de fantômes dont il prend peu à peu conscience de la présence, tant ils viennent à la rencontre de cet enfant qu’il retrouve en lui, et qui font résonner ses notes de souvenirs. Le dispositif narratif ne cache pas ce tourment : la composition du roman est forte. Chaque intervention de Djibril dans ses carnets Moleskine – l’outil de l’écrivain voyageur, et depuis Chatwyn, son emblème – a en contrepoint celle d’un homme enfermé dans une prison, chargé de retranscrire la parole de son maître, un des théoriciens de la lutte djihadique. La dyade de l’écriture révèle progressivement la gémellité des protagonistes. L’un est resté, l’autre est parti, c’est un monde de ressentiments multiples qui se déploie à l’insu de Djibril. Ce retour à l’enfance, comme une tentative ultime de se désaltérer devient alors une quête vers sa propre fin : l’ancrage de Djibril dans l’ailleurs montréalais se dissout dans le vent, et dans le cône tronqué du Ginni Kôma dans le Goubbet, une des Îles du Diable, ce repère des djinns.
Peut-être aussi que tout est une question d’altérité. Ce que fait remonter en lui Djibril est bien dans cette posture, avant tout : il est à côté, regardant autrefois de biais, par exemple sa mère qui prolonge ses prières pour ne pas lui offrir la tendresse dont il manque. L’amitié, l’affection, il les trouve dans l’ailleurs, avec son ami fraternel David, pendant leurs errances sur les plages de Djibouti, ou bien avec Denise, à Montréal. À Djibouti, dans le temps où il revient, il revêt la panoplie du touriste : » le chapeau de paille et la chemise à fleurs « . Les premiers temps du roman saturent l’espace de la représentation de considérations géopolitiques sur l’état de la sous région, comme résonnant de clichés qui disent l’ailleurs depuis justement les centres de décision nord américains. Djibril mène son job. Mais peu à peu, se lève l’histoire intérieure, la difficulté d’être là, l’histoire des nomades, que sont sa famille. Brusquement, alors, la voix du grand-père résonne à nouveau dans la tête, comme un guide épuré qui vient lentement déconstruire la légitimité de ce travail, accompli malgré tout. Djibril retrouve en lui la présence insidieuse d’une fraternité déniée autant que désirée. Depuis la cellule du bagne, la vigueur sermonnaire semble alors lui répondre, comme une présence inavouable. Le frère guide en perdant, éclaire en opacifiant, manipule. Les clichés sur le politique pourront alors continuer à fleurir dans les officines de conseil, alors que progressivement, Djibril apprend à regarder avec un il lavé la réalité de ce qu’il se passe, par-delà les énoncés secs des fiches numériques qu’il interroge : l’humiliation, les massacres, la nécessité de revêtir des identités temporaires. Il convient de réaliser que sous les yeux, c’est bien » la face obscure du capitalisme rutilant » qui se révèle, et que les délires immobiliers des Émirats Arabes Unis ne figurent que le rêve prolongé d’un âge d’or, celui » de l’Andalousie disparue « . Mais aussi que le rêve d’un retour au pays natal n’est que l’impossible même, tant désormais devant son regard le hors champ lui-même a pris des allures fatidiques. Le frère rigoriste éloigne ainsi de la vérité le frère réputé jouisseur. La fraternité idéale et revendiquée sur le plan politique, se dresse sur le corps mort de la relation entre les deux frères.
Mais ce qui atteint Djibril vient aussi en rebond secouer le frère emprisonné : un troisième personnage vient court-circuiter la trame de ce combat contre soi-même que réveillent les deux frères, et qui est Walter Benjamin, le flâneur de Paris, le passant de Berlin, l’exilé à bout de souffle suicidé à Port-Bou en 1940. Comme une triangulation qui se décrit lentement, la relation entre les deux frères est rapportée à la lecture partagée du philosophe, à une interprétation commune, malgré l’insularité affective des deux. Dans une très belle fiction, qui fait lien entre les divers moments de cette histoire et celle de la France vichyste, Waberi creuse le sillon de l’exil intérieur qui marque ceux qui sont conduits à l’errance, à l’impossibilité d’un être là, autrement que dans le déplacement. C’est là une figure qui rompt résolument avec les tentations des retours heureux au pays natal.
C’est sans doute aussi à la responsabilité esthétique des écrivains des suds que Waberi s’attache dans ce roman : le rapport de Djibril est considéré par ses employeurs – l’entreprise est ironiquement placée sous la puissance tutélaire d’Adorno – comme répondant à leurs exigences. Dans ce roman important, Waberi montre combien l’auteur qui arrive des lieux les plus excentrés par rapport à l’origine du regard impérial est confronté peu à peu dans son écriture à la déprise de ce qu’il est, de ce qu’il doit à ce qui l’a nourri, comme si ces instances de reconnaissance et de légitimation, qui trop longtemps ont représenté ces lieux taraudés par des misères sans nom comme des lieux d’exotisme, réclamaient une redevance et la conformité à une institution. Ce qui guette l’écrivain prend effectivement un nom, dans le monde virtuel enregistré sur des disques durs, celui de formatage. En se tenant à la lisière des évidences, en accomplissant ce qui en elles les pousse à leurs limites, Waberi montre aussi que le vent chargé de sel qui souffle sur les bords du lac Assam continue à donner sens à son écriture.