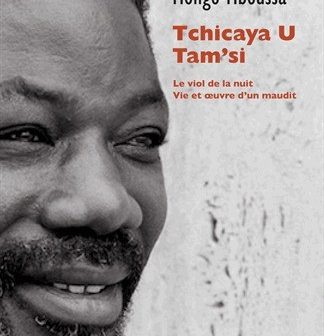Après avoir dirigé aux éditions Gallimard l’édition des uvres poétiques complètes de Tchicaya U Tam’si, J’étais nu pour le premier baiser de ma mère(2013), Boniface Mongo Mboussa vient de publier Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune. Vie et uvre d’un maudit.
C’est une évidence. La vie littéraire n’est nulle part ailleurs que dans l’esprit de chacun de ceux qui y participent. Il est plus que temps pour les écrivains africains de langue française de considérer comme une part indiscutable de leurs occupations créatrices le dialogue (écrit) avec d’autres uvres, du passé et du présent. Affecter d’ignorer autrui mais s’attendre à être lu et commenté est une étrange naïveté. Le milieu africain ne peut produire de grands écrivains sans fournir en même temps de grands lecteurs, c’est-à-dire des capacités de s’évaluer soi-même. L’un confirme l’autre et vice-versa. C’est être des contemporains à la manière des vaches dans un pré que de s’ignorer mutuellement, d’oublier nos grands décédés en dehors des éternels Senghor et Césaire ; alors que chacun espère pour soi une postérité, c’est-à-dire une présence dans l’esprit de ceux qui suivront. Si vous oubliez, vous serez oublié vous aussi, puisque telle est l’habitude. Ces derniers mois, l’écrivain Boniface Mongo-Mboussa nous apparaît admirablement comme celui qui s’efforce avec talent de conjurer cette existence purement physique dans un pré. Il a publié coup sur coup deux ouvrages décisifs de et sur le grand poète Tchicaya U Tam’si, décédé en 1988. Sans lui, constatons-le, rien de significatif n’aurait marqué les vingt-cinq ans de la disparition du poète. » Nous sommes dans l’inconcevable, mais avec des repères éblouissants « a écrit René Char en 1941. Tchicaya, tout comme Mongo Béti dont Mongo-Mboussa a publié chez Gallimard trois tomes d’écrits épars (Le Rebelle), est aussi un repère éblouissant dont il fallait pourtant, étrangement, rappeler le souvenir. Mongo-Mboussa le fait en historien rigoureux des lettres francophones et en écrivain. Le résultat est tout en érudition contenue et souple.
Il dit « je » ; mais juste ce qu’il faut pour poser qu’il s’agit non pas du renforcement académique d’un curriculum vitae ni d’une mise en valeur de soi, mais bien d’une prise en main de son propre héritage. Imaginons qu’un homme de lettres français confesse qu’il a découvert et commencé de lire Baudelaire pendant des années d’études en
URSS. Mieux, qu’il a lu pour la première fois l’auteur des Fleurs du mal dans une traduction en russe !
» Je lus le poème sur place. Puis je repris le métro pour la Perspective Nevski. A partir de ce jour, je n’ai cessé de lire Tchicaya U Tam’si. D’abord en russe, puis en français. Je l’ai donc découvert assez tard. (
) Je connaissais certains de ses poèmes parus ici et là dans des anthologies. Mais c’est en Russie que je l’ai lu, relu et médité. «
Nous nous laissons nous-mêmes par terre. C’est un fait. Boniface Mongo-Mboussa a étudié la civilisation russe dans l’Union soviétique finissante, avant de venir faire un doctorat en littérature comparée en France. L’évocation préliminaire de cet épisode personnel donne à cet ouvrage Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune un cachet particulier. Il y a là un devoir de dialogue littéraire, un réveil à soi. Quel est votre Pouchkine, là d’où tu viens, lui ont demandé en substance des amis russes. Peut-on hausser les épaules et tourner le dos à une telle question ?
Osons-le. Finalement, écrire un énième livre sur Senghor ou Césaire, c’est exploiter un filon, tirer profit de deux réputations bien établies et consensuelles tout compte fait. Je doute que, désormais, en écrivant sur les deux pères de la négritude, on leur apporte plus qu’on y gagne. Tchicaya aussi est un grand poète. Mongo-Mboussa cite Césaire qui, le premier, a rassuré à ce sujet son collègue à l’Assemblée nationale française Jean Félix-Tchicaya, père du poète, et aussi des mots de Senghor qui disent son admiration de lecteur. Je répète les noms de Césaire et de Senghor ; c’est que Tchicaya, né en 1931, est de la génération qui suit immédiatement celle de ces deux grands. C’est bien cela ! Tchicaya fut une vie que des circonstances particulières menaçaient sans cesse d’étouffer. Un père député du Congo à l’Assemblée nationale française et qui rêve de faire du futur poète son héritier politique, une séparation définitive d’avec la mère à moins de cinq ans, un pied-bot, une scolarité ratée et une absence de diplôme (même pas le bac !), » la tapageuse et politicarde gloire » (Tchicaya) d’un Senghor, etc. Sans répit, cet homme a dû lutter pour avoir sa part tout à fait légitime d’oxygène ! En l’espace de quelques 138 pages, Boniface Mongo-Mboussa, avec une maîtrise si réelle qu’elle échappe à l’attention du lecteur, éclaire cette vie complexe et les uvres qui en découlent. Tchicaya n’est pas un homme d’esprit improvisé. Le précèdent au moins deux générations de gens entreprenants et même instruits. Mongo-Mboussa remonte aux origines familiales du poète, rappelle le contexte historique, implique dans le propos Savorgnan de Brazza ou l’André Gide du magnifique Voyage au Congo
L’histoire, du reste, est sans cesse présente dans l’uvre de Tchicaya U Tam’si ; elle en est l’un des éléments essentiels, avec la douleur initiale de cet arrachement à la mère. Ayant eu accès aux carnets personnels du poète, Mongo-Mboussa nous permet de mieux saisir les souffrances sublimées en vers et la portée géographique des romans et des nouvelles. On est comme frustré de ne pouvoir restituer dans un simple compte rendu toute la richesse de cet ouvrage inattendu qui est tout à la fois biographie, étude, histoire littéraire et qui se lit comme un roman.
Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune
Vie et uvre d’un maudit
De Boniface Mongo-Mboussa
Ed. Vents d’ailleurs, 138 pages, 18 euros
Parution : mars 2014///Article N° : 12184