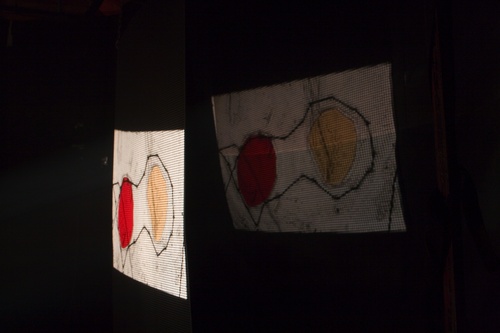« Ce qui m’a fasciné au théâtre, c’est comment tout se transforme, et je parle d’un théâtre qui se passe sur une place, dans l’arrière-cour d’un bar ou d’une maison. Tout d’un coup il se passe quelque chose et la place n’est plus une place, et l’homme devient une femme, et la femme devient un homme, et la parole devient autre chose J’ai fait cette découverte-là avant même de lire du théâtre. » (1) Etrange pouvoir, empreint de sacré qu’a le Théâtre dans la bouche de Kossi Efoui. Pour ce dramaturge aussi auteur de romans, le théâtre marche par ce qui lui est propre : l’espace et la parole.
Supports transformables qui constituent à la fois l’essence même de l’art théâtral, et sa limite : dans un espace et un temps clos et délimités se construisent des dramaturgies dans lesquelles le temps et l’espace se transforment, s’étirent, se contractent. C’est autour de cette image de l’espace-prison que le théâtre essaye toujours d’éclater, de déchirer que se construisent les pièces de Kossi Efoui. Mettant en scène des personnages bloqués sur scène et rêvant d’ailleurs, il axe sa dramaturgie autour d’espaces dépouillés, vides ou en ruines dans lesquels la parole des personnages va convoquer une multitude d’espaces en fondus enchaînés, illustrant la parole d’Antonin Artaud qui déclarait qu’il y avait une « notion nouvelle de l’espace qu’on multiplie en le déchirant ».
Mais pour déchirer un espace il faut d’abord que celui-ci pose sa contrainte. La plupart des pièces de Kossi Efoui présentent toutes la particularité de se dérouler dans un seul espace scénique : un chantier sur les ruines d’un studio de cinéma dans Le Petit Frère du rameur, un plateau de télévision avec un décor de bidonville dans Récupérations, un carrefour dans Le Carrefouret La Malaventure. On ne quittera pas physiquement cet espace-là. Ici l’auteur semble y jouer avec la limite du Théâtre, c’est-à-dire l’impossibilité de voyager physiquement durant la représentation. Tout autant que le spectateur est bloqué dans la salle, les personnages sont bloqués sur la scène.
Espaces-prisons, associés au gris, au silence et au froid de la tombe ; les espaces scéniques de Kossi Efoui sont autant une affirmation de la possibilité du théâtre à investir n’importe quel espace par leur simplicité et le peu de moyens qu’ils requièrent pour être montés sur scène qu’une revendication d’un espace et d’un temps complètement autre. Dans Le Carrefour, le cycle du temps jour/nuit est remplacé par le rythme du réverbère qui s’allume et s’éteint. Il n’y a ni fleurs, ni soleil, ni saisons mais un Souffleur qui crée l’espace en allumant le réverbère, délimitant un espace par un geste millénaire. Un espace où le temps humain n’a plus raison d’être, un temps qui n’avance plus sur une ligne droite mais un temps de la répétition, de la courbe et de la distorsion. L’espace scénique se construit entre un passé dont il reste les traces physiques (le chantier du Petit Frère du rameur, qui n’est plus un studio et pas encore un nouveau bâtiment, c’est un endroit de transition) et un avenir qui définit les espaces où les personnages veulent se rendre. Ce point de bascule est aussi géographique : Récupérations n’est ni dans le vrai bidonville, ni dans l’émission de télé finalisée, on est sur le plateau, point de bascule entre réalité du bidonville et écran de la télévision. Le Petit Frère du rameur n’est ni vraiment dans un espace d’arrivée (les journaux ne parlent pas de Kari, montrant la déconnexion de ces immigrés avec l’information quotidienne du pays) ni dans le pays d’origine (dont ils sont coupés, où il faut un bateau pour se rendre et dont il ne reste que des souvenirs épars). Tous les deux impossibles à localiser géographiquement (dans l’enfance de Marcus, lorsque sa famille lui demandait de désigner l’endroit où ils étaient, il pointait un faux endroit sur la carte). Ainsi nous sommes dans l’entre-deux. Autant temporellement que spatialement, le théâtre de Kossi Efoui se place en équilibre entre passé et futur, entre espace d’où l’on vient et espace où l’on va. Les forces du passé, les fantômes des anciennes histoires et la frontière (incarnée par le flic par exemple) contrebalancent les envies de mouvement vers l’avenir et un autre lieu. Le théâtre de Kossi Efoui est un théâtre suspendu, toujours sur le fil, comme un arrêt avant le saut dans l’abîme. Les personnages y sont à la croisée des chemins, au carrefour qui est un endroit d’arrêt, de choix, de croisement, de confrontation. Et de cet arrêt naît le déploiement des images.
Car il ne faut pas oublier que Kossi Efoui place sa démarche artistique dans une problématique sacrée : « Pour moi le sacré est très important. Je crois que nous vivons un moment où le sens de la vie et le sens du sacré sont complètement perdus. Or la culture est justement, pour moi, de l’ordre du sacré. La culture est un moyen de magnifier la vie contre l’angoisse de la mort que nous vivons quotidiennement ». Le Théâtre prend sa source dans l’espace mortuaire et dans la présence de la mort, car il y a une magie de la représentation et un rituel de la parole qui convoque ce qui n’est plus pour passer dans l’espace de l’imaginaire. Lorsque la personne meurt, on convoque les anecdotes de son passé, on commémore la mort en invoquant ce qui a marqué la vie. Dans Le Petit Frère du rameur, les personnages dans le chantier-sarcophage invoquent le passé de Kari, et dans cette boîte noire qui est autant une tombe qu’une caméra, ils projettent des images qui envahissent l’espace scénique et le transforment. Entrer dans cet espace c’est entrer dans l’espace du film, de la fiction :
« MARCUS : [
] Un studio de cinéma, c’était. Grand comme un quartier dehors, jusqu’à la grande avenue. Et quand tu entres dans un film grand comme une ville
»
Et le passé devient présent, se rejoue devant nous, comme Maguy conversant à nouveau avec Kari. Cependant ce jeu marque d’autant plus l’absence et la mort de Kari, le manque de son corps qui n’est pas là mais entre les mains du Rameur, l’impossibilité d’accomplir le deuil. Une logique qui nous fait voir le théâtre de Kossi Efoui comme une dramaturgie de l’absence. Que ce soit dans Récupérations avec le décor de bidonville ou dans Le Petit Frère du rameur avec l’absence du corps de Kari, les espaces sont des leurres, des répliques qui marquent le vide plus qu’ils ne permettent de se raccrocher à quelque chose, obéissant à la volonté de Kossi Efoui de « ne plus être présent là où on est attendu, mais systématiquement donner rendez-vous ailleurs, déplacer les questions ailleurs » (2). Nous sommes dans l’à-côté. À côté du bidonville que l’on rase, à côté de la véritable veillée funèbre. Si ces espaces de l’à-côté semblent à l’abri du monde extérieur, cette illusion d’abri empêche une action sur l’extérieur qu’on ne peut ni bien voir ni modifier. Ces lieux ne pointent que la cruelle absence d’un corps ou d’un lieu concret. Tout échappe. Les habitants du bidonville sont impuissants à empêcher la destruction du bidonville, et Marcus, Maguy et le Kid impuissants à empêcher que la camionnette du Rameur emporte le corps de Kari. Dans cette scène, l’extérieur nous est raconté par Le Kid. Il se place en observateur qui rend compte sans pouvoir agir sur ce qu’on ne voit pas. Cependant, Maguy, en créant l’image de la camionnette en flammes par sa parole, crée une image qui remplit l’espace scénique et remplace l’extérieur. Kari est enterrée dans la fiction, crée par la parole et qui permet de garder le mouvement des corps. Car si Kari est morte, elle danse sur son cercueil, et son passage dans la fiction des mots lui assure un mouvement éternellement au présent qui fait de la mort une simple re-création du corps et du théâtre une énergie en éternel mouvement.
La parole possède alors un statut particulier. Elle n’est pas action au sens aristotélicien mais répétition et réminiscence. Elle est espace et temps. Lorsque les personnages parlent ils semblent générer des monologues intérieurs ou des anecdotes du passé qui dessinent des instants et des lieux. À chaque fois qu’un personnage prend la parole il dessine sur la scène-écran une image qui n’a de consistance que par sa parole et qui sera remplacée par une autre. Ces espaces vides favorisent l’introspection et l’anecdote, ne font au fond que confronter les personnages à leur vide. Tel Dieu criant face à la caméra dans Récupérations ou Marcus tentant de parler de son film, la parole est fragmentée, répétée, malmenée, dessinant des espaces par touches. Comme Émile Lansman parlant de Kossi Efoui disant que son écriture rend compte de la fracture de l’espace géographique et mental, on remarque que les espaces ne sont jamais appréhendés dans une vision totalisante mais toujours par petits bouts. La plupart des pièces n’ont pas de didascalies introductives mais c’est la parole des personnages qui décrit l’espace petit à petit. Dans Récupérations, au début de la pièce, l’attention est portée sur des objets, des détails qui constituent le décor et non sur une vision d’ensemble, on s’attarde sur le clou, les casseroles, le caillou, le sachet, la baraque, la banderole. Il n’y a pas de didascalie de départ qui décrit l’espace mais la journaliste en accueillant les habitants signale que c’est un décor.
La parole et la perception des personnages abordent l’espace par morceaux, par petits bouts et non pas par une vision. Montrant bien le caractère de dépotoir et d’accumulation de cet espace de décor de bidonville. Dans sa constitution même de lieu d’habitation construit sur des déchets et de la récupération, le bidonville empêche d’être vu de manière cohérente et ordonnée. La vision fragmentée des personnages correspond au caractère fragmenté de l’espace, cependant la somme de ces regards et de ces perceptions ne crée pas une cohérence construite mais plutôt une accumulation dénuée de sens.
L’espace est changeant, modelable par la parole et les supports médiatiques. Dans cette accumulation de perceptions qui crée l’espace scénique par la parole autant que l’espace du hors scène, Kossi Efoui semble mettre en place une dramaturgie des apparitions qui nous place dans une dimension mentale de l’espace. On apprend à la fin de la pièce Le Carrefour que nous sommes en fait dans la tête et les souvenirs du poète enfermé dans la prison. Le caractère hors du temps et du monde s’explique dans cet espace mental qui se rejoue à jamais. Si on élargit cette idée aux autres pièces on remarque qu’en effet les espaces scéniques de Kossi Efoui sont envisagés comme des supports pour le développement d’espaces mentaux projetés par les personnages. La scène ne représente pas alors un support concret dans le sens où elle serait un lieu réel dans lequel l’action se déroule. Que ce soit ces ruines, ce plateau de télévision ou ce carrefour inconnu nous sommes toujours dans des espaces symboles et sans lien concret avec le monde réel. L’espace n’est pas à conquérir, le mouvement des personnages est même inverse. Dans un espace qui est vide en lui-même et qui retient les personnages, le mouvement dramaturgique de ces derniers est de sortir de ces espaces ou de les transformer. En y projetant des histoires, des réalités, Kossi Efoui nous montre d’une certaine manière le pouvoir transformateur du théâtre dont il parle. Tout comme les personnages qui essayent de transformer les espaces morts, vides dans lesquels ils sont en convoquant des histoires et des attitudes de jeu, le dramaturge opère la même action. Les espaces de Kossi Efoui sont les espaces dont le Théâtre s’empare à chaque fois que l’acteur entre en scène : de rien, c’est-à-dire donc, d’un espace qui peut accepter toutes les constructions, le théâtre crée et délimite un espace de la représentation qui va donner à voir et à entendre d’autres lieux et d’autres temps. Et ainsi essayer de dépasser par la transformation du geste et de la parole (qui devient répétition et réminiscence comme on l’a vu), le lieu physique dans lequel l’acteur se trouve.
Les personnages de Kossi Efoui sont hauts en couleur, possèdent une vitalité incroyable et un verbe fleuri. Les imprécations de Dieu dans Récupérations ou l’éternelle envie de fuite du Poète sont autant de signes d’une vitalité et d’une énergie corporelle qui sont motivées par la nécessité se sortir de cet espace fermé. Au final il crée une logique d’espace qui obéit à son axe de marronnage. L’espace théâtral, scénique comme dramatique, est un espace contre lequel on se bat, qui n’est jamais acquit, qu’on essaye de s’approprier par la transformation. C’est cette logique, qui fonctionne autant au niveau de la représentation qu’au niveau dramaturgique, qui nous fait entrevoir qu’avec ces espaces de l’à côté, Kossi Efoui dessine une dramaturgie spatiale qui essaye d’emmener le spectateur là où il ne s’y attend pas.
Face à la perte de la mémoire et à travers les corps mutilés convoqués encore et encore, le poète/dramaturge essaye de garder la trace et de se frayer un chemin. Le Poète déclare à la fin du Carrefour : « je suis la mémoire désormais ». C’est dans l’espace texte que réside l’espoir d’une issue poétique. Dans l’entre-deux d’une dramaturgie africaine francophone luttant pour s’extirper des clichés et des problématiques d’origine, Kossi Efoui dessine des espaces universels de la perte et de la contrainte dans lequel l’humain fragile se débat pour transformer un monde qui ne lui convient jamais. Et c’est dans ce combat mi-religieux, mi-artistique qu’il convoque la magie et les images pour revitaliser le monde mort et déchiré.
1. L’Afrique noire et son théâtre au tournant du XXE siècle, PUR, Rennes, 2001, p 81-87
2. Kossi Efoui, table ronde « Africanité et création contemporaine », animée par Sylvie Chalaye, université de Rennes 2, 13 janvier 1999.///Article N° : 10511