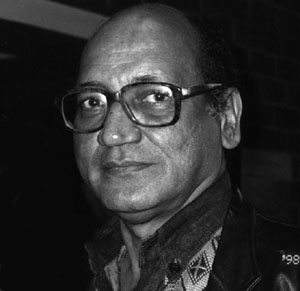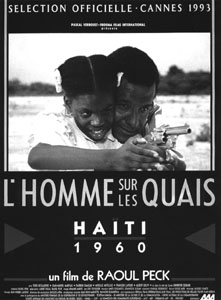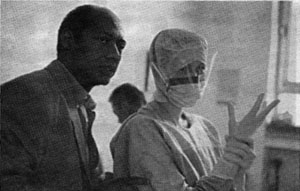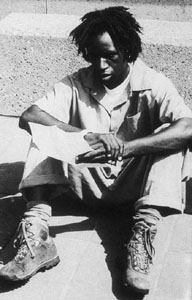Cinéma/TV
Montréal, mai 1998
Pourquoi tant de méfiance pour financer votre film ? C’est à cause de la méconnaissance totale du milieu immigré de ceux qui ont eu mon scénario entre les mains. On me reprochait souvent de montrer des situations conflictuelles exagérées et caricaturales. Est-ce que ceux qui avaient analysé mon scénario avaient serré une seule fois la main d’un immigré à Paris ? Comment comprendre une société immigrée quand il n’existe aucune communication, quand il n’est établi aucun lien ? Ce film, moi je ne l’ai pas improvisé ! Pour faire ma maquette, j’ai fréquenté plusieurs foyers, pour y découvrir les gens. Ce que j’ai écrit…