Alors même que les éditeurs africains se regroupent pour mieux diffuser leurs livres au niveau panafricain et international, les francophones à travers Afrilivres et les anglophones avec African Books Collective, la sortie du superbe ouvrage de l’éditeur britannique James Currey, Quand l’Afrique réplique, nous amène à mettre en perspective les tentatives des éditeurs européens francophones et anglophones de collections d’auteurs africains, leur diffusion et leur impact en Afrique.
La sortie de Quand l’Afrique réplique constitue une étape importante dans l’évolution de la collection L’Afrique au cur des lettres dirigée par Jean-Pierre Orban depuis maintenant plus de sept ans. En effet, depuis 2004, cette collection balaie une grande partie du champ littéraire consacré à l’Afrique. Que ce soit la vision qu’ont eu certains grands écrivains européens du continent (Mark Twain avec Le Soliloque du roi Léopold – 2004 – ou Jules Verne avec L’Étonnante Aventure de la mission Barsac en deux volumes – 2005 précédé d’une excellente préface d’Antoine Tshitungu Kongolo), des inédits de grands écrivains congolais (Ah ! Mbongo de Paul Lomami Tchibamba, Sans rancune de Thomas Kanza), ivoiriens (Déjà vu/Quelque part du poète Noël X. Ebony) ou mauriciens (Malcolm de Chazal avec Moïse et Autobiographie spirituelle), des articles de journaux revisités (Carnets de voyage de Antoine-Roger Bolamba, autre écrivain fondateur de la littérature congolaise), elle permet de (re) découvrir des textes souvent inconnus ou tombés dans l’oubli et offre une nouvelle vision d’un continent trop souvent relégué à un désert littéraire.
Deux autres ouvrages viennent apporter un éclairage plus scientifique sur la vision que nous avons de l’Afrique. Tout d’abord, le superbe Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa de Silvia Riva donne un éclairage étonnant sur les écrits de ce géant démographique. Puis, en 2009, Io l’Africaine de Momar Désiré Kane donnait un surprenant éclairage sur l’influence qu’exerce l’imaginaire africain de l’antiquité sur la pensée occidentale.
Il restait à Jean-Pierre Orban d’aborder « l’autre Afrique », l’anglophone, celle qui nous est moins familière. C’est chose faite avec Quand l’Afrique réplique de James Currey qui aborde la littérature africaine anglophone à travers la collection-phare britannique African Writers (collection relevant des Éditions Heinemann), qui a joué dans le monde anglophone un rôle équivalent à celui de Présence africaine pour le monde francophone.
Créée au début des années soixante, l’African Writers series (AWS) a permis de populariser la plupart des auteurs africains de langue anglaise. Les plus grands noms du continent y ont fait leurs premières armes.
C’est le cas du Nigerian Chinua Achebe dont la publication de Things Fall Apart (Le Monde s’effondre) en 1958 chez Heinemann Educational Books à Londres marque les vrais débuts de la littérature africaine anglophone. La réédition de cet ouvrage en 1962, suivi d’un deuxième roman, No Longer at Ease (Le malaise) l’année suivante feront partie des premiers titres de la collection. Dès décembre 1962, Achebe devient conseiller éditorial pour la collection (sans être rémunéré), ce qui contribuera à attirer d’autres auteurs africains. Le Kenyan Ngugi wa Thiong’o, bien avant qu’il ne bascule vers la littérature en langue kikuyu, y publie également ces deux premiers textes, Weep Not, Child (1964) et The River Between (1965) qui traitent des rapports entre Blancs et Noirs à l’époque de la révolte des Mau Mau.
La collection continuera pendant quelques années en proposant des recueils de poésie, des traductions de textes (les Camerounais Oyono avec Une vie de boy et Mongo Beti avec Mission terminée), des romans et de superbes documents sur l’esclavage comme The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African (La Véridique Histoire, par lui-même, d’Olaudah Equiano) jusqu’en 1967 où James Currey est recruté pour la diriger.
Les dix premières années, cent titres sont publiés avec, dans bien des cas, de superbes chiffres de vente. L’ensemble de la collection African Writers Series devient vite rentable et permet de faire des choix audacieux qui en font le reflet « de la richesse et la variété d’une Afrique naissante (1) ». L’une des raisons tenait au fait que le WAEC (West African Examination Council) et le EAEC (East African Examination Council) avaient décidé d’inscrire les uvres de l’African Writers Series au programme scolaire de pas moins de sept pays ce qui entraîna des ventes conséquentes dans les milieux scolaires et universitaires. Au début des années soixante-dix, après dix années de bons et loyaux services, Achebe décide de prendre du recul et de se retirer de son poste de conseiller éditorial.
Les responsables de la série décident alors de remplacer ce poste par un système triangulaire de consultation entre les éditeurs en poste à Nairobi, Ibadan et Londres, ceci afin de rester en contact avec la scène littéraire nigériane très dynamique et entreprenante. La collection s’oriente vers une multiplicité des genres : la poésie est publiée en fonction du soutien des éditeurs et des conseillers. Le théâtre, pour sa part, était tributaire « des rares producteurs dynamiques capables de visualiser les scripts en production et pas seulement sur une vraie scène de théâtre mais dans des théâtres de plein air en terre ou depuis les bennes arrières d’un camion dans les townships assiégées d’Afrique du Sud. » (2)
Peu à peu, au prix de gros investissements financiers en matière de voyages, de factures téléphoniques et de frais d’envois postaux, Heinemann constitue un vaste réseau international de contacts et de supervisions sur tout le continent.
Avec le choix de rester en « paperback » (3) (couverture souple) donc moins cher qu’en « hardback » mais avec un format supérieur aux autres et une meilleure qualité d’impression, la collection attire l’attention des critiques littéraires et le marché des bibliothèques (gros acheteur d’ouvrages, comme en France). Les écrivains, peu désireux d’être classés comme « écrivains africains » comprennent que l’African Writers Series constitue une ouverture vers l’extérieur.
De Dambudzo Marechera à Nuruddin Farah (Somalie) et, de Naguib Mahfouz (Égypte) à Mongo Beti (Cameroun), Alex la Guma (Afrique du Sud) ou Mia Couto (Mozambique), une grande partie des grands noms de la littérature africaine de langue arabe, française ou portugaise se fait connaître au monde anglo-saxon grâce à la collection. C’est en particulier le cas de la poésie qui y trouve ses lettres de noblesse. Au début, la plupart des écrivains anglophones publiés étaient de l’Ouest avec une proportion importante de Nigérians. Mais, par la suite, à compter des années soixante-dix, la collection s’ouvrira plus particulièrement aux écrivains d’Afrique de l’est (Kenya, Tanzanie) et d’Afrique australe.
Mais la collection n’accueillera pas uniquement des hommes de lettres. Elle éditera également des hommes politiques comme Olusegun Obasanjo, futur président du Nigeria, qui y racontera sa version de la guerre du Biafra (My Command – 1981), mais aussi le livre de Nelson Mandela, No Easy Walk to Freedom paru en 1973 (traduit en français sous le titre Un long chemin vers la liberté) ou du futur président zambien Kenneth Kaunda avec le 4e titre de la collection Zambia Shall be Free (1962) qui se vendra à 500 000 exemplaires durant les vingt premières années de diffusion. La collection accueillera également les premiers textes des écrivains sud-africains en lutte contre l’apartheid dans leur propre pays, comme Nadine Gordimer, Alex la Guma, Cosmo Pieterse ou même emprisonnés à Robben Island (D.M. Zwelonke).
Avec l’aide efficace de Doris Lessing (4), des écrivains zimbabwéens ont également été publiés par la collection, comme Dambudzo Marechera, véritable génie littéraire mort à 35 ans des suites du sida. Mais il ne fut pas le seul et le Zimbabwe devint dès la fin du régime raciste de Ian Smith en 1979, un des pays phares de la collection. C’était dû en partie au fait que Salisbury (devenu Harare) allait devenir l’un des centres d’édition les plus entreprenants et les plus créatifs d’Afrique et son Salon du livre, un lieu d’échanges commerciaux pour les droits internationaux sur tout le continent. D’autres régions furent concernées : l’Afrique lusophone, la Somalie et l’Éthiopie.
Après un arrêt en 2003 par Heinemann, la collection est relancée en 2009-2010 par Pearson, premier éditeur mondial qui réimprime à petite échelle quelques titres avec de nouvelles couvertures.
De façon générale, jusqu’en 2003, la collection éditera près de 400 ouvrages qui seront publiés, avec souvent de belles réussites en termes de vente. En effet, sans atteindre les chiffres de Kaunda, bien des titres s’écouleront à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Même dans les années quatre-vingt, lorsque les ventes de livres en Afrique connurent une sévère crise, les premiers tirages oscillaient entre 3000 et 5000 exemplaires. Ce fut le cas par exemple du premier ouvrage du poète malawite Jack Mapanje en 1981 tel que décrit dans l’ouvrage (p. 365) : « Le directeur réduisitensuite le tirage à 2 500 exemplaires, ce qui était le plus faible tirage jamais atteint dans la collection « African writers ». Cela s’avéra être une mauvaise économie, puisque nous dûmes réimprimer au bout de dix mois. »Cette situation peut paraître surréaliste aux yeux de n’importe quel éditeur européen de poésie pour lequel un tirage à 2 500 exemplaires pour le premier recueil d’un poète encore inconnu relèverait d’un rêve inaccessible. Wole Soyinka, pourtant très rétif à l’idée d’être publié dans la collection, vit son roman The Interpreters, vendu à plus de 100 000 exemplaires. En moyenne, les romans étaient tirés à 10 000 exemplaires et étaient souvent réimprimés dans les trois années qui suivaient, le premier tirage de la poésie oscillait entre 3000 et 5000 (un poète comme Dennis Brutus fut même tiré à 9 000 exemplaires) et les pièces de théâtre, autour de 5 000. De ce fait, « les comptables de la maison d’édition considéraient la vente de 10 000 exemplaires comme un échec. » (p. 112)
Les écrivains francophones ont vu les ventes de la version traduite en anglais de leurs uvres largement devancer celles de la version originale. Les ventes des dix tirages de Mission to Kala (Mission terminée) de Mongo Beti atteignit 80 000 exemplaires entre 1964 et 1974. Sembene Ousmane, pour sa part, vendit plus de 50 000 exemplaires de God’s Bits of Wood (Les Bouts de bois de Dieu) grâce en partie aux ventes dans les écoles et les universités. Vingt titres de la collection ont dépassé les 100 000 ventes. Ces succès eurent comme effet bénéfique le versement de droits d’auteurs parfois substantiels aux écrivains publiés dans la collection, situation quasi-inimaginable chez d’autres éditeurs, et, en tous les cas, unique en Afrique. La collection fut incontestablement un réel succès et un modèle pour l’ensemble des éditeurs africains et européens souhaitant aborder le continent africain.
Comment est-il possible d’expliquer ce phénomène et, en particulier, la différence sidérante avec les éditeurs français pour qui le marché africain est, au mieux, un marché scolaire
?
Les raisons en sont d’abord socio-économiques. C’est en particulier le cas des infrastructures (en particulier routières, ferroviaires, portuaires et énergétiques) qui sont, avec la taille des pays, les deux grandes faiblesses des pays francophones. Les marchés nationaux des pays francophones sont en effet vite saturés et exporter dans les autres pays est difficile en raison des obstacles réglementaires et des coûts de transport importants. De plus, l’état des routes dans bien des pays, en particulier en Afrique centrale, rend difficile la diffusion à l’intérieur des frontières. En conséquence, la surface de vente d’un livre se limite souvent aux quelques librairies de la capitale.
De fait, la régionalisation des marchés fonctionne mieux en Afrique anglophone et, en particulier en Afrique de l’est (Kenya, Tanzanie, Ouganda). Bien d’autres « causes externes » peuvent être avancées : la fragilité du franc CFA, les conflits nombreux qui ont émaillé les pays francophones et bien évidemment les différentes crises économiques. De plus, à l’échelle mondiale, la surface de vente d’un livre en langue anglaise est évidemment bien plus importante qu’un ouvrage en français, l’édition anglophone pouvant s’appuyer sur le géant américain et d’autres solides marchés (Canada anglophone, Australie, Nouvelle Zélande) ou émergent (Afrique du Sud et surtout l’Inde où la maîtrise de l’anglais reste minoritaire dans le pays – 4 % de la population – mais importante numériquement car portant sur un milliard d’habitants). De fait, si un ouvrage français est considéré comme un best-seller à compter de 200 000 ventes, on peut multiplier par dix pour trouver son équivalent en langue anglaise. Cela permet d’ailleurs aux éditeurs anglophones de faire des économies substantielles. Par exemple, les ouvrages des éditeurs britanniques vendus en Inde sont directement imprimés sur place (5) et non importés comme le sont les ouvrages en français en Afrique francophone (6). Les ventes s’en ressentent. Un ouvrage comme Things Fall Apart de Chinua Achebe a, par exemple, dépassé les dix millions d’exemplaires vendus pour sa version anglophone. Cette situation reste évidemment exceptionnelle, même au sein du monde de l’édition de langue anglaise mais est totalement impossible pour l’édition francophone.
Enfin, au risque de reprendre des lieux communs, il existe jusqu’à aujourd’hui au sein des pays anglophones une véritable culture de la lecture (7) qui peut expliquer, par exemple, l’état relativement correct des bibliothèques. Celles-ci ont continué à avoir un budget d’acquisition, et donc à acheter des livres, même lorsque les finances du ministère de l’éducation du pays étaient en baisse (8). Une partie du succès de la collection s’explique aussi par ces achats institutionnels. Cette culture de la lecture, bien propre aux pays protestants, ne va pas jusqu’à la sacralisation du livre, telle qu’on peut la constater dans les pays latins. Si les ouvrages en « paperbacks » (couverture souple, donc) rencontrent peu la faveur des critiques, ils ne sont pas mal perçus par le public et aussi par les auteurs. La situation est tout à fait différente dans les pays francophones fortement influencés par la culture du beau « livre-objet » qui règne toujours en France. C’est très vrai par exemple dans le domaine de la BD où la notion d’album cartonné avec pages en couleurs reste le but ultime pour des auteurs peu influencés par le genre des mangas qui, cultivant la couverture souple et le noir et blanc, sont moins onéreux à fabriquer et plus adaptés aux porte-monnaie locaux.
Économie défaillante, marché limité, difficultés de diffusion, livre sacralisé et donc onéreux, toutes ces raisons expliquent en partie les différences entre Afrique anglophone et francophone. Mais cela n’explique pas tout.
La réussite de AWS s’explique également par ses méthodes qui constituent une réelle différence avec les maisons d’édition françaises.
Là où les éditeurs français sont d’abord et avant tout parisiens, AWS a installé en Afrique des bureaux qui n’étaient pas des bureaux de représentation, mais également des « bureaux-source » qui avaient une réelle influence dans le choix des textes et la sélection des auteurs, dans le marketing et la promotion. Comme le stipule l’ouvrage en page 80 : « L’écrivain somalien Nuruddin Farah en et un bon exemple. Ce sont des critiques littéraires [
] à Nairobi qui ont su déceler les premiers ses qualités littéraires aujourd’hui reconnues par les critiques littéraires de Londres et de New York. » Du côté francophone, même une maison d’édition africaine réputée comme Présence africaine, pourtant pionnière dans le genre puisque créée en 1947, est restée associée au quartier latin dans l’esprit du public intéressé.
Là où les éditeurs français ou belges cherchent des « coups » à travers des projets de la banque mondiale, des coopérations françaises et belges ou de l’Union Européenne, AWS a toujours mené une politique de promotion de son catalogue à travers les professeurs d’université, les collègues écrivains, les milieux littéraires, aidé en cela par la forte présence d’Africains dans les équipes éditoriales de la collection (Henri Chakava succéda à Chinua Achebe en 1972) : une collection écrite par des Africains, promue par des Africains et dirigée (en partie) par des Africains pour des Africains, telle est, en schématisant, la façon dont on pourrait décrire l’African Writers Series. La décision d’Aig Hugo, directeur du bureau nigérian de AWS, de construire en 1972, juste après la guerre civile, des entrepôts à Ibadan pour gérer l’afflux d’ouvrages de la collection est très révélateur de cet enracinement « local ».
Enfin, AWS, comme l’ensemble des éditeurs anglo-saxons, a toujours considéré le Commonwealth comme un marché à part entière. Ceci peut expliquer l’implantation en Afrique de filiales locales d’éditeurs anglo-saxons comme Heinemann, Random House ou Macmillan, qui travaillent sur le terrain depuis leurs bureaux régionaux (Nairobi, Lagos, Johannesbourg, Harare) avec une autonomie certaine sur le plan éditorial. Certains bureaux devenus filiaux prendront même leur autonomie et changeront de nom. C’est le cas de East African Educational Publishers Ltd (9)au Kenya créé en 1992 par Henri Chavaka sur les cendres de l’ex Heinemann (Kenya) Ltd et qui est maintenant entièrement possédé par des Africains et présent dans plusieurs pays d’Afrique avec une réussite certaine.
Cette politique est inimaginable du côté francophone où les éditeurs préfèrent prendre des parts dans le capital d’éditeurs africains que ceux-ci soient publics (c’est le cas de Hâtier avec les Nouvelles Éditions Africaines à Dakar – divisés par la suite en NEI et NEAS – et Les éditions de l’Océan Indien à Maurice) ou privés (de Boeck avec Afrique Éditions en RDC) sans stratégie particulière sur le long terme.
Enfin, AWS, issu d’un éditeur éducatif comme Heinemann, a fondé sa stratégie commerciale en essayant d’être sur les listes d’ouvrages étudiés ou conseillés dans les différents programmes scolaires et universitaires des pays d’Afrique anglophone. Ce qu’elle arrivait à faire grâce à son réseau et la qualité des textes proposés. De cette façon, alors que l’édition d’ouvrages en Afrique francophone a toujours été soutenue par des aides et des subventions de la part d’organismes internationaux, AWS « n’a jamais eu besoin d’un tel soutien et a survécu sur le marché en suivant les lois du capitalisme occidental (10).«
Heinemann ne fut d’ailleurs pas le seul à s’attaquer au marché africain avec des titres écrits par des auteurs du continent. D’autres éditeurs britanniques ont suivi le même parcours. Ce fut le cas d’Oxford University Pressqui lança en 1963 la collection Three Crowns pratiquement en même temps que AWS. Il y eut également la collection Fontana qui avait les droits sur la traduction anglaise de L’Enfant noir de Camara Laye et dont les titres se vendaient aussi bien que ceux de AWS. Longman a également lancé une collection Dreambeats incluant à la fois des écrivains africains et antillais et qui accueillera les premiers écrits de Ben Okri.
Mais ces tentatives n’atteignirent pas la réussite de AWS qui proposait une vingtaine d’ouvrages nouveaux par an alors que les autres éditeurs ne comptaient pas plus de 20 ouvrages d’auteurs africains pour tout leur catalogue.
André Deutsch, éditeur londonien, créa African Universities Press à Lagos ainsi que East African Publishing Houseà Nairobi. Cette dernière, par le biais de sa collection Modern African Library, deviendra dans les années soixante le pendant à l’Est de African writers à l’Ouest.
Une autre différence tient aussi à l’édition en langue locale. Le bureau de Nairobi a édité en édition nationale plusieurs ouvrages en swahili et dans d’autres langues. Tout cela est en partie le résultat du statut du swahili, langue officielle en Tanzanie et nationale au Kenya et en Ouganda mais aussi du combat d’un écrivain comme Ngugi qui a publié une grande partie de ses uvres en kikuyu. Cela ouvrira la voie par la suite à une diffusion de l’édition africaine en anglais et en swahili par l’African Books Collective, association à but non-lucratif fondée en 1989 par dix-sept éditeurs africains et présents encore de nos jours dans une grande partie des pays de langue anglaise. L’équivalent n’existe pas dans l’édition francophone, la tentative du Sénégalais Boubacar Boris Diop de publier en wolof (Doomi golo en 2003) n’a guère fait d’émules.
La dernière différence entre les deux mondes éditoriaux, soulignée en filigrane dans le livre, tient à la relation à l’écrit entre langue locale et langue officielle (en réalité langue de l’ancien colonisateur). Ce concept (rendre compte de sa langue maternelle en utilisant le français) a eu du mal à s’imposer dans les milieux littéraires français. Alors que ce principe s’était déjà emparé des ouvrages sortis en anglais dès les années cinquante et soixante (les exemples sont nombreux, de Chinua Achebe à Gabriel Okara avec The voice, en passant par le Sud-Africain Peteni et Hills of fools), le premier roman de Kourouma (Le Soleil des indépendances), truffé d’expressions françaises inspirées du malinké, était refusé par tous les éditeurs parisiens en 1964. Il fallut attendre 1968 pour qu’un éditeur québécois accepte de le publier (11) et plus encore pour que ce français tropicalisé soit pris à sa juste considération. L’aveuglement français à cette littérature africaine imaginative bascula quelquefois dans le burlesque avec Amos Tutuola, écrivain yoruba génial qui produisait à l’écrit des uvres proches de l’oral.
Lorsque l’ouvrage de celui-ci, L’Ivrogne dans la brousse, parut en 1953, une grande partie des critiques pensa que le traducteur, Raymond Queneau, un temps surréaliste et cofondateur du mouvement de l’Oulipo, avait voulu écrire sous pseudonyme. Lorsque Tutuola fut réellement reconnu comme l’auteur de l’uvre, il fut décrit en 4e de couverture au gré des rééditions comme
veilleur de nuit ! (métier qu’il avait dû exercer pendant ses jeunes années pour survivre). Ce n’est qu’au début des années quatre-vingt que cette mention fut enlevée (12). Mais il fallut encore plusieurs années pour que les autres livres de cet immense écrivain soient traduits en français (1988 pour ce chef-d’uvre qu’est Ma vie dans la brousse des fantômes – 1954 dans sa version originale).
On l’aura compris, à travers le succès de la collection African Writers Series ainsi que des autres éditeurs anglo-saxons, se dessine en creux l’échec des éditeurs français et francophones sur le continent. L’environnement économique et politique, le poids démographique ne sont que des explications parmi d’autres. L’approche du marché, le respect des acheteurs, le souci d’être présent et une vraie connaissance sont aussi des clefs d’une réussite dont les éditeurs français feraient bien de s’inspirer. De nos jours, aux yeux des Français, l’Afrique reste toujours vue à travers le prisme de la pauvreté et de la compassion. Certains y verront une conséquence de notre vision judéo-chrétienne du monde, d’autres parleront de néocolonialisme. Mais certains esprits chagrins rétorqueront que ces deux sentiments constituent peut-être les deux faces d’une même pièce
1. Quand l’Afrique réplique, p.56.
2. Quand l’Afrique réplique, p.59.
3. L’équivalent du livre de poche en France.
4. Élevée en Rhodésie, Doris Lessing a reçu le prix Nobel de littérature en 2007.
5. Mais ce point soulève d’autres problématiques plus complexes comme le savoir-faire et la capacité des imprimeries africaines à produire des ouvrages de bonne qualité. Les marchés n’expliquent pas tout…
6. Un exemple très concret a été vu par l’auteur de cet article au milieu des années deux mille à Maurice, pays où l’anglais et le français se croisent : dans une même librairie de Floréal, l’exemplaire du Da Vinci code en anglais, imprimé en Inde était deux fois moins cher que la version française importée d’Europe.
7. Est-ce cette culture du livre qui explique l’aventure de Mbari Publications né au début des années soixante ? Le livre l’évoque aux pages 99 et 100.
8. L’auteur de ces lignes s’en est rendu compte, à sa grande stupéfaction, lors de plusieurs séjours au Kenya et en Afrique du Sud entre 1999 et 2003 et d’une mission de deux semaines au sein des bibliothèques universitaires nigérianes en 2002.
9.[www.eastafricanpublishers.com]
10. Quand l’Afrique réplique, p.72
11. De fait Kourouma fut publié pour la première fois en France en 1970 puis en 1990, avec Monné, outrages et défis.
12. Cette anecdote a été racontée à l’auteur de cet article par son ancien professeur au CEAN de Bordeaux, Alain Ricard.///Article N° : 10589
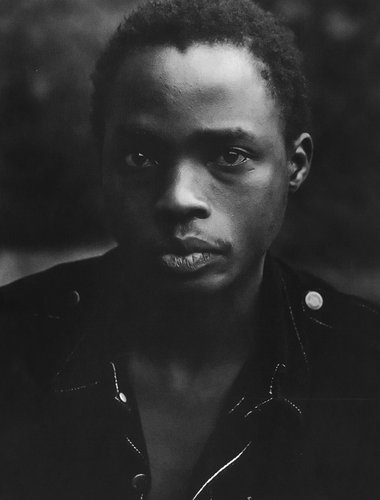










![[VIDEO] Jimmy Jean-Louis présente son livre « Le Héros »](http://africultures.com/wp-content/uploads/2025/05/jimmy-jl-214x140.jpg)

